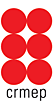Éléments des sciences
[207]Ce texte est l’article Éléments des sciences de l’Encyclopédie
ÉLÉMENTS DES SCIENCES. (Philosophie.) On appelle en général éléments d’un tout, les parties primitives et originaires dont on peut supposer que ce tout est formé. Pour transporter cette notion aux Sciences en général, et pour connaître quelle idée nous devons nous former des éléments d’une science quelconque, supposons que cette science soit entièrement traitée dans un ouvrage, en sorte que l’on ait de suite et sous les yeux les propositions, tant générales que particulières, qui forment l’ensemble de la science, et que ces propositions soient disposées dans l’ordre le plus naturel et le plus rigoureux qu’il soit possible: supposons ensuite que ces propositions forment une suite absolument continue, en sorte que chaque proposition dépende uniquement et immédiatement des précédentes, et qu’elle ne suppose point d’autres principes que ceux que les précédentes propositions renferment; en ce cas chaque proposition, comme nous l’avons remarqué dans le discours préliminaire, ne sera que la traduction de la première, présentée sous différentes faces; tout se réduirait par conséquent à cette première proposition, qu’on pourrait regarder comme l’élément de la science dont il s’agit, puisque cette science y serait entièrement renfermée. Si chacune des sciences qui nous occupent était dans le cas dont nous parlons, les éléments en seraient aussi faciles à faire qu’à apprendre; et même si nous pouvions apercevoir sans interruption la chaîne invisible qui lie tous les objets de nos connaissances, les éléments de toutes les Sciences se réduiraient à un principe unique, dont les conséquences principales seraient les éléments de chaque science particulière. L’esprit humain, participant alors de l’intelligence suprême, verrait toutes ses connaissances comme réunies sous un point de vue indivisible; il y aurait cependant cette différence entre Dieu et l’homme, que Dieu placé à ce point de vue, apercevrait d’un coup d’oeil tous les objets, et que l’homme aurait besoin de les parcourir l’un après l’autre, pour en acquérir une connaissance détaillée. Mais il s’en faut beaucoup que nous puissions nous placer à un tel point de vue. Bien loin d’apercevoir la chaîne qui unit toutes les Sciences, nous ne voyons pas même dans leur totalité les parties de cette chaîne qui constituent chaque science en particulier. Quelqu’ordre que nous puissions mettre entre les propositions, quelqu’exactitude que nous cherchions à observer dans la déduction, il s’y trouvera toujours nécessairement des vides; toutes les propositions ne se tiendront pas immédiatement, et formeront pour ainsi dire des groupes différents et désunis.
Néanmoins quoique dans cette espèce de tableau il y ait bien des objets qui nous [208] échappent, il est facile de distinguer les propositions ou vérités générales qui servent de base aux autres, et dans lesquelles celles-ci sont implicitement renfermées. Ces propositions, réunies en un corps, formeront, à proprement parler, les éléments de la science, puisque ces éléments seront comme un germe qu’il suffirait de développer pour connaître les objets de la science fort en détail. Mais on peut encore considérer les éléments d’une science sous un autre point de vue: en effet, dans la suite des propositions on peut distinguer celles qui, soit dans elles-mêmes, soit dans leurs conséquences, considèrent cet objet de la manière la plus simple; et ces propositions étant détachées du tout, en y joignant même les conséquences détaillées qui en dérivent immédiatement, on aura des éléments pris dans un second sens plus vulgaire et plus en usage, mais moins philosophique que le premier. Les éléments pris dans le premier sens, considèrent pour ainsi dire en gros toutes les parties principales de l’objet: les éléments pris dans le second sens, considèrent en détail les parties de l’objet les plus grossières. Ainsi des éléments de Géométrie qui contiendraient non seulement les principes de la mesure et des propriétés des figures planes, mais ceux de l’application de l’Algèbre à la Géométrie, et du calcul différentiel et intégral appliqués aux courbes, feraient des éléments de Géométrie dans le premier sens, parce qu’ils renfermeraient les principes de la Géométrie prise dans toute son étendue; mais ce qu’on appelle des éléments de Géométrie ordinaire, qui ne roulent que sur les propriétés générales des figures planes et du cercle, ne sont que des éléments pris dans le second sens, parce qu’ils n’embrassent que la partie la plus simple de leur objet, soit qu’ils l’embrassent avec plus ou moins de détail. Nous nous attacherons ici aux éléments pris dans le premier sens; ce que nous en dirons pourra facilement s’appliquer en suite aux éléments pris dans le second.
La plupart des Sciences n’ont été inventées que peu à peu: quelques hommes de génie, à différents intervalles de temps, ont découvert les uns après les autres un certain nombre de vérités; celles-ci en ont fait découvrir de nouvelles, jusqu’à ce qu’enfin le nombre des vérités connues est devenu assez considérable. Cette abondance, du moins apparente, a produit deux effets. En premier lieu, on a senti la difficulté d’y ajouter, non seulement parce que les génies créateurs sont rares, mais encore parce que les premiers pas faits par une suite de bons esprits, rendent les suivants plus difficiles à faire; car les hommes de génie parcourent rapidement la carrière une fois ouverte, jusqu’à ce qu’ils arrivent à quelqu’obstacle insurmontable pour eux, qui ne peut être franchi qu’après des siècles de travail. En second lieu, la difficulté d’ajouter aux découvertes, a dû naturellement produire le dessein de mettre en ordre les découvertes déjà faites; car le caractère de l’esprit humain est d’amasser d’abord le plus de connaissances qu’il est possible, et de songer ensuite à les mettre en ordre, lorsqu’il n’est plus si facile d’en amasser. De là sont nés les premiers traités en tout genre; traités pour la plupart imparfaits et informes. Cette imperfection venait principalement de ce que ceux qui ont dressé ces premiers ouvrages, ont pu rarement se mettre à la place des inventeurs, dont ils n’avaient pas reçu le génie en recevant le fruit de leurs travaux. Les inventeurs seuls pouvaient traiter d’une manière satisfaisante les sciences qu’ils avaient trouvées, parce qu’en revenant sur la marche de leur esprit, et en examinant de quelle manière une proposition les avait conduits à une autre, ils étaient seuls en état de voir la liaison des vérités, et d’en former par conséquent la chaîne. D’ailleurs, les principes philosophiques sur lesquels la découverte d’une science est appuyée, n’ont souvent une certaine netteté que dans l’esprit des inventeurs; [209] car soit par négligence, soit pour déguiser leurs découvertes, soit pour en faciliter aux autres le fruit, ils les couvrent d’un langage particulier, qui sert ou à leur donner un air de mystère, ou à en simplifier l’usage: or ce langage ne peut être mieux traduit que par ceux même qui l’ont inventé, ou qui du moins auraient pu l’inventer. Il est enfin des cas où les inventeurs mêmes n’auraient pu réduire en ordre convenable leurs connaissances; c’est lorsque, ayant été guidés moins par le raisonnement que par une espèce d’instinct, ils sont hors d’état de pouvoir les transmettre aux autres. C’est encore lorsque le nombre des vérités se trouve assez grand pour être recueilli, et pour qu’il soit difficile d’y ajouter, mais non assez complet pour former un corps et un ensemble.
Ce que nous venons de dire regarde les traités détaillés et complets; mais il est évident que les mêmes réflexions s’appliquent aux traités élémentaires: car puisque les traités complets ne différent des traités élémentaires bien faits que par le détail des conséquences et des propositions particulières omises dans les unes et énoncées dans les autres, il s’ensuit qu’un traité élémentaire et un traité complet, si on les suppose bien faits, seront ou explicitement ou implicitement renfermés l’un dans l’autre.
Il est donc évident par tout ce que nous venons de dire, qu’on ne doit entreprendre les éléments d’une science que quand les propositions qui la constituent ne seront point chacune isolées et indépendantes l’une de l’autre, mais quand on y pourra remarquer des propositions principales dont les autres seront des conséquences. Or comment distinguera-t-on ces propositions principales? Voici le moyen d’y parvenir. Si les propositions qui forment l’ensemble d’une science ne se suivent pas immédiatement les unes les autres, on remarquera les endroits où la chaîne est rompue, et les propositions qui forment la tête de chaque partie de la chaîne, sont celles qui doivent entrer dans les éléments. A l’égard des propositions mêmes qui forment une seule portion continue de la chaîne, on y en distinguera de deux espèces; celles qui ne sont que de simples conséquences, une simple traduction en d’autres termes de la proposition précédente, doivent être exclues des éléments, puisqu’elles y sont évidemment renfermées. Celles qui empruntent quelque chose, non seulement de la proposition précédente, mais d’une autre proposition primitive, sembleraient devoir être exclues par la même raison, puisqu’elles sont implicitement et exactement renfermées riens les propositions dont elles dérivent. Mais en s’attachant scrupuleusement à cette règle, non seulement on réduirait les éléments à presque rien, on en rendrait l’usage et l’application trop difficiles. Ainsi les conditions nécessaires pour qu’une proposition entre dans les éléments d’une science pris dans le premier sens, sont que ces propositions soient assez distinguées les unes des autres, pour qu’on ne puisse pas en former une chaîne immédiate; que ces propositions soient elles-mêmes la source de plusieurs autres, qui n’en seront plus regardées que comme des conséquences; et qu’enfin si quelqu’une des propositions est comprise dans les précédentes, elle n’y soit comprise qu’implicitement, ou de manière qu’on ne puisse en apercevoir la dépendance que par un raisonnement développé.
N’oublions pas de dire qu’il faut insérer dans les éléments les propositions isolées, s’il en est quelqu’une qui ne tienne ni comme principe ni comme conséquence, à aucune autre; car les éléments d’une science doivent contenir au moins le germe de toutes les vérités qui font l’objet de cette science: par conséquent l’omission d’une seule vérité isolée, rendrait les éléments imparfaits.
Mais ce qu’il faut surtout s’attacher à bien développer, c’est la métaphysique [210] des propositions. Cette métaphysique, qui a guidé ou dû guider les inventeurs, n’est autre chose que l’exposition claire et précise des vérités générales et philosophiques sur lesquelles les principes de la science sont fondés. Plus cette métaphysique est simple, facile, et pour ainsi dire populaire, plus elle est précieuse; on peut même dire que la simplicité et la facilité en sont la pierre de touche. Tout ce qui est vrai, surtout dans les sciences de pur raisonnement, a toujours des principes clairs et sensibles, et par conséquent peut être mis à la portée de tout le monde sans aucune obscurité. En effet, comment les conséquences pourraient-elles être claires et certaines, si les principes étaient obscurs? La vanité des auteurs et des lecteurs est cause que l’on s’écarte souvent de ces règles: les premiers sont flattés de pouvoir répandre un air de mystère et de sublimité sur leurs productions: les autres ne haïssent pas l’obscurité, pourvu qu’il en résulte une espèce de merveilleux; mais la vérité est simple, et veut être traitée comme elle est. Nous aurons occasion dans cet ouvrage d’appliquer souvent les règles que nous venons de donner, principalement dans ce qui regarde les lois de la Mécanique, la Géométrie qu’on nomme de l’infini, et plusieurs autres objets; c’est pourquoi nous insistons pour le présent assez légèrement là-dessus.
Pour nous borner ici à quelques règles générales, quels sont dans chaque science les principes d’où l’on doit partir? Des faits simples, bien vus et bien avoués; en Physique l’observation de l’univers, en Géométrie les propriétés principales de l’étendue, en Mécanique l’impénétrabilité des corps, en Métaphysique et en Morale l’étude de notre âme et de ses affections, et ainsi des autres. Je prends ici la Métaphysique dans le sens le plus rigoureux qu’elle puisse avoir, en tant qu’elle est la science des êtres purement spirituels. Ce que j’en dis ici sera encore plus vrai, quand on la regardera dans un sens plus étendu, comme la science universelle qui contient les principes de toutes les autres; car si chaque science n’a et ne peut avoir que l’observation pour vrais principes, la Métaphysique de chaque science ne peut consister que dans les conséquences générales qui résultent de l’observation, présentées sous le point de vue le plus étendu qu’on puisse leur donner. Ainsi dussé-je, contre mon intention, choquer encore quelques personnes, dont le zèle pour la Métaphysique est plus ardent qu’éclairé, je me garderai bien de la définir, comme elles le veulent, la science des idées; car que serait-ce qu’une pareille science? La Philosophie, sur quelque objet qu’elle s’exerce, est la science des faits ou celle des chimères. C’est en effet avoir d’elle une idée bien informe et bien peu juste, que de la croire destinée à se perdre dans les abstractions, dans les propriétés générales de l’être, dans celles du mode et de la substance. Cette spéculation inutile ne consiste qu’à présenter sous une forme et un langage scientifique, des propositions qui étant mises en langage vulgaire, ou ne seraient que des vérités communes qu’on aurait honte d’étaler avec tant d’appareil, ou seraient pour le moins douteuses, et par conséquent indignes d’être érigées en principes. D’ailleurs une telle méthode est non seulement dangereuse, en ce qu’elle retarde par des questions vagues et contentieuses le progrès de nos connaissances réelles, elle est encore contraire à la marche de l’esprit, qui, comme nous ne saurions trop le redire, ne connaît les abstractions que par 1’étude des êtres particuliers. Ainsi la première chose par où l’on doit commencer en bonne Philosophie, c’est de faire main-basse sur ces longs et ennuyeux prolégomènes, sur ces nomenclatures éternelles, sur ces arbres et ces divisions sans fin; tristes restes d’une misérable scholastique et de l’ignorante vanité de ces siècles ténébreux, qui dénués d’observations et de faits, se créaient un objet imaginaire de spéculations et de disputes. J’en dis autant [211] de ces questions aussi inutiles que mal résolues, sur la nature de la Philosophie, sur son existence, sur les premier principe des connaissances humaines, sur l’union de la probabilité avec 1évidence, et sur une infinité d’autres objets semblables.
Il est dans les Sciences d’autres questions contestées, moins frivoles en elles-mêmes, mais aussi inutiles en effet, qu’on doit absolument bannir d’un livre d’éléments. On peut juger sûrement de l’inutilité absolue d’une question sur laquelle on se divise, lorsqu’on voit que les Philosophes se réunissent d’ailleurs sur des propositions, qui néanmoins au premier coup d’oeil sembleraient tenir nécessairement à cette question. Par exemple, les éléments de Géométrie, de calcul, étant les mêmes pour toutes les écoles de Philosophie, il résulte de cet accord, et que les vérités géométriques ne tiennent point aux principes contestés sur la nature de l’étendue, et qu’il est sur cette matière un point commun où toutes les sectes se réunissent; un principe vulgaire et simple d’où elles partent toutes sans s’en apercevoir; principe qui s’est obscurci par les disputes, ou qu’elles ont fait négliger, mais qui n’en subsiste pas moins. De même, quoique le mouvement et ses propriétés principales soient l’objet de la mécanique, néanmoins la métaphysique obscure et contentieuse de la nature du mouvement, est totalement étrangère à cette science; elle suppose l’existence du mouvement, tire de cette supposition une foule de vérités utiles, et laisse bien loin derrière elle la philosophie scholastique s’épuiser en vaines subtilités sur le mouvement même. Zénon chercherait encore si les corps se meuvent, tandis qu’Archimède aurait trouvé les lois de l’équilibre, Huyghens celles de la percussion, et Newton celles du système du monde.
Concluons de là que le point auquel on doit s’arrêter dans la recherche des principes d’une science, est déterminé par la nature de cette science même, c’est-à-dire par le point de vue sous lequel elle envisage son objet; tout ce qui est au-delà doit être regardé ou comme appartenant à une science, ou comme une région entièrement refusée à nos regards. J’avoue que les principes d’où nous partons en ce cas ne sont peut-être eux-mêmes que des conséquences fort éloignées des vrais principes qui nous sont inconnus, et qu’ainsi ils mériteraient peut-être le nom de conclusions plutôt que celui de principes. Mais il n’est pas nécessaire que ces conclusions soient des principes en elles-mêmes, il suffit qu’elles en soient pour nous.
Nous n’avons parlé jusqu’à présent que des principes proprement dits, de ces vérités primitives par lesquelles on peut non seulement guider les autres, mais se guider soi-même dans l’étude d’une science. Il est d’autres principes qu’on peut appeler secondaires; ils dépendent moins de la nature des choses, que du langage: ils ont principalement lieu lorsqu’il s’agit de communiquer ses connaissances aux autres. Je veux parler des définitions, qu’on peut, à l’exemple des Mathématiciens, regarder en effet comme des principes; puisque dans quelque espèce d’éléments que ce puisse être, c’est en partie sur elles que la plupart des propositions sont appuyées. Ce nouvel objet demande quelques réflexions: l’article DÉFINITION en présente plusieurs; nous y ajouterons les suivantes.
Définir, suivant la force du mot, c’est marquer les bornes et les limites d’une chose; ainsi définir un mot, c’est en déterminer et en circonscrire pour ainsi dire le sens, de manière qu’on ne puisse, ni avoir de doute sur ce sens donné, ni l’étendre, ni le restreindre, ni enfin l’attribuer à aucun autre terme.
Pour établir les règles des définitions, remarquons d’abord que dans les Sciences ont fait usage de deux sortes de termes, de termes vulgaires, et de termes scientifiques.
[212]J’appelle termes vulgaires, ceux dont on fait usage ailleurs que dans la science dont il s’agit, c’est-à-dire dans le langage ordinaire, ou même dans d’autres sciences; tels sont par exemple les mots espace, mouvement en Mécanique; corps en Géométrie, son en Musique, et une infinité d’autres. J’appelle termes scientifiques, les mots propres et particuliers à la science, qu’on a été obligé de créer pour désigner certains objets, et qui sont inconnus à ceux à qui la science est tout à fait étrangère.
Il semble d’abord que les termes vulgaires n’ont pas besoin d’être définis, puisque, étant, comme on le suppose, d’un usage fréquent, l’idée qu’on attache à ces mots doit être bien déterminée et familière à tout le monde. Mais le langage des Sciences ne saurait être trop précis, et celui du vulgaire est souvent vague et obscur; on ne saurait donc trop s’appliquer à fixer la signification des mots qu’on emploie, ne fût-ce que pour éviter toute équivoque. Or pour fixer la signification des mots, ou, ce qui revient au même, pour les définir, il faut d’abord examiner quelles sont les idées simples que ce mot renferme; j’appelle idée simple, celle qui ne peut être décomposée en d’autres, et par ce moyen être rendue plus facile à saisir: telle est par exemple l’idée d’existence, celle de sensation, et une infinité d’autres. Ceci a besoin d’une plus ample explication.
A proprement parler, il n’y a aucune de nos idées qui ne soit simple; car quelque composé que soit un objet, l’opération par laquelle notre esprit le conçoit comme composé, est une opération instantanée et unique: ainsi c’est par une seule opération simple que nous concevons un corps comme une substance tout à la fois étendue, impénétrable, figurée, et colorée.
Ce n’est donc point par la nature des opérations de l’esprit qu’on doit juger du degré de simplicité des idées; c’est la simplicité plus ou moins grande de l’objet qui en décide: de plus cette simplicité plus ou moins grande, n’est pas celle qui est déterminée par le nombre plus ou moins grand des parties de l’objet, mais par le nombre plus ou moins grand des propriétés qu’on y considère à la fois; ainsi quoique l’espace et le temps soient composés de parties, et par conséquent ne soient pas des êtres simples, cependant l’idée que nous en avons est une idée simple, parce que toutes les parties du temps et de l’espace sont absolument semblables, que l’idée que nous en avons est absolument la même, et qu’enfin cette idée ne peut être décomposée, puisqu’on ne pourrait simplifier l’idée de l’étendue et celle du temps sans les anéantir : au lieu qu’en retranchant de l’idée de corps, par exemple, l’idée d’impénétrabilité, de figure, et de couleur, il reste encore l’idée de l’étendue.
Les idées simples dans le sens où nous l’entendons, peuvent se réduire à deux espèces: les unes sont des idées abstraites; l’abstraction en effet n’est autre chose que l’opération, par laquelle nous considérons dans un objet une propriété particulière, sans faire attention à celles qui se joignent à celle-là pour constituer l’essence de l’objet. La seconde espèce d’idées simples est renfermée dans les idées primitives que nous acquérons par nos sensations, comme celles des couleurs particulières, du froid, du chaud, et plusieurs autres semblables; aussi n’y a-t-il point de circonlocution plus propre à faire entendre ces choses, que le terme unique qui les exprime.
Quand on a trouvé toutes les idées simples qu’un mot renferme, on le définira en présentant ces idées d’une manière aussi claire, aussi courte, et aussi précise qu’il sera possible. Il suit de ces principes que tout mot vulgaire qui ne renfermera qu’une idée simple ne peut et ne doit pas être défini dans quelque science que ce [213] puisse être, puisqu’une définition ne pourrait en mieux faire connaître le sens. A l’égard des termes vulgaires qui renferment plusieurs idées simples, fussent-ils d’un usage très commun, il est bon de les définir, pour développer parfaitement les idées simples qu’ils renferment.
Ainsi dans la Mécanique ou science du mouvement des corps, on ne doit définir ni l’espace ni le temps, parce que ces mots ne renferment qu’une idée simple; mais on peut et on doit même définir le mouvement, quoique la notion en soit assez familière à tout le monde, parce que l’idée de mouvement est une idée complexe qui en renferme deux simples, celle de l’espace parcouru, et celle du temps employé à le parcourir. Il suit encore des mêmes principes, que les idées simples qui entrent dans une définition doivent être tellement distinctes l’une de l’autre, qu’on ne puisse en retrancher aucune. Ainsi dans la définition ordinaire du triangle rectiligne, on fait entrer mal à propos les trois côtés et les trois angles; il suffit d’y faire entrer les trois côtés, parce qu’une figure renfermée par trois lignes droites a nécessairement trois angles. C’est à quoi on ne saurait faire trop d’attention, pour ne pas multiplier sans nécessité les mots non plus que les êtres, et pour ne pas faire regarder comme deux idées distinctes, ce qui n’est individuellement que la même.
On peut donc dire non seulement qu’une définition doit être courte, mais que plus elle sera courte, plus elle sera claire; car la brièveté consiste à n’employer que les idées nécessaires, et à les disposer dans l’ordre le plus naturel. On n’est souvent obscur que parce qu’on est trop long: l’obscurité vient principalement de ce que les idées ne sont pas bien distinguées les unes des autres, et ne sont pas mises à leur place. Enfin la brièveté étant nécessaire dans les définitions, on peut et on doit même y employer des termes qui renferment des idées complexes, pourvu que ces termes aient été définis auparavant, et qu’on ait par conséquent développé les idées simples qu’ils contiennent. Ainsi on peut dire qu’un triangle rectiligne est une figure terminée par trois lignes droites, pourvu qu’on ait défini auparavant ce qu’on entend par figure, c’est-à-dire un espace terminé entièrement par des lignes: ce qui renferme trois idées, celle d’étendue, celle de bornes, et celle de bornes en tout sens.
Telles sont les règles générales d’une définition; telle est l’idée qu’on doit s’en faire, et suivant laquelle une définition n’est autre chose que le développement des idées simples qu’un mot renferme. Il est fort inutile après cela d’examiner si les définitions sont de nom ou de chose, c’est-à-dire si elles sont simplement l’explication de ce qu’on entend par un mot, ou si elles expliquent la nature de l’objet indiqué par ce mot. En effet, qu’est-ce que la nature d’une chose? En quoi consiste-t-elle proprement, et la connaissons-nous? Si on veut répondre clairement à ces questions, on verra combien la distinction dont il s’agit est futile et absurde: car étant ignorants comme nous le sommes sur ce que les êtres sont en eux-mêmes, la connaissance de la nature d’une chose (du moins par rapport à nous) ne peut consister que dans la notion claire et décomposée, non des principes réels et absolus de cette chose, mais de ceux qu’elle nous paraît renfermer. Toute définition ne peut être envisagée que sous ce dernier point de vue: dans ce cas elle sera plus qu’une simple définition de nom, puisqu’elle ne se bornera pas à expliquer le sens d’un mot, mais qu’elle en décomposera l’objet; et elle sera moins aussi qu’une définition de chose, puisque la vraie nature de l’objet, quoiqu’ainsi décomposé, pourra toujours rester inconnue.
Voilà ce qui concerne la définition des termes vulgaires. Mais une science ne [214] se borne pas à ces termes, elle est forcée d’en avoir de particuliers; soit pour abréger le discours et contribuer ainsi à la clarté, en exprimant par un seul mot ce qui aurait besoin d’être exprimé par une phrase entière; soit pour désigner des objets peu connus sur lesquels elle s’exerce, et que souvent elle se produit à elle-même par des combinaisons singulières et nouvelles. Ces mots ont besoin d’être définis, c’est-à-dire simplement expliqués par d’autres termes plus vulgaires et plus simples; et la seule règle de ces définitions, c’est de n’y employer aucun terme qui ait besoin lui-même d’être expliqué, c’est-à-dire qui ne soit ou clair de lui-même, ou déjà expliqué auparavant.
Les termes scientifiques n’étant inventés que pour la nécessité, il est clair que l’on ne doit pas au hasard charger une science de termes particuliers. Il serait donc à souhaiter qu’on abolît ces termes scientifiques et pour ainsi dire barbares, qui ne servent qu’à en imposer; qu’en Géométrie, par exemple, on dit simplement proposition au lieu de théorème, conséquence au lieu de corollaire, remarque au lieu de scholie, et ainsi des autres. La plupart des mots de nos Sciences sont tirés des langues savantes, où ils étaient intelligibles au peuple même, parce qu’ils n’étaient souvent que des termes vulgaires, ou dérivés de ces termes: pourquoi ne pas leur conserver cet avantage?
Les mots nouveaux, inutiles, bizarres, ou tirés de trop loin, sont presque aussi ridicules en matière de science, qu’en matière de goût. On ne saurait, comme nous l’avons déjà dit ailleurs, rendre la langue de chaque science trop simple, et pour ainsi dire trop populaire; non seulement c’est un moyen d’en faciliter l’étude, c’est ôter encore un prétexte de la décrier au peuple, qui s’imagine ou qui voudrait se persuader que la langue particulière d’une science en fait tout le mérite, que c’est une espèce de rempart inventé pour en défendre les approches: les ignorants ressemblent en cela à ces généraux malheureux ou malhabiles, qui ne pouvant forcer une place se vengent en insultant les dehors.
Au reste ce que je propose ici a plutôt pour objet les mots absolument nouveaux que le progrès naturel d’une science oblige à faire, que les mots qui y sont déjà consacrés, surtout lorsque ces mots ne pourraient être facilement changés en d’autres plus intelligibles. Il est dans les choses d’usage, des limites où le philosophe s’arrête; il ne veut ni se réformer, ni s’y soumettre en tout, parce qu’il n’est ni tyran ni esclave.
Les règles que nous venons de donner, concernent les éléments en général pris dans le premier sens. A l’égard des éléments pris dans le second sens, ils ne diffèrent des autres qu’en ce qu’ils contiendront nécessairement moins de propositions primitives, et qu’ils pourront contenir plus de conséquences particulières. Les règles de ces deux éléments sont d’ailleurs parfaitement semblables; car les éléments pris dans le premier sens étant une fois traités, l’ordre des propositions élémentaires et primitives y sera réglé par le degré de simplicité ou de multiplicité, sous lequel on envisagera l’objet. Les propositions qui envisagent les parties les plus simples de l’objet se trouveront donc placées les premières; et ces propositions, en y joignant ou en omettant leurs conséquences, doivent former les éléments de la seconde espèce. Ainsi le nombre des propositions primitives de cette seconde espèce d’éléments doit être déterminé par l’étendue plus ou moins grande de la science que l’on embrasse, et le nombre des conséquences sera déterminé par le détail plus ou moins grand dans lequel on embrasse cette partie.
On peut proposer plusieurs questions sur la manière de traiter les éléments d’une science.
[215]En premier lieu, doit-on suivre, en traitant les éléments, l’ordre qu’ont suivi les inventeurs? Il est d’abord évident qu’il ne s’agit point ici de l’ordre que les inventeurs ont pour l’ordinaire réellement suivi, et qui était sans règle et quelquefois sans objet, mais de celui qu’ils auraient pu suivre en procédant avec méthode. On ne peut douter que cet ordre ne soit en général le plus avantageux à suivre; parce qu’il est le plus conforme à la marche de l’esprit, qu’il éclaire en instruisant, qu’il met sur la voie pour aller plus loin, et qu’il fait pour ainsi dire pressentir à chaque pas celui qui doit le suivre: c’est ce qu’on appelle autrement la méthode analytique, qui procède des idées composées aux idées abstraites, qui remonte des conséquences connues aux principes inconnus, et qui en généralisant celles-là, parvient à découvrir ceux-ci; mais il faut que cette méthode réunisse encore la simplicité et la clarté, qui sont les qualités les plus essentielles que doivent avoir les éléments d’une science. Il faut bien se garder surtout, sous prétexte de suivre la méthode des inventeurs, de supposer comme vraies des propositions qui ont besoin d’être prouvées, sous prétexte que les inventeurs, par la force de leur génie, ont dû apercevoir d’un coup d’oeil et comme à vue d’oiseau la vérité de ces propositions. On ne saurait traiter trop exactement les Sciences, surtout celles qui s’appellent particulièrement exactes.
La méthode analytique peut surtout être employée dans les sciences dont l’objet n’est pas hors de nous, et dont le progrès dépend uniquement de la méditation; parce que tous les matériaux de la science étant pour ainsi dire au-dedans de nous, l’analyse est la vraie manière et la plus simple d’employer ces matériaux. Mais dans les sciences dont les objets nous sont extérieurs, la méthode synthétique, celle qui descend des principes aux conséquences, des idées abstraites aux composées, peut souvent être employée avec succès et avec plus de simplicité que l’autre; d’ailleurs les faits sont eux-mêmes en ce cas les vrais principes. En général la méthode analytique est plus propre à trouver les vérités, ou à faire connaître comment on les a trouvées. La méthode synthétique est plus propre à expliquer et à faire entendre les vérités trouvées: l’une apprend à lutter contre les difficultés, en remontant à la source; l’autre place l’esprit à cette source même, d’où il n’a plus qu’à suivre un cours facile. Voyez ANALYSE, SYNTHÈSE.
On demande en second lieu laquelle des deux qualités doit être préférée dans des éléments, de la facilité, ou de la rigueur exacte. Je réponds que cette question suppose une chose fausse; elle suppose que la rigueur exacte puisse exister sans la facilité, et c’est le contraire; plus une déduction est rigoureuse, plus elle est facile à entendre: car la rigueur consiste à réduire tout aux principes les plus simples. D’où il s’ensuit encore que la rigueur proprement dite entraîne nécessairement la méthode la plus naturelle et la plus directe. Plus les principes seront disposés dans l’ordre convenable, plus la déduction sera rigoureuse; ce n’est pas que absolument elle ne pût l’être si on suivait une méthode plus composée, comme a fait Euclide dans ses éléments: mais alors l’embarras de la marche ferait aisément sentir que cette rigueur précaire et forcée ne serait qu’improprement telle.
Nous n’en dirons pas davantage ici sur les règles qu’on doit observer en général, pour bien traiter les éléments d’une science. La meilleure manière de faire connaître ces règles, c’est de les appliquer aux différentes sciences; et c’est ce que nous nous proposons d’exécuter dans les différents articles de cet ouvrage. A l’égard des éléments des Belles-Lettres, ils sont appuyés sur les principes du goût. Voy. GOUT. Ces éléments, semblables en plusieurs choses aux éléments des Sciences, ont été faits après coup sur l’observation des différentes choses qui ont paru affecter agréablement [216] les hommes. On trouvera de même à l’article HISTOIRE, ce que nous pensons des éléments de l’histoire en général. Voyez aussi COLLÈGE.
Nous dirons seulement ici que toutes nos connaissances peuvent se réduire à trois espèces; l’Histoire, les Arts tant libéraux que mécaniques, et les Sciences proprement dites, qui ont pour objet les matières de pur raisonnement; et que ces trois espèces peuvent être réduites à une seule, à celle des Sciences proprement dites. Car, 1° l’Histoire est ou de la nature, ou des pensées des hommes, ou de leurs actions. L’histoire de la nature, objet de la méditation du philosophe, rentre dans la classe des sciences; il en est de même de l’histoire des pensées des hommes, surtout si on ne comprend sous ce nom que celles qui ont été vraiment lumineuses et utiles, et qui sont aussi les seules qu’on doive présenter à ses lecteurs dans un livre d’éléments. A l’égard de l’histoire des rois, des conquérants, et des peuples, en un mot des événements qui ont changé ou troublé la terre, elle ne peut être l’objet du philosophe qu’autant qu’elle ne se borne pas aux faits seuls; cette connaissance stérile, ouvrage des yeux et de la mémoire, n’est qu’une connaissance de pure convention quand on la renferme dans ses étroites limites, mais entre les mains de l’homme qui fait penser elle peut devenir la première de toutes. Le sage étudie l’univers moral comme le physique, avec cette patience, cette circonspection, ce silence de préjugés qui augmente les connaissances en les rendant utiles; il suit les hommes dans leurs passions comme la nature dans ses procédés; il observe, il rapproche, il compare, il joint ses propres observations à celles des siècles précédents, pour tirer de ce tout les principes qui doivent l’éclairer dans ses recherches ou le guider dans ses actions: d’après cette idée, il n’envisage l’Histoire que comme un recueil d’expériences morales faites sur le genre humain, recueil qui serait sans doute beaucoup plus complet s’il n’eût été fait que par des philosophes, mais qui, tout informe qu’il est, renferme encore les plus grandes leçons de conduite, comme le recueil des observations médicinales de tous les âges, malgré tout ce qui lui manque et qui lui manquera peut-être toujours, forme néanmoins la partie la plus importante et la plus réelle de l’art de guérir. L’Histoire appartient donc à la classe des Sciences, quant à la manière de l’étudier et de se la rendre utile, c’est-à-dire quant à la partie philosophique.
2. Il en est de même des Arts tant mécaniques que libéraux: dans les uns et les autres ce qui concerne les détails est uniquement l’objet de l’article; mais d’un côté les principes fondamentaux des Arts mécaniques sont fondés sur les connaissances mathématiques et physiques des hommes, c’est-à-dire sur les deux branches les plus considérables de la Philosophie; de l’autre, les Arts libéraux ont pour base l’étude fine et délicate de nos sensations. Cette métaphysique subtile et profonde qui a pour objet les matières de goût, fait y distinguer les principes absolument généraux et communs à tous les hommes, d’avec ceux qui sont modifiés par le caractère, le génie, le degré de sensibilité des nations ou des individus; elle démêle par ce moyen le beau essentiel et universel, s’il en est un, d’avec le beau plus ou moins arbitraire et plus ou moins convenu: également éloignée et d’une décision trop vague et d’une discussion trop scrupuleuse, elle ne pousse l’analyse du sentiment que jusqu’où elle doit aller, et ne la resserre point non plus trop en deçà du champ qu’elle peut se permettre; en comparant les impressions et les affections de notre âme, comme le métaphysicien ordinaire compare les idées purement spéculatives, elle tire de cet examen des règles pour rappeler ces impressions à une source commune, et pour les juger par l’Analogie qu’elles ont entre elles; mais elle s’abstient ou de les juger en elles-mêmes, ou de vouloir apprécier les impressions [217] originaires et primitives par les principes d’une philosophie aussi obscure pour nous que la structure de nos organes, ou de vouloir enfin faire adopter ses règles par ceux qui ont reçu soit de la nature soit de l’habitude une autre façon de sentir. Ce que nous disons ici du goût dans les Arts libéraux, s’applique de soi-même à cette partie des Sciences qu’on appelle Belles Lettres. C’est ainsi que les éléments de toutes nos connaissances sont renfermés dans ceux d’une philosophie bien entendue. Voyez PHILOSOPHIE.
Nous n’ajouterons plus qu’un mot sur la manière d’étudier quelques sortes d’éléments que ce puisse être, en supposant ces éléments bien faits. Ce n’est point avec le secours d’un maître qu’on peut remplir cet objet, mais avec beaucoup de méditation et de travail. Savoir des éléments, ce n’est pas seulement connaître ce qu’ils contiennent, c’est en connaître l’usage, les applications, et les conséquences; c’est pénétrer dans le génie de l’inventeur, c’est se mettre en état d’aller plus loin que lui, et voilà ce qu’on ne fait bien qu’à force d’étude et d’exercice: voilà pourquoi on ne saura jamais parfaitement que ce qu’on a appris soi-même. Peut-être ferait-on bien par cette raison, d’indiquer en deux mots dans des éléments l’usage et les conséquences des propositions démontrées. Ce serait pour les commençants un sujet d’exercer leur esprit en cherchant la démonstration de ces conséquences, et en faisant disparaître les vides qu’on leur aurait laissés à remplir. Le propre d’un bon livre d’éléments est de laisser beaucoup à penser.
On doit être en état de juger maintenant si des éléments complets des Sciences, peuvent être l’ouvrage d’un homme seul: et comment pourraient-ils l’être, puisqu’ils supposent une connaissance universelle et approfondie de tous les objets qui occupent les hommes? Je dis une connaissance approfondie; car il ne faut pas s’imaginer que pour avoir effleuré les principes d’une science, on soit en état de les enseigner. C’est à ce préjugé, fruit de la vanité et de l’ignorance, qu’on doit attribuer l’extrême disette où nous sommes de bons livres élémentaires, et la foule de mauvais dont nous sommes chaque jour inondés. L’élève à peine sorti des premiers sentiers, encore frappé des difficultés qu’il a éprouvées, et que souvent même il n’a surmontées qu’en partie, entreprend de les faire connaître et surmonter aux autres; censeur et plagiaire tout ensemble de ceux qui l’ont précédé, il copie, transforme, étend, renverse, resserre, obscurcit, prend ses idées informes et confuses pour des idées claires, et l’envie qu’il a eue d’être auteur pour le désir d’être utile. On pourrait le comparer à un homme qui ayant parcouru un labyrinthe à tâtons et les yeux bandés, croirait pouvoir en donner le plan et en développer les détours. D’un autre côté les maîtres de l’art, qui par une étude longue et assidue en ont vaincu les difficultés et connu les finesses, dédaignent de revenir sur leurs pas pour faciliter aux autres le chemin qu’ils ont eu tant de peine à suivre: peut-être encore frappés de la multitude et de la nature des obstacles qu’ils ont surmontés, redoutent-ils le travail qui serait nécessaire pour les aplanir, et qui serait trop peu senti pour qu’on pût leur en tenir compte. Uniquement occupés de faire de nouveaux progrès dans l’art, pour s’élever, s’il leur est possible, au-dessus de leurs prédécesseurs ou de leurs contemporains, et plus jaloux de l’admiration que de la reconnaissance publique, ils ne pensent qu’à découvrir et à jouir, et préfèrent la gloire d’augmenter l’édifice au soin d’en éclairer l’entrée. Ils pensent que celui qui apportera comme eux dans l’étude des Sciences, un génie vraiment propre à les approfondir, n’aura pas besoin d’autres éléments que de ceux qui les ont guidés eux-mêmes, que la nature et les réflexions suppléeront infailliblement pour lui à ce qui manque aux livres, et qu’il est inutile de faciliter aux autres des [218] connaissances qu’ils ne pourront jamais se rendre vraiment propres, parce qu’ils sont tout au plus en état de les recevoir sans y rien mettre du leur. Un peu plus de réflexion eût fait sentir combien cette manière de penser est nuisible au progrès et à la gloire des Sciences; à leur progrès, parce qu’en facilitant aux génies heureux l’étude de ce qui est connu, on les met en état d’y ajouter davantage et plus promptement; à leur gloire, parce qu’en les mettant à la portée d’un plus grand nombre de personnes, on se procure un plus grand nombre de juges éclairés. Tel est l’avantage que produiraient de bons éléments des Sciences, éléments qui ne peuvent être l’ouvrage que d’une main fort habile et fort exercée. En effet, si on n’est pas parfaitement instruit des vérités de détail qu’une Science renferme, si par un fréquent usage on n’a pas aperçu la dépendance mutuelle de ces vérités, comment distinguera-t-on parmi elles les propositions fondamentales dont elles dérivent, l’analogie ou la différence de ces propositions fondamentales, l’ordre qu’elles doivent observer entre elles, et surtout les principes au-delà desquels on ne doit pas remonter? C’est ainsi qu’un chimiste ne parvient à connaître les mixtes qu’après des analyses et des combinaisons fréquentes et variées. La comparaison est d’autant plus juste, que ces analyses apprennent au chimiste non seulement quels sont les principes dans lesquels un corps se résout, mais encore, ce qui n’est pas moins important les bornes au-delà desquelles il ne peut se résoudre, et qu’une expérience longue et réitérée peut seule faire connaître.
Des éléments bien faits, suivant le plan que nous avons exposé, et par des écrivains capables d’exécuter ce plan, auraient une double utilité: ils mettraient les bons esprits sur la voie des découvertes à faire, en leur présentant les découvertes déjà faites; de plus ils mettraient chacun plus à portée de distinguer les vraies découvertes d’avec les fausses; car tout ce qui ne pourrait point être ajouté aux éléments d’une Science comme par forme de supplément, ne serait point digne du nom de découverte. Voyez ce mot.