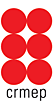Discours préliminaire au Traité élémentaire de chimie
[170]Je n’avais pour objet, lorsque j’ai entrepris cet ouvrage, que de donner plus de développement au Mémoire que j’ai lu à la séance publique de l’Académie des sciences du mois d’avril 1787, sur la nécessité de réformer et de perfectionner la nomenclature de la chimie.
C’est en m’occupant de ce travail que j’ai mieux senti que je ne l’avais encore fait jusqu’alors l’évidence des principes qui ont été posés par l’abbé de Condillac dans sa Logique et dans quelques autres de ses ouvrages. Il y établit que nous ne pensons qu’avec le secours des mots; que les langues sont de véritables méthodes analytiques; que l’algèbre la plus simple, la plus exacte et la mieux adaptée à son objet de toutes les manieres de s énoncer, est à la fois une langue et une méthode analytique; enfin, que l’art de raisonner se réduit à une langue bien faite. Et en effet, tandis que je croyais ne m’occuper que de nomenclature, tandis que je n’avais pour objet que de perfectionner le langage de la chimie, mon ouvrage s’est transformé insensiblement entre mes mains, sans qu’il m’ait été possible de m’en défendre, en un traité élémentaire de chimie.
L’impossibilité d’isoler la nomenclature de la science et la science de la nomenclature tient à ce que toute science physique est nécessairement formée de trois choses: la série des faits qui constituent la science; les idées qui les rappellent; les mots qui les expriment. Le mot doit faire naître l’idée; l’idée doit peindre le fait: ce sont trois empreintes d’un même cachet; et, comme ce sont les mots qui conservent les idées et qui les transmettent, il en résulte qu’on ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et que, quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu’ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses, si nous n’avions pas des expressions exactes pour les rendre.
La première partie de ce traité fournira à ceux qui voudront bien le méditer des preuves fréquentes de ces vérités; mais, comme je me suis vu forcé d’y suivre un ordre qui diffère essentiellement de celui qui a été adopté jusqu’à présent dans tous les ouvrages de chimie, je dois compte des motifs qui m’y ont déterminé.
C’est un principe bien constant, et dont la généralité est bien reconnue dans les mathématiques, comme dans tous les genres de connaissances, que nous ne pouvons procéder, pour nous instruire, que du connu à l’inconnu. Dans notre première enfance nos idées viennent de nos besoins; la sensation de nos besoins fait naître l’idée des objets propres à les satisfaire, et insensiblement, par une suite de sensations, d’observations et d’analyses, il se forme une génération successive [171] d’idées toutes liées les unes aux autres, dont un observateur attentif peut même, jusqu’à un certain point, retrouver le fil et l’enchaînement, et qui constituent l’ensemble de ce que nous savons.
Lorsque nous nous livrons pour la première fois à l’étude d’une science, nous sommes, par rapport à cette science, dans un état très analogue à celui dans lequel sont les enfants, et la marche que nous avons à suivre est précisément celle qui suit la nature dans la formation de leurs idées. De même que, dans l’enfant, l’idée est un effet de la sensation, que c’est la sensation qui fait naître l’idée, de même aussi, pour celui qui commence à se livrer à l’étude des sciences physiques, les idées ne doivent être qu’une conséquence, une suite immédiate d’une expérience ou d’une observation.
Qu’il me soit permis d’ajouter que celui qui entre dans la carrière des sciences est dans une situation moins avantageuse que l’enfant même qui acquiert ses premières idées; si l’enfant s’est trompé sur les objets salutaires ou nuisibles des objets qui l’environnent, la nature lui donne des moyens multipliés de se rectifier. A chaque instant le jugement qu’il a porté se trouve redressé par l’expérience. La privation ou la douleur viennent à la suite d’un jugement faux; la jouissance et le plaisir à la suite d’un jugement juste. On ne tarde pas, avec de tels maîtres, à devenir conséquent, et on raisonne bientôt juste quand on ne peut raisonner autrement sous peine de privation ou de souffrance.
Il n’en est pas de même dans l’étude et dans la pratique des sciences: les faux jugements que nous portons n’intéressent ni notre existence ni notre bien-être; aucun intérêt physique ne nous oblige de nous rectifier: l’imagination, au contraire, qui tend à nous porter continuellement au-delà du vrai; l’amour-propre et la confiance en nous-mêmes, qu’il sait si bien nous inspirer, nous sollicitent à tirer des conséquences qui ne dérivent pas immédiatement des faits; en sorte que nous sommes en quelque façon intéressés à nous séduire nous-mêmes. Il n’est donc pas étonnant que, dans les sciences physiques en général, on ait souvent supposé au lieu de conclure, que les suppositions transmises d’âge en âge soient devenues de plus en plus imposantes par le poids des autorités qu’elles ont acquises, et qu’elles aient enfin été adoptées et regardées comme des vérités fondamentales, même par de très bons esprits.
Le seul moyen de prévenir ces écarts consiste à supprimer, ou au moins à simplifier autant qu’il est possible, le raisonnement, qui est de nous et qui seul peut nous égarer; à le mettre continuellement à l’épreuve de l’expérience; à ne conserver que les faits qui ne sont que des données de la nature, et qui ne peuvent nous tromper; à ne chercher la vérité que dans l’enchaînement naturel des expériences et des observations, de la même manière que les mathématiciens parviennent à la solution d’un problème par le simple arrangement des données, et en réduisant le raisonnement à des opérations si simples, à des jugements si courts, qu’ils ne perdent jamais de vue l’évidence qui leur sert de guide.
Convaincu de ces vérités, je me suis imposé la loi de ne procéder jamais que du connu à l’inconnu, de ne déduire aucune conséquence qui ne dérive immédiatement des expériences et des observations, et d’enchaîner les faits et les vérités chimiques dans l’ordre le plus propre à en faciliter l’intelligence aux commençants. Il était impossible qu’en m’assujettissant à ce plan je ne m’écartasse pas des routes ordinaires. C’est en effet un défaut commun à tous les cours et à tous les traités de chimie, de supposer, dès les premiers pas, des connaissances que l’élève ou le lecteur ne doivent acquérir que dans les leçons subséquentes. On commence [172] dans presque tous par traiter des principes des corps; par expliquer la table des affinités, sans s’apercevoir qu’on est obligé de passer en revue dès le premier jour les principaux phénomènes de la chimie, de se servir d’expressions qui n ont point été définies, et de supposer la science acquise par ceux auxquels on se propose de l’enseigner. Aussi est-il reconnu qu’on n’apprend que peu de chose dans un premier cours de chimie; qu’une année suffit à peine pour familiariser l’oreille avec le langage, les yeux avec les appareils, et qu’il est presque impossible de former un chimiste en moins de trois ou quatre ans.
Ces inconvénients tiennent moins à la nature des choses qu’à la forme de l’enseignement, et c’est ce qui m’a déterminé à donner à la chimie une marche qui me paraît plus conforme à celle de la nature. Je ne me suis pas dissimulé qu en voulant éviter un genre de difficultés je me jetais dans un autre, et qu’il me serait impossible de les surmonter toutes; mais je crois que celles qui restent n’appartiennent point à l’ordre que je me suis prescrit; qu elles sont plutôt une suite de l’état d’imperfection où est encore la chimie. Cette science présente des lacunes nombreuses, qui interrompent la série des faits, et qui exigent des raccordements embarrassants et difficiles. Elle n’a pas, comme la géométrie élémentaire, l’avantage d’être une science complète et dont toutes les parties sont étroitement liées entre elles; mais en même temps sa marche actuelle est si rapide, les faits s’arrangent d’une manière si heureuse dans la doctrine moderne, que nous pouvons espérer, même de nos jours, de la voir s’approcher beaucoup du degré de perfection qu’elle est susceptible d’atteindre.
Cette loi rigoureuse, dont je n’ai pas dû m’écarter, de ne rien conclure au-delà de ce, que les expériences présentent, et de ne jamais suppléer au silence des faits, ne m a pas permis de comprendre dans cet ouvrage la partie de la chimie la plus susceptible, peut-être, de devenir un jour une science exacte: c’est celle qui traite des affinités chimiques ou attractions électives. M. Geoffroy, M. Gellert, M. Bergman, M. Schéele, M. de Morveau, M. Kirwan et beaucoup d’autres, ont déjà rassemblé une multitude de faits particuliers, qui n’attendent plus que la place qui doit leur être assignée; mais les données principales manquent, ou du moins celles que nous avons ne sont encore ni assez précises ni assez certaines pour devenir la base fondamentale sur laquelle doit reposer une partie aussi importante de la chimie. La science des affinités est d’ailleurs à la chimie ordinaire ce que la géométrie transcendante est à la géométrie élémentaire, et je n’ai pas cru devoir compliquer par d’aussi grandes difficultés des éléments simples et faciles, qui seront, à ce que j’espère, à la portée d’un très grand nombre de lecteurs.
Peut-être un sentiment d’amour-propre a-t-il, sans que je m’en rendisse compte à moi-même, donné du poids à ces réflexions. M. de Morveau est au moment de publier l’article Affinité de l’Encyclopédie méthodique, et j’avais bien des motifs pour redouter de travailler en concurrence avec lui.
On ne manquera pas d’être surpris de ne point trouver dans un traité élémentaire de chimie un chapitre sur les parties constituantes et élémentaires des corps; mais je ferai remarquer ici que cette tendance que nous avons à vouloir que tous les corps de la nature ne soient composés que de trois ou quatre éléments tient à un préjugé qui nous vient originairement des philosophes grecs. L’admission de quatre éléments, qui, par la variété de leurs proportions, composent tous les corps que nous connaissons, est une pure hypothèse, imaginée longtemps avant qu’on eût les premières notions de la physique expérimentale et de la chimie. On n’avait point encore de faits, et l’on formait des systèmes; et aujourd’hui que nous avons [173] rassemblé des faits, il semble que nous nous efforcions de les repousser, quand ils ne cadrent pas avec nos préjugés; tant il est vrai que le poids de l’autorité de ces pères de la philosophie humaine se fait encore sentir, et qu’elle pèsera sans doute encore sur les générations à venir.
Une chose très remarquable, c’est que, tout en enseignant la doctrine des quatre éléments, il n’est aucun chimiste qui, par la force des faits, n’ait été conduit à en admettre un plus grand nombre. Les premiers chimistes qui ont écrit depuis le renouvellement des lettres regardaient le soufre et le sel comme des substances élémentaires qui entraient dans la combinaison d’un grand nombre de corps: ils reconnaissaient donc l’existence de six éléments au lieu de quatre. Becher admettait trois terres, et c’était de leur combinaison et de la différence des proportions que résultait, suivant lui, la différence qui existe entre les substances métalliques. Stahl a modifié ce système: tous les chimistes qui lui ont succédé se sont permis d’y faire des changements, même d’en imaginer d’autres, mais tous se sont laissé entraîner à l’esprit de leur siècle, qui se contentait d’assertions sans preuves, ou du moins qui regardait souvent comme telles de très légères probabilités.
Tout ce qu’on peut dire sur le nombre et sur la nature des éléments se borne, suivant moi, à des discussions purement métaphysiques: ce sont des problèmes indéterminés qu’on se propose de résoudre, qui sont susceptibles d’une infinité de solutions, mais dont il est très probable qu’aucune en particulier n’est d’accord avec la nature. Je me contenterai donc de dire que, si par le nom d’éléments nous entendons désigner les molécules simples et indivisibles qui composent les corps, il est probable que nous ne les connaissons pas: que, si, au contraire, nous attachons au nom d’éléments ou de principes des corps l’idée du dernier terme auquel parvient l’analyse, toutes les substances que nous n’avons encore pu décomposer par aucun moyen sont pour nous des éléments; non pas que nous puissions assurer que ces corps, que nous regardons comme simples, ne soient pas eux-mêmes composés de deux ou même d’un plus grand nombre de principes; mais, puisque ces principes ne se séparent jamais, ou plutôt puisque nous n’avons aucun moyen de les séparer, ils agissent à notre égard à la manière des corps simples, et nous ne devons les supposer composés qu au moment où l’expérience et l’observation nous en auront fourni la preuve.
Ces réflexions sur la marche des idées s’appliquent naturellement au choix des mots qui doivent les exprimer. Guidé par le travail que nous avons fait en commun en 1787, M. de Morveau, M. Berthollet, M. de Fourcroy et moi, sur la nomenclature de la chimie, j’ai désigné, autant que je l’ai pu, les substances simples par des mots simples, et ce sont elles que j’ai été obligé de nommer les premières. On peut se ramier que nous nous sommes efforcé de conserver à toutes les substances les noms qu elles portent dans la société; nous ne nous sommes permis de les changer que dans deux cas: le premier à l’égard des substances nouvellement découvertes et qui n’avaient point encore été nommées, ou du moins pour celles qui ne l’avaient été que depuis peu de temps, et dont les noms encore nouveaux n’avaient point été sanctionnés par une adoption générale; le second, lorsque les noms adoptés, soit par les anciens, soit par les modernes, nous ont paru entraîner des idées évidemment fausses, lorsqu ils pouvaient faire confondre la substance qu’ils désignaient avec d’autres, qui sont douées de propriétés différentes ou opposées. Nous n’avons fait alors aucune difficulté de leur en substituer d’autres, que nous avons empruntés principalement du grec; nous avons fait en sorte qu’ils exprimassent la propriété la plus générale, la plus caractéristique de la substance, et [174] nous y avons trouvé l’avantage de soulager la mémoire des commençants, qui retiennent difficilement un mot nouveau lorsqu’il est absolument vide de sens, et de les accoutumer de bonne heure à n’admettre aucun mot sans y attacher une idée.
A l’égard des corps qui sont formés de la réunion de plusieurs substances simples, nous les avons désignés par des noms composés comme le sont les substances elles-mêmes; mais, comme le nombre des combinaisons binaires est déjà très considérable, nous serions tombés dans le désordre et dans la confusion, si nous ne nous fussions pas attachés à former des classes. Le nom de classes et de genres est, dans l’ordre naturel des idées, celui qui rappelle la propriété commune à un grand nombre d’individus; celui d’espèces, au contraire, est celui qui ramène l’idée aux propriétés particulières à quelques individus.
Ces distinctions ne sont pas faites, comme on pourrait le penser, seulement par la métaphysique; elles le sont par la nature. Un enfant, dit l’abbé de Condillac, appelle du nom d’arbre le premier arbre que nous lui montrons. Un second arbre qu il voit ensuite lui rappelle la même idée, il lui donne le même nom; de même à un troisième, à un quatrième, et voilà le mot d’arbre, donné d’abord à un individu, qui devient pour lui un nom de classe ou de genre, une idée abstraite qui comprend tous les arbres en général. Mais, lorsque nous lui aurons fait remarquer que tous les arbres ne servent pas aux mêmes usages, que tous ne portent pas les mêmes fruits, il apprendra bientôt à les distinguer par des noms spécifiques et particuliers. Cette logique est celle de toutes les sciences; elle s’applique naturellement à la chimie.
Les acides, par exemple, sont composés de deux substances de l’ordre de celles que nous regardons comme simples, l’une qui constitue l’acidité et qui est commune à tous; c’est de cette substance que doit être emprunté le nom de classe ou de genre; l’autre qui est propre à chaque acide, qui les différencie les uns des autres, et c’est de cette substance que doit être emprunté le nom spécifique.
Mais, dans la plupart des acides, les deux principes constituants, le principe acidifiant et le principe acidifié, peuvent exister dans des proportions différentes qui constituent toutes des points d’équilibre ou de saturation; c’est ce qu’on obberve dans l’acide sulfurique et dans l’acide sulfureux; nous avons exprimé ces deux états du même acide en faisant varier la terminaison du nom spécifique.
Les substances métalliques qui ont été exposées à l’action réunie de l’air et du feu perdent leur éclat métallique, augmentent de poids et prennent une apparence terreuse; elles sont, dans cet état, composées, comme les acides, d’un principe qui est commun à toutes, et d’un principe particulier propre à chacune; nous avons dû également les classer sous un nom générique dérivé du principe commun, et le nom que nous avons adopté est celui d’oxyde; nous les avons ensuite différenciées les unes des autres par le nom particulier du métal auquel elles appartiennent.
Les substances combustibles, qui, dans les acides et les oxydes métalliques, sont un principe spécifique et particulier, sont susceptibles de devenir à leur tour un principe commun à un grand nombre de substances. Les combinaisons sulfureuses ont été longtemps les seules connues en ce genre; on sait aujourd’hui, d’après les expériences de MM. Vandermonde, Monge et Berthollet, que le charbon se combine avec le fer, et peut-être avec plusieurs autres métaux; qu’il en résulte, suivant les proportions, de l’acier, de la plombagine, etc. On sait également, d’après les expériences de M. Pelletier, que le phosphore se combine avec un [175] grand nombre de substances métalliques. Nous avons encore rassemblé ces différentes combinaisons sous des noms génériques dérivés de celui de la substance commune, avec une terminaison, qui rappelle cette analogie, et nous les avons spécifiées par un autre nom, dérivé de leur substance propre.
La nomenclature des êtres composés de trois substances simples présentait un peu plus de difficultés en raison de leur nombre, et surtout parce qu’on ne peut exprimer la nature de leurs principes constituants sans employer des noms plus composés. Nous avons eu à considérer dans les corps qui forment cette classe, tels que les sels neutres, par exemple, 1° le principe acidifiant, qui est commun à tous; 2° le principe acidifiable, qui constitue leur acide propre; 3° la base saline, terreuse ou métallique, qui détermine l’espèce particulière de sel. Nous avons emprunté le nom de chaque classe de sels de celui du principe acidifiable, commun à tous les individus de la classe; nous avons ensuite distingué chaque espèce par le nom de la base saline, terreuse ou métallique, qui lui est particulière.
Un sel, quoique composé des trois mêmes principes, peut être cependant dans des états très différents, par la seule différence de leur proportion. La nomenclature que nous avons adoptée aurait été défectueuse si elle n’eût pas exprimé ces différents états, et nous y sommes principalement parvenus par des changements de terminaison, que nous avons rendue uniforme pour un même état des différents sels.
Enfin nous sommes arrivés au point que, par le mot seul, on reconnaît sur-le-champ quelle est la substance combustible qui entre dans la combinaison dont il est question; si cette substance combustible est combinée avec le principe acidifiant, et dans quelle proportion; dans quel état est cet acide; à quelle base il est uni; s’il y a saturation exacte; si c’est l’acide ou bien la base qui est en excès.
On conçoit qu’il n’a pas été possible de remplir ces différentes vues sans blesser quelquefois des usages reçus, et sans adopter des dénominations qui ont paru dures et barbares dans le premier moment; mais nous avons observé que l’oreille s’accoutumait promptement aux mots nouveaux, surtout lorsqu’ils se trouvaient liés à un système général et raisonné. Les noms, au surplus, qui s’employaient avant nous, tels que ceux de poudre d’algaroth, de sel alembroth, de pompholix, d’eau phagédénique, de turbith minéral, de colcothar, et beaucoup d’autres, ne sont ni moins durs, ni moins extraordinaires; il faut une grande habitude et beaucoup de mémoire pour se rappeler les substances qu’ils expriment, et surtout pour reconnaître àquel genre de combinaison ils appartiennent. Les noms d’huile de tartre par défaillance, d’huile de vitriol, de beurre d’arsenic et d’antimoine, de fleurs de zinc, etc. sont plus impropres encore, parce qu’ils font naître des idées fausses; parce qu’il n’existe, à proprement parler, dans le règne minéral et surtout dans le règne métallique, ni beurres, ni huiles, ni fleurs; enfin parce que les substances qu’on désigne sous ces noms trompeurs sont de violents poisons.
On nous a reproché, lorsque nous avons publié notre Essai de Nomenclature chimique, d’avoir changé la langue que nos maîtres ont parlée, qu’ils ont illustrée, et qu ils nous ont transmise; mais on a oublié que c’étaient Bergman et Macquer qui avaient eux-mêmes sollicité cette réforme. Le savant professeur d’Upsal, M. Bergman, écrivait à M. de Morveau, dans les derniers temps de sa vie: Ne faites grâce à aucune dénomination impropre: ceux qui savent déjà entendront toujours; ceux qui ne savent pas encore entendront plus tôt.
Peut-être serait-on plus fondé à me reprocher de n’avoir donné, dans l’ouvrage que je présente au public, aucun historique de l’opinion de ceux qui m’ont précédé; [176] de n’avoir présenté que la mienne, sans discuter celle des autres. Il en est réunité que je n’ai pas toujours rendu à mes confrères, encore moins aux chimistes étrangers, la justice qu’il était dans mon intention de leur rendre; mais je prie le lecteur de considérer que, si l’on accumulait les citations dans un ouvrage élémentaire, si l’on s’y livrait à de longues discussions sur l’historique de la science et sur les travaux de ceux qui l’ont professée, on perdrait de vue le véritable objet qu’on s’est proposé, et l’on formerait un ouvrage d’une lecture tout à fait fastidieuse pour les commençants. Ce n’est ni l’histoire de la science, ni celle de l’esprit humain, qu’on doit faire dans un traité élémentaire; on ne doit y chercher que la facilité, la clarté; on en doit soigneusement écarter tout ce qui pourrait tendre à détourner l’attention. C’est un chemin qu’il faut continuellement aplanir, dans lequel il ne faut laisser subsister aucun obstacle qui puisse apporter le moindre retard. Les sciences présentent déjà par elles-mêmes assez de difficultés, sans en appeler encore qui leur sont étrangères. Les chimistes s’apercevront facilement, d’ailleurs, que je n’ai presque fait usage, dans la première partie, que des expériences qui me sont propres. Si quelquefois il a pu m’échapper d’adopter, sans les citer, les expériences ou les opinions de M. Berthollet, de M. de Fourcroy, de M. de Laplace, de M. Monge, et de ceux, en général, qui ont adopté les mêmes principes que moi, c’est que l’habitude de vivre ensemble, de nous communiquer nos idées, nos observations, notre manière de voir, a établi entre nous une sorte de communauté d’opinions, dans laquelle il nous est souvent difficile à nous-mêmes de distinguer ce qui nous appartient plus particulièrement.
Tout ce que je viens d’exposer sur l’ordre que je me suis efforcé de suivre dans la marche des preuves et des idées n’est applicable qu’à la première partie de cet ouvrage: c’est elle seule qui contient l’ensemble de la doctrine que j’ai adoptée; c’est à elle seule que j’ai cherché à donner la forme véritablement élémentaire.
La seconde partie est principalement formée des tableaux de la nomenclature des sels neutres. J’y ai joint seulement des explications très sommaires, dont l’objet est de faire connaître les procédés les plus simples pour obtenir les différentes espèces d’acides connus: cette seconde partie ne contient rien qui me soit propre; elle ne présente qu’un abrégé très concis de résultats extraits de différents ouvrages.
Enfin j’ai donné dans la troisième partie une description détaillée de toutes les opérations relatives à la chimie moderne. Un ouvrage de ce genre paraissait désiré depuis longtemps, et je crois qu’il sera de quelque utilité. En général, la pratique des expériences, et surtout des expériences modernes, n’est point assez répandue; et peut-être, si, dans les différents mémoires que j’ai donnés à l’Académie, je me fusse étendu davantage sur le détail des manipulations, me serais-je fait plus facilement entendre, et la science aurait-elle fait des progrès plus rapides. L’ordre des matières, dans cette troisième partie, m’a paru à peu près arbitraire, et je me suis seulement attaché à classer dans chacun des huit chapitres qui la composent les opérations qui ont ensemble le plus d’analogie. On s’apercevra aisément que cette troisième partie n’a pu être extraite d’aucun ouvrage, et que, dans les articles principaux, je n’ai pu être aidé que de ma propre experience.
Je terminerai ce discours préliminaire en transcrivant littéralement quelques passages de M. l’abbé de Condillac, qui me paraissent peindre avec beaucoup de vérité l’état où était la chimie dans des temps très rapprochés du nôtre.1 Ces [177] passages, qui n’ont point été faits exprès, n’en acquerront que plus de force, si l’application en parait juste.
“Au lieu d’observer les choses que nous voulions connaître, nous avons voulu les imaginer. De supposition fausse en supposition fausse, nous nous sommes égarés parmi une multitude d’erreurs; et ces erreurs étant devenues des préjugés, nous les avons prises par cette raison pour des principes; nous nous sommes donc égarés de plus en plus. Alors nous n’avons su raisonner que d’après les mauvaises habitudes que nous avions contractées. L’art d’abuser des mots sans les bien entendre a été pour nous l’art de raisonner ... Quand les choses sont parvenues à ce point, quand les erreurs se sont ainsi accumulées, il n’y a qu’un moyen de remettre l’ordre dans la faculté de penser: c’est d’oublier tout ce que nous avons appris, de reprendre nos idées à leur origine, d’en suivre la génération, et de refaire, comme dit Bacon, l’entendement humain.”
“Ce moyen est d’autant plus difficile qu’on se croit plus instruit. Aussi des ouvrages où les sciences seraient traitées avec une grande netteté, une grande précision, un grand ordre, ne seraient-ils pas à la portée de tout le monde. Ceux qui n’auraient rien étudié les entendraient mieux que ceux qui ont fait de grandes études, et surtout que ceux qui ont écrit beaucoup sur les sciences.”
M. l’abbé de Condillac ajoute à la fin du chapitre V: “Mais enfin les sciences ont fait des progrès, parce que les philosophes ont mieux observé, et qu’ils ont mis dans leur langage la précision et 1 exactitude qu’ils avaient mises dans leurs observations; ils ont corrigé la langue, et l’on a mieux raisonné.”
Notes
1. Partie II, chapitre 1. ↵