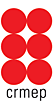Nature humaine et état de nature chez Rousseau, Kant et Fichte 1
[3]Kant et Fichte, - Fichte du moins à partir de 1794, - présentent la doctrine de Rousseau selon la formule devenue classique: les progrès de la société sont la source de la dépravation humaine; il faut, en conséquence, ramener l’homme à l’état de nature, c’est-à-dire à son état primitif d’innocence et de spontanéité. Leur critique est bien connue. Ils estiment que l’homme est par nature, ou pire que l’animal (Kant) ou semblable à lui (Fichte, à partir de 1794); que l’état de nature est le règne de la violence, de la passion déchaînée et aveugle, lutte de tous contre tous; que la vie sociale a constitué pour les individus le grand instrument de culture morale, rendant possible le développement de la vertu et la réalisation progressive du règne des fins.
En réalité, la question est plus complexe. On trouve en effet, chez Rousseau, les deux thèses contraires: celle qu’on lui reproche et celle qu’on lui oppose. Par là s’explique que les mêmes penseurs puissent apparaître tour à tour, ou même à la fois, comme des disciples ou des adversaires.
Il faut noter d’abord l’équivoque des termes nature et état de nature, car l’on peut désigner par ces vocables, soit l’homme essentiel, soit l’homme réel.
Pour Malebranche, par exemple, la nature de l’homme, c’est son essence. L’homme réel n’est que la corruption de cette nature, corruption due au péché originel. La grâce ne fait que restaurer la nature2
Pour Kant, la nature de l’homme, c’est d’abord l’homme essentiel, l’homme en tant qu’homme; ce qui l’oppose à l’animal, c’est-à-dire sa liberté, sa raison théorique et pratique. D’où les expressions[4] que Kant emploie dans les Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, de droit inné, d’égalité naturelle, fondés sur la liberté que chacun possède par cela seul qu’il est homme, et conditions suprêmes de droît naturel.3
Mais, à d’autres égards, la nature de l’homme, c’est aussi l’homme réel, après la chute; c’est-à-dire l’homme dont la liberté est radicalement pervertie; c’est en ce sens que Kant déclare l’homme mauvais par nature. Cet homme reste d’ailleurs par là différent de l’animal: cette nature réelle, accident greffé sur la nature essentielle de l’homme, fait de celui-ci un être qui ne saurait jamais être confondu ni avec la nature essentielle, ni avec la nature réelle de l’animal. Telle est la terminologie de la Religion dans les limites de la simple raison.
Or la première terminologie et la première doctrine ne contredisent pas Rousseau, les secondes au contraire lui sont radicalement opposées.
Chez Fichte, nous trouvons une amphibologie non point identique, mais équivalente. Dans les Beiträge zur Berichtigung der Urteile über die französische Revolution (1793), la nature de l’homme désigne son essence, et l’état de nature, la conformité spontanée et originaire de l’homme à cette essence: “Pour découvrir le fondement de tous les contrats, il faut concevoir l’homme comme n’étant encore lié par aucun contrat extérieur, et n’étant soumis qu’à la loi de sa nature, c’est-à-dire à la loi morale (Sittengesetz); et c’est là l’état de nature (Naturzustand)”4. Aussi Fichte repousse-t-il énergiquement l’idée kantienne d’un homme méchant par nature, et son hypothèse d’un état de nature, règne de la guerre et de la division.5 Il est donc d’accord avec Rousseau, - du moins celui des Discours, - contre Kant, en affirmant l’excellence de la nature de l’homme.
[5]Mais, en même temps, il rattache la société à la nature morale de l’homme, il ne saurait donc en faire comme Rousseau dans les Discours un instrument de dépravation. Il en fait, avec Kant, un instrument d’ordre juridique destiné à sauvegarder nos droits aliénables, et il tend à fonder, comme Kant, nos droits fondamentaux sur la morale. D’un autre côté flotte devant son esprit l’idée de l’Etat comme instrument provisoire de la liberté, destiné à mettre fin progressivement au règne de la lutte et de la guerre.6 Cette conception, - germe chez Fichte de la doctrine du Notstaat7 - tend à faire du droit, - institué par la contrainte de l’Etat, - une condition et non une conséquence de la morale, c’est-à-dire tend à instituer un concept du droit tout différent de celui de Kant. Toutefois, en faisant de la vie en société (c’est-à-dire dans un Etat, puisque l’Etat est une forme nécessaire de la société dans le phénomène) une condition de la culture morale, Fichte prend le contre-pied des thèses exposées par Rousseau dans les Discours, et s’accorde en esprit avec le Kant de l’Idée d’une histoire au point de vue cosmopolitique universel.
Toute cette confusion témoigne que Fichte n’est pas encore arrivé en 1793 à dominer et à unifier les diverses influences dont il est le jouet. En réalité son axe de référence privilégié, c’est à ce moment là, un individualisme outré dont le double fondement est la Critique de la Raison pratique et le Contrat social. C’est en rapprochant du concept kantien de l’homme, défini par la raison pratique, le concept de nature humaine décrit par Rousseau, que Fichte croit confirmer, contre Kant, la thèse de Rousseau sur l’excellence de cette nature. C’est ce même rapprochement qui le conduit à exagérer l’individualisme de Rousseau, car en donnant à l’individu, par la raison pratique, une valeur absolue, il est amené à faire de la liberté, dans chaque individu raisonnable, un pouvoir suprême que rien ne saurait dominer ou limiter. Aussi considère-t-il le Contrat social comme identique au contrat ordinaire, et laisse-t-il subsister la liberté individuelle au point que celle-ci peut remettre en question à sa guise et à chaque instant l’existence du pacte social, et fonder, en s’alliant avec d’autres, des Etats dans l’Etat, etc. Sans négliger l’importance de la société dans la culture de la liberté, Fichte estime que cette culture ne dépend ni de l’Etat, ni même de la société proprement dite, mais - en dehors de la dette contractée envers l’humanité passée, - de nous seuls.8 Le contrat civil n’a donc rien d’indispensable et l’on conçoit dans ces conditions que le concept de Notstaat ne puisse s’achever; une société peut très bien se concevoir [6] sans contrat, en vertu de la loi morale présente en tous et en chacun9 et cette antériorité de la loi morale en nous, par rapport à la société, contribue à établir l’antériorité de l’individuel par rapport au social, le caractère inconditionné de l’individu, le caractère conditionné, subsidiaire et non nécessaire du social. Tout cela explique que Fichte n’établisse pas alors, entre la nature et la société, l’antithèse vigoureuse qui est celle de Kant; et qu’il ne défende pas d’autre part la thèse inverse soutenue par Rousseau dans les Discours, et que pénétré des thèses du Contrat social, il n’aille pas toutefois jusqu’à poser comme celui-ci le contrat comme condition nécessaire de toute société valable, ni même la société en général comme condition nécessaire, sine qua non, et de la moralité et de la liberté proprement dites. Ces indécisions et ces équivoques disparaîtront dans la suite.
Dès 1794, dans la Bestimmung des Gelehrten (5e leçon), nous voyons surgir une autre définition de la nature de l’homme, et de l’état de nature. Il s’agit alors non plus de l’homme essentiel (la loi morale) mais de l’homme réel: l’homme sensible en opposition avec la loi morale, l’homme en tant que tendance naturelle, c’est-à-dire instinctif et inerte, opposé à la Raison pratique suprasensible et agissante. La nature, c’est l’animalité, et c’est la paresse: “L’homme est paresseux d’après le mode de la matière dont il est sorti.”10 Telle sera désormais la doctrine constante de Fichte. L’homme-nature, c’est l’homme livré au Natur-Trieb, étranger, donc hostile à la Loi, responsable de son animalité, car il a une liberté dont il ne s’est pas servi pour s’arracher à cet état inférieur. Et ce mal peut être dit radical, selon l’expression de Kant, mais dans un autre sens, car l’homme étant alors nature, et la nature étant force d’inertie, paresse, il y a lieu de s’attendre à ce que l’homme reste à l’état inférieur où la nature l’a placé. Doctrine d’essence leibnizienne (cf. Théodicée, § 380) que développe la Sittenlehre de 1798.11
En même temps, nous voyons apparaître une vive critique de Rousseau. En ramenant l’homme à l’état de nature, Rousseau le dépouille sans doute de ses vices, mais il le dépouille en même temps de la vertu et de la raison.12 Il s’engage par sa thèse dans une série de contradictions. Il plaide contre le progrès de la culture et pour le retour à l’état de nature, tout en dépensant une ardente activité et une immense culture à promouvoir le progrès tel qu’il le conçoit.13
[7] Cette contradiction s’explique par une autre. Contemplant la société et remarquant que l’homme contrairement à sa destinée morale est esclave de sa sensibilité, il conclut que la civilisation, développant à l’excès cette sensibilité, il faut revenir à un état où ce développement n’a pas eu lieu: l’état de nature. Il conçoit cet état comme un état de repos intérieur et extérieur, qui ne détourne plus l’homme de la voie de l’honnête, et il suppose que ce repos sera utilisé comme lui utilise le sien, c’est-à-dire en vue de l’amélioration morale de l’humanité. Supposition contradictoire, car c’est prêter là à l’homme naturel des préoccupations d’homme social et cultivé: celles de Rousseau lui-même.
Cette seconde contradiction s’explique enfin à son tour par une inversion illégitime. Plus la raison domine, plus l’homme échappe à la tyrannie des besoins, non par l’ignorance des plaisirs qu’apporte leur satisfaction, comme dans le rude état de nature, mais parce qu’il ne veut jouir qu’avec goût du meilleur, sans jamais violer ni l’honneur ni la morale. Cet état est un idéal, mais les poètes l’ont conçu comme âge d’or, et il est naturel, voire utile à l’homme, de se représenter comme passé et déjà vécu, ce qui doit être. Or cet idéal ne peut être réalisé que par l’action; et la douleur et le besoin, nous conduisant à rompre avec l’état de paresse, qui est celui de nature, sont les premiers excitants de l’action. Multiplier les besoins, c’est donc multiplier les stimulants de l’action et permettre que naisse et que s’affirme l’effort courageux et laborieux grâce auquel s’instaurera le règne de la raison et sa domination définitive sur les besoins et la souffrance. “Jouir le plus possible et agir le moins possible”, tel est le problème de la nature corrompue et ses vices sont ses tentatives pour le résoudre.14
Or de toute évidence Rousseau a traité ce problème à l’envers, puisqu’il ne pense qu’à diminuer la jouissance sans accroître l’action: “Il avait de l’énergie, mais plutôt l’énergie de la souffrance que l’énergie de l’action; il sentait fortement la misère des hommes, mais il sentait beaucoup moins les forces qui étaient en lui, capables de dominer cette misère; et ainsi il jugea les autres comme il se sentait lui-même: il exagéra la débilité de la race humaine devant la misère universelle, comme il ressentait trop sa propre faiblesse devant sa propre misère. Il calcula les souffrances; il ne calcula pas les forces que l’humanité porte en elle pour les vaincre. Paix à sa centre et bénédiction à sa mémoire! Il a agi. Il a versé le feu dans bien des âmes qui ensuite allèrent plus loin. Mais il agit sans avoir lui-même conscience de sa propre activité. Il agit sans appeler d’autres hommes à l’action, [8]" sans calculer la puissance de cette action commune contre la totalité de la souffrance et de la corruption ... Ainsi Rousseau peint la raison au repos et non au combat; il affaiblit la sensibilité au lieu de fortifier la raison.”15
Ce texte contient déjà le germe de l’interprétation du sentiment moral de Rousseau, telle que la donnera la Sittenlehre de 1798.
Toutefois le Rousseau qui est l’objet de cette critique n’est pas celui du Contrat social, celui dont Fichte était le disciple en 1793, dont il se considérait avec Kant comme le continuateur et l’héritier16; c’est comme l’indique le titre même de la 5e leçon17, le Rousseau du Discours sur les Sciences et les Arts, ou du Discours sur l’Origine de l’inégalité.
Ces deux attitudes différentes à l’égard d’un même personnage n’indiquent pas seulement une évolution dans la pensée de Fichte, mais répondent à deux aspects différents du personnage.
Que veut donc dire Rousseau lorsqu’il parle de la nature de l’homme et de l’état de nature? Désigne-t-il par là l’homme réel ou l’homme essentiel et idéal? Incontestablement, il pense à l’homme essentiel, car cet état naturel “qui n’existe plus, n’a peut-être jamais existé et n’existera peut-être jamais”, n’est pas une vérité historique, mais une hypothèse plus propre à éclairer la nature des choses qu’à en montrer la véritable origine.18 Comment déterminer cet état de nature ou homme essentiel? En s’adressant au sentiment intérieur non adultéré, en écartant tout ce que la vie sociale a pu apporter d’adventice et de pervers, en écoutant la voix de la pure conscience qui est la voix même de la nature.
Mais que nous apprend cette voix? Si l’on en croit le Discours sur les Sciences et les Arts, le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, la Lettre à Monsieur d’Alembert sur l’article Genève, l’état de nature essentiel et supérieur qu’elle nous révèle c’est le règne de la sensibilité, de la naïveté, de la simplicité, de l’ignorance; c’est aussi, si l’on en croit la Nouvelle Héloïse, celui de la spontanéïté et de [9] la profondeur de la passion; enfin c’est l’égoïsme instinctif, qui pousse l’homme à conserver son être, à satisfaire à ses besoins sans faire de mal à personne, sans rien prendre au delà de son bien; c’est une sympathie et une pitié qui le portent à aider son semblable. Cet état, antérieur au bien et au mal proprement dits, puisque la morale et la loi n’existent pas encore, puisqu’il est impossible de pécher contre elles, est en somme l’innocence de l’animal. Que surviennent ensuite la société, la raison, la réflexion, et cet égoïsme inoffensif et plein de fraîcheur fera place à l’intérêt implacable et injuste, à la brigue, à la misère, à la corruption.
Ainsi décrit, cet homme essentiel de Rousseau correspond exactement à l’homme réel de Fichte, c’est-à-dire au Natur-Trieb, à l’égoisme inconscient, antérieur au bien et au mal et qui équivaut chez l’homme à l’animalité originelle.19 Et cette nature humaine n’est originellement ni bonne ni mauvaise. Elle ne devient l’un ou l’autre que par la liberté.20 Le mal radical n’est que l’abandon à la paresse naturelle et le refus de faire usage de cette liberté pour se détacher définitivement de ce plan animal. Il ne correspond pas à l’homme essentiel de Fichte dont l’état de nature est loi morale.
Mais il ne correspond ni à l’homme essentiel, ni à l’homme réel de Kant, puisque, pour Kant, l’homme réel, méchant par nature, reste à la fois supérieur à l’animalité par son essence (liberté et raison) et inférieur à elle, de par la corruption de cette essence: la méchanceté (qui est renversement du pour au contre de la hiérarchie des principes, la raison et la liberté devenant jusque dans les formules qui leur sont propres, les instruments de la sensibilité: mensonge radical). Il est bien évident, au contraire, que le retour conscient et délibéré à la nature, telle que Rousseau l’a définie, ne peut être pour Kant qu’une manifestation de cette nature pervertie de l’homme telle que lui-même l’a conçue.
On comprend dans ce cas l’antithèse établie par Kant et par Fichte entre leurs propres doctrines et celle de Rousseau: leurs conceptions de l’idéal et des moyens aptes à le réaliser semblent être exactement opposées.
Mais avec le Contrat social nous voyons apparaître de tout autres conceptions de la nature de l’homme, et de l’état de nature. Ces conceptions sont opposées à celles qui ont prévalu jusqu’ici, et elles sont en même temps opposées entre elles.
[10](A) Par nature de l’homme, Rousseau continue toujours d’entendre l’homme essentiel, mais il définit autrement cette essence;
(B) Par état de nature au contraire Rousseau tend à concevoir un état de l’homme réel, état plus ou moins confusément représenté comme historiquement antérieur à l’état civil. Cet état de nature est partiellement décrit de la même façon qu’auparavant, comme animalité, règne de l’appétit, mais sa place dans l’échelle des valeurs semble ne plus être celle qu’il occupait jusque-là.
(A) La nature essentielle de l’homme, c’est sa liberté: “L’homme est né libre et partout il est dans les fers.”21 Cette liberté s’affirme immédiatement par la volonté générale, “cette voix céleste qui dicte à chaque citoyen les préceptes de la raison publique.”22 Cette volonté générale n’est donc pas différente au fond de celle que décrivait l’article Droit naturel de l’Encyclopédie: “la volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l’entendement qui raisonne dans le silence des passions”, article que Rousseau a critiqué. La raison en effet atteste, pour sa part, la vérité de ce que le sentiment proclame, en établissant sa nécessité pour l’homme qui se renierait en le niant. Comme l’a dit très justement M. Beauvalon: “La voix de la nature n’est que l’expression vivante au fond de notre conscience individuelle de la nécessité même que nous révèle la raison.”23
Cette définition est tout à fait différente de la première. Sans doute on peut trouver dans la pensée de Rousseau, des liens qui l’y rattachent, mais il faut bien le dire, en raison d’une certaine équivoque et insuffisante détermination de cette pensée. Par exemple, il y a une opposition entre l’essence de l’homme qui est liberté, et sa condition actuelle qui vient de la société: ‘Il est dans les fers’. On rejoint par là l’idée de l’état de nature conforme à l’essence humaine parce qu’antérieur au social. Mais cette condition actuelle tient-elle à l’essence du social, ou bien à des accidents historiques de cette essence qui sont au fond étrangers à elle? La réponse de Rousseau est catégorique: elle tient à un accident, non à la structure sociale en tant que telle : elle provient des “abus”.24 Bien mieux, cette liberté naturelle (c’est-à-dire innée) s’identifie-t-elle avec la liberté essentielle? Non point, car celle-ci réside dans la liberté civile et dans la liberté morale. La liberté morale seule rend l’homme maître de lui, [11] car l’impulsion de l’appétit est esclavage et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté.25 Par là, nous voyons la liberté naturelle qui est celle de l’homme à l’état de nature s’opposer à la liberté essentielle qui est propre à la nature de l’homme, et nature de l’homme ainsi qu’état de nature si souvent confondus se dissocier en deux concepts indépendants, voire opposés. Il n’y a donc bien aucun rapport entre la première et la seconde définition de la “nature” humaine. Mais cette absence de rapport est masquée par un certain vague de la pensée.
En second lieu, on notera que cette liberté commune a sa racine biologique dans l’instinct et que la faculté de jugement n’intervient qu’ultérieurement pour conditionner l’autonomie propre à l’homme: “Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation; ses premiers soins sont ceux qu’il se doit à lui-même; et sitôt qu’il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à le conserver, devient par là son propre maître”.26 Là encore nous pouvons trouver un autre lien avec la nature comme animalité. Mais c’est encore un lien bien ténu, car quelle que soit l’origine de cette liberté, elle se constitue ensuite comme telle en opposition avec cette nature-animalité. Aussi la nature de l’homme est-elle définie strictement non plus comme animalité, instinct, spontanéité, innocence, mais au contraire en opposition avec elle, comme liberté, raison, moralité: “Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs ... Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme; et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté.”27 Comme cette liberté morale, propre à la nature de l’homme, n’a rien de commun avec “l’impulsion du seul appétit qui est esclavage”, c’est-à-dire avec la libre spontanéité de l’animal (état de nature), on comprend, en lisant ce texte, combien Fichte pouvait, dans les Beiträge, se poser en disciple de Rousseau, quand il écrivait que “l’homme non encore lié par quelque contrat extérieur et soumis à la seule loi de sa nature”, était gouverné par la loi morale et que c’était là son “état de nature” (surtout si l’on se souvient que l’autonomie de la volonté kantienne a pour origine le concept de volonté générale). On le comprend d’autant mieux lorsqu’on voit la société apparaître chez Rousseau comme la condition de cette instauration de la nature de l’homme, en opposition avec un état de nature où l’homme, resté au stade de l’animalité, n’a pas réalisé sa vraie nature. Et cette société n’est pas simplement la société idéale telle qu’elle peut être conçue in abstracto et a priori mais, ainsi qu’on va le voir, la société réelle historiquement considérée.
[12](B) Il y a donc un “état de nature” qui est contraire à “la nature de l’homme” et qui est inférieur à l’état social où se réalise l’homme essentiel. Cet état de nature semble devoir être conçu comme impliquant plusieurs phases ou plusieurs aspects, mais ce qu’il y a de sûr, c’est qu’il n’est défini que par son antériorité à tout état social: “Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de nature l’emportent par leur résistance, sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état ne peut plus subsister; et le genre humain périrait s’il ne changeait sa manière d’être.”28 L’état de nature est donc conçu comme évoluant jusqu’à un certain stade où il doit nécessairement faire place à l’état de société, grâce auquel l’homme peut continuer de subsister. Mais cet état social inéluctable va-t-il dégrader ou améliorer la nature humaine? Il y a là une double question, philosophique et historique. Au point de vue philosophique, la réponse sera: elle la dégradera, si la société est réalisée selon de faux principes, elle ne la dégradera pas, si elle est réalisée selon des principes rationnels. C’est là un problème de droit qui conduit à la détermination a priori des conditions d’une société idéale, c’est le problème essentiel traité dans l’ouvrage. Au point de vue historique, Rousseau pouvait s’abstenir de répondre. Il a toutefois déjà répondu dans ses Discours par l’affirmative: en fait, la vie sociale corrompt l’homme et cette réponse semblait même ne guère faire prévoir la possibilité d’une forme de vie sociale apte à éviter cette corruption. Il répond de nouveau dans le Contrat social, mais d’une façon toute différente: en fait la vie sociale a de bonnes conséquences, car le fait suppose le droit, car, en fait, les clauses rationnelles supposées par le Contrat social, “bien qu’elles n’aient peut-être jamais été formellement énoncées, sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues.”29 Comment le fait social, entendu historiquement, ne serait-il pas, en effet, conforme en gros aux “réquisits” de la société rationnellement conçue? N’est-il pas évident que l’essence du social est la condition sine qua non de la réalité du social? Ainsi la réponse favorable donnée à la question de droit entraîne quasi nécessairement une réponse favorable à la question de fait, sous réserve, bien entendu, des contingences et des accidents (“les abus”) dont l’histoire peut grever l’essence qu’elle réalise. De même, la condamnation portée dans les deux Discours sur le fait social historiquement considéré, sous-entendait une condamnation de principe de l’état social envisagé dans son essence.
En effet, dans le Discours sur l’Origine de l’inégalité parmi les hommes la société apparaît non seulement en fait, mais dans son essence [13] comme le mal, par rapport à l’état de nature. Les causes fortuites qui seules pouvaient mettre fin à cet état pour promouvoir ce qu’on appelle les “vertus morales” n’ont fait en somme que “perfectionner la raison humaine en détériorant l’espèce, et rendre un être méchant en le rendant sociable.”30 Sociabilité et esclavage sont synonymes: “En devenant sociable et esclave, il [l’homme] devient faible, craintif et rampant ...”31 “Le sauvage vit en lui-même; l’homme sociable toujours hors de lui, ne sait vivre que dans l’opinion des autres; là est la source de l’honneur sans vertu, de la raison sans sagesse, du plaisir sans bonheur.”32 Ce qui est incriminé, ce n’est pas seulement la société telle que nous la voyons, mais la sociabilité dans son principe. Les “abus” au lieu d’apparaître comme les accidents fréquents, mais contingents, d’une institution par essence excellente, apparaissent au contraire comme la propriété congénitale, consubstantielle et nécessaire de cette détestable essence. La société est tout entière le domaine du vice: “Les vices qui rendent inéluctables les institutions sociales sont les mêmes qui en rendent l’abus inéluctable ...”33
Sans doute, Rousseau nous parle-t-il, à la fin de son Discours, du contrat social qui établit l’institution du “pouvoir légitime”, lequel “mit fin par de sages lois” à “cet horrible état de guerre” où sombrait “la société naissante”, après l’institution de la propriété. Sans doute, ce pacte fondamental est-il la base de la meilleure des sociétés; sans doute, lorsqu’il est violé et que “le despotisme élève sa tête hideuse, tout ce qu’il y a de bon et de sain dans toutes les parties de l’Etat est dévoré; sont foulés aux pieds les lois et le peuple”: et “s’évanouissent les notions de bien et les principes de la justice.”34Sans doute, la destruction du despotisme et le retour au pouvoir légitime défini par le contrat peuvent-ils apparaître comme l’idéal auquel il faut se résigner à convier les hommes. Il n’empêche que la société légitime définie par le contrat reste le mal et le principe du mal. Ce principe ne réside pas, en effet, dans le pouvoir arbitraire, qui n’en est au contraire que la conséquence extrême; mais dans la “société légitime”. Car elle seule est et peut être le fondement premier de l’inégalité, le contrat étant probablement en fait l’origine historique, ou en tout cas certainement en droit le fondement logique premier de la société historiquement - [14] considérée: “Il me paraît donc certain que non seulement les gouvernements n’ont point commencé par le pouvoir arbitraire qui n’en est que la corruption, le terme extrême .... mais encore que, quand même ils auraient ainsi commencé, ce pouvoir étant par sa nature illégitime n’a pas servi de fondement aux droits de la société, ni par conséquent à l’inégalité d’institution.”35 Le cycle de la société, ouvert par le Contrat social, est donc un véritable cycle infernal dont l’homme ne pourra jamais sortir, puisqu’il ne pourra jamais revenir à l’état de nature primitif: “Si nous suivons le progrès de l’inégalité dans ces différentes révolutions, nous trouverons que l’établissement de la loi et du droit de propriété fut son premier terme, l’institution de la magistrature le second, que le troisième et dernier fut le changement du pouvoir légitime en pouvoir arbitraire; en sorte que l’état de riche et de pauvre fut autorisé par la première époque, celui de puissant et de faible par la seconde, et par la troisième celui de maître et d’esclave, qui est le dernier degré de l’inégalité, et le terme auquel aboutissent enfin tous les autres, jusqu’à ce que de nouvelles révolutions dissolvent tout à fait le gouvernement ou le rapprochent de l’institution légitime.”36 Si ce cycle apparaît comme un fait dans le temps, historiquement constaté, il se manifeste aussi, comme un éternel retour, d’inspiration platonicienne, prévisible a priori. Il est à la fois logiquement nécessaire et psychologiquement inéluctable: “la connaissance du coeur humain” pouvait le faire “prévoir avant que l’expérience l’eût montré.”37
Aussi, de par son essence, la société est-elle dans son existence condamnée à osciller au cours de l’évolution historique entre le moindre mal (le pouvoir légitime fondé sur un juste et libre contrat) et le terme extrême du mal (le despotisme). Le despotisme “est le dernier terme de l’inégalité, et le point extrême qui ferme le cercle et touche au point d’où nous sommes partis: c’est ici que tous les particuliers redeviennent égaux, parce qu’ils ne sont rien et que les sujets n’ayant plus d’autre loi que la volonté du maître, ni le maître d’autre règle que ses passions, les notions du bien et les principes de la justice s’évanouissent derechef: c’est ici que tout se ramène à la seule loi du plus fort et par conséquent à un nouvel état de nature différent de celui par lequel nous avons commencé, en ce que l’un était l’état de nature dans sa pureté et que ce dernier est le fruit d’un excès de corruption.”38 L’idéal d’une société légitime fondée sur le contrat social ne saurait donc avoir pour objet de nous ramener à l’état de [15] nature primitif, ni nous conduire à un état de nature artificiel, qui consiste dans le despotisme, qui n’a de commun avec le premier que la loi du plus fort et qui s’oppose à lui en ce qu’au lieu d’être le règne de la bonté naive, il est celui du vice et de la pleine dégradation. La thèse du Discours est donc diamétralement opposée à celle du Contrat social. Sans doute voyons-nous dès cette époque Rousseau distinguer différents états de nature très distincts de l’état de nature primitif: l’état de nature (état de guerre de tous contre tous) qui suit l’instauration de la propriété et qui précède l’institution du contrat,39 l’état de nature despotique qui suit la violation ou la corruption du contrat, etc. Ce polymorphisme de l’état de nature peut sans doute faciliter un glissement de la doctrine vers les thèses du Contrat social, mais il ne saurait logiquement ou philosophiquement les autoriser ni les justifier.
Dans le Contrat social, en effet, non seulement le passage de l’état de nature à l’état social ne dégrade pas la nature de l’homme, mais il est la condition de sa pleine réalisation. Si bien que l’état de nature apparaît maintenant comme un état inférieur au regard de l’état social, et comme opposé à la nature de l’homme tout autant que l’instinct ou l’appétit sont opposés à la liberté: “Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C’est alors seulement que la voix du devoir succédant à l’impulsion physique et le droit à l’appétit, l’homme qui jusque-là n’avait regardé que lui-même, se voit forcé d’agir sur d’autres principes et de consulter sa raison avant d’écouter ses penchants. Quoiqu’il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu’il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s’exercent et se développent, ses idées s’étendent, ses sentiments s’ennoblissent, son âme tout entière s’élève à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l’instant heureux qui l’en arracha pour jamais, et qui d’un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme.”40 Loin de “dégrader”, la société ennoblit, et non pas seulement la société idéale, mais la société réelle dont l’avènement historique, malgré les “abus”, inévitables accidents d’une essence excellente, marque “un instant heureux” qui “doit être béni”; par elle seule, l’homme réalise sa nature d’homme, et est arraché à “l’animalité stupide” de l’état de nature. Loin de ramener l’homme à la nature, conçue comme l’état d’innocence originaire, la société établit un ordre infiniment supérieur à elle. Et ceci s’avère encore par ce trait que le système social ne doit pas simplement [16] restaurer l’égalité naturelle, mais créer une égalité supérieure au-dessus des inégalités que la nature mettait entre les hommes: “Au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’ inégalité physique entre les hommes, et pouvant être inégaux en force et en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit.”41
On conçoit dans ces conditions que le langage de Rousseau puisse s’accorder pleinement avec le langage de philosophes comme Kant et Fichte qui mettent dans l’essence morale de l’homme sa caractéristique fondamentale et voient dans la société (outre son rôle juridique), soit la condition du respect réel de sa dignité morale et la sauvegarde de ses droits inaliénables sans lesquels son action morale devient impossible, soit l’instrument même de la réalisation de ses fins morales.
Mais on conçoit aussi que ces penseurs aient pu être troublés par l’opposition intime que révèlent les thèses de Rousseau, selon qu’on envisage les Discours, ou le Contrat social, - et surtout par le manque de détermination dans les concepts, lequel permet d’établir dans la confusion une conciliation équivoque entre deux aspects inconciliables en droit. Car il va de soi que, si la connaissance des versions primitives du Contrat social42 peut nous permettre d’apercevoir, avec l’évolution de la pensée de Rousseau, un lien psychologique entre ses premières et ses secondes théories, celui-ci ne saurait nullement suppléer au lien logique et tenir lieu de conciliation philosophique valable.
L’intuition de cette équivoque fondamentale inspire peut-être pour une part le remarquable jugement que Fichte porte sur Rousseau dans la Sittenlehre de 1798. Ce qui caractérise en effet Rousseau, estime alors Fichte, c’est le mélange de deux ordres, non seulement distincts mais opposés: à savoir la nature (au sens d’état de nature et d’animalité) et la conscience morale; voilà pourquoi Rousseau déclare que la conscience est à la fois divine et naturelle, pourquoi il est convaincu qu’elle s’exprime par un sentiment obscur, - qui se réfère à la nature, - mais qu’elle exprime la raison, - qui dépasse la nature. Et par là il est impossible à Fichte d’assigner à la pensée de Rousseau sa place [17] exacte dans la hiérarchie des réflexions qui conduisent à la conscience morale achevée.
La conscience morale, selon Fichte, c’est au point de vue formel, la prescription d’agir rationnellement et par clair concept, car une action n’est vraiment libre, et par conséquent morale, que lorsqu’elle n’est pas dictée par la tendance, mais voulue par une intelligence devenue capable - grâce à une libre réflexion - de s’élever à un concept absolument au-dessus de toute nature et de toute tendance. Or, le fond primitif de cette conscience, c’est la tendance absolue vers l’absolu, qui, d’abord divisée en tendance objective (nature) et tendance subjective (activité libre du moi), se réunit de nouveau, à elle-même, lorsqu’elle atteint un degré supérieur de la réflexion. Elle est alors tendance morale. Cette tendance morale reçoit de la tendance objective un contenu, d’où l’impératif: “Réalise la liberté (in concreto)”, et de la tendance subjective sa forme, d’où l’impératif: “Agis avec liberté.” Ces deux impératifs s’unissent dans ce commandement: “Agis avec liberté pour réaliser la liberté.” De là résulte que je ne saurais agir moralement, si je réalisais le contenu en négligeant la forme, et croyais pouvoir réaliser la liberté sans agir librement (pas plus d’ailleurs que si j’observais la forme en négligeant le contenu, ce qui constitue une critique de Kant). Puis donc que la tendance morale prescrit l’action libre, elle prescrit du même coup que nous n’agissions pas sous l’empire de la tendance, et elle n’a donc de causalité que dans la mesure où elle n’en n’a pas comme tendance. Pour cela, elle demande que l’on prenne conscience de la liberté et du devoir de façon à ce que nous agissions, non par tendance, mais en vertu de cette seule conscience qui est conscience morale. Elle s’adresse donc à l’intelligence et lui commande d’être indépendante comme intelligence, ce qui n’est possible que si celle-ci se détermine uniquement par un concept indépendamment de toute impulsion aveugle; que si la conscience morale ne se manifeste plus comme un instinct, mais comme conscience claire d’un principe a priori. Alors elle se manifeste avant l’action, pour la prescrire, et non pas seulement après elle, comme remords ou contentement.43
Il est facile maintenant de voir à quel stade, selon Fichte, en est resté Rousseau. Certes, Rousseau a dépassé les stades de l’animalité pure et de l’animalité intelligente, de l’hédonisme et de l’eudémonisme. Mais il en est resté au stade de la tendance morale. Ainsi s’expliquent ses traits contradictoires: d’une part, par le côté tendance de sa conscience morale il appartient encore à la nature: et c’est l’obscurité du sentiment de la conscience, “instinct divin” c’est le caractère impulsif de l’acte, c’est l’absence de maximes a priori, c’est [18] l’appel à la nature, etc.; d’autre part, par le côté moral de cette tendance et le commandement qu’elle implique, il appartient déjà au plan supérieur à celui de la nature; c’est l’appel à la liberté, à la bonté; c’est la reconnaissance de la vraie dignité de l’homme comme liberté et raison (par opposition à la nature et à l’appétit), etc. A ce stade en effet, l’homme a réfléchi sur sa spontanéité fondamentale, mais sans conscience, ni intuition expresses; et il reste poussé par une tendance aveugle. Comme disait déjà Fichte, dans la Bestimmung des Gelehrten: “Il [Rousseau] avoir sans avoir conscience lui-même de sa propre activité”. La conscience est alors impuissante à s’exprimer comme raison commandant par un clair concept a priori et l’acte moral sort d’une impulsion analogue à celle de la nature, et non d’une maxime qui, à ce stade, existe pourtant dans l’homme, mais inconsciemment. Alors, on ne veut pas être juste, mais magnanime et généreux, ni respectueux, mais bienveillant. N’étant pas déduits d’un concept, mais engendrés par la tendance, nos actes nous apparaissent après coup comme un donné que l’on cherche alors à rattacher à une maxime: ils nous surprennent par la bonté qu ’ils révèlent et nous éprouvons à leur propos cette joie que nous apportent les évènements inespérés. Nous nous jugeons, en conséquence, meilleurs que tout, au lieu de nous apercevoir tels que nous devons être. Nous considérons ces actes comme des opera supererogativa et non comme des actions simplement requises par le devoir. Telle est l’origine de la doctrine de Rousseau sur la bonté originelle de l’homme, alors qu’originellement l’homme n’est ni bon, ni méchant, mais devient l’un ou l’autre par sa liberté.44
Par cet essai pour préciser l’exacte mesure de la pensée de Jean-Jacques Rousseau en l’insérant dans les concepts de son propre système, Fichte réussit, semble-t-il, à rendre parfaitement sensible tout ce que celle-ci renferme de mixte, d’équivoque et d’inachevé. Il croit apporter ainsi la démonstration définitive de ce qu’il avançait dans la Bestimmung des Gelehrten: “Nous résoudrons la contradiction où Rousseau s’est impliqué. Nous comprendrons Rousseau mieux qu’il ne s’est compris lui-même et le mettrons ainsi en complet accord avec lui-même et avec nous … Rousseau n’a pas tiré son affirmation d’un principe supérieur, par un simple raisonnement, car il n’est d’aucune façon parvenu jusqu’aux principes fondamentaux du savoir humain et paraît bien ne jamais s’être le moindrement du monde occupé d’une telle question. Ce que sa doctrine recèle de vrai repose de façon immédiate sur son sentiment; mais sa connaissance porte la tare de toute connaissance fondée sur un simple sentiment non analysé: elle est pour une part incertaine, parce qu’on ne peut entièrement rendre raison de son sentiment; elle est pour une autre part mélangée de vrai et de faux, car elle établit sans cesse une équivalence entre le sentiment [19] inanalysé et un jugement bien fondé qui pourtant ne lui est pas équivalent. Sans doute, le sentiment ne commet jamais d’erreur, mais le jugement en commet une lorsqu’il caractérise le sentiment d’une façon inexacte et prend un sentiment mixte (gemischtes) pour un sentiment pur.”
Notes
1. Nous remercions Monsieur M. Guéroult d’avoir bien voulu nous autoriser à publier le texte de cet article (paru pour la première fois en mai-juin 1941, dans la Revue Philosophique) et d’y avoir apporté des corrections de détail. ↵
2. Malebranche, Recherche de la Vérité, L.V. ch. 1, éd. J. Simon, IV, p. 134-135. ↵
3. Kant, Rechtslehre, Einleitung (Werke, éd. Moses Baumann, t. V), p. 38 sqq. - Nous négligeons dans cet article, les autres sens du mot naturel (par opposition à surnaturel, par analogie avec les objets des sciences naturelles, etc.). ↵
4. Fichte, Beiträge (S.W., VI), p. 82. ↵
5. Ibid., p. 129. “Cette vieille idée d’un état de nature, cette guerre de tous contre tous qui y serait de droit, ce droit du plus fort qui devrait régner sur ce sol, tout cela est faux.” – Voir aussi p. 130: “Je sais que vous ne manquez jamais d’en appeler à la méchanceté originelle de l’homme, chose dont je ne puis me convaincre.” ↵
6. Ibid., p. 102. ↵
7. Notion dont Schiller a la paternité. ↵
8. Beiträge, p. 90 spp. – “Kultur geben kann weder die erstere (die Gesellschaft), noch der zweite (der Staat).” Ibid., p. 139. Voir aussi p. 140 sqq. ↵
9. Beiträge, p. 128 sqq. ↵
10. Die Bestimmung des Gelehrten (S.W., VI), p. 341. ↵
11. Sittenlehre (1798) (S.W., IV), p. 198 sqq. ↵
12. Die Bestimmung des Gelehrten, p. 340-341. ↵
13. Ibid, p. 336. ↵
14. Ibid, p. 337-344. ↵
15. Ibid, p. 344-345. ↵
16. Beiträge, p. 71-72. ↵
17. Prüfung der Rousseauischen Behauptungen aber den Einfluss der Künste und Wissenschaften an das Wohl der Menschheit ↵
18. Rousseau, Discours sur l’Origine de l’inégalité, p. 230. ↵
19. Fichte, Sittenlehre, 1798, p. 178. ↵
20. Ibid, p. 188. ↵
21. Rousseau, Contrat social, t. I, ch. 1, p. 119. ↵
22. Article ‘Economie politique’, et manuscrit des Institutions politiques. ↵
23. Editions Beaulavon du Contrat social, Introduction, p. 21. ↵
24. Rousseau, Contrat social, I. I., ch. VIII, p. 148. ↵
25. Ibid, p. 149. ↵
26. Rousseau, Contrat social, I. I., ch. 2, p. 121. ↵
27. Ibid., I. I., ch. 4, p. 129. ↵
28. Ibid., ch. 6, p. 137. ↵
29. Ibid., I., ch. 4, p. 138-138. ↵
30. Discours sur l’Origine de l’inégalité (éd. Mussel-Pathay, 1823), 1ère partie, p. 270. ↵
31. Ibid., p. 235. ↵
32. Ibid., 2è partie, p. 317. ↵
33. Discours, ibid., p. 290, 304, 314. ↵
34. Ibid. ↵
35. Ibid. ↵
36. Ibid., p. 308-309. ↵
37. Ibid., p. 305. ↵
38. Ibid., p. 314. ↵
39. Ibid., p. 290. ↵
40. ,Contrat social, I. I., ch. VIII, p. 147-148. ↵
41. Contrat sociale I. I., ch. 9, p. 153-154.Remarquons que quel que soit le sens de l’expression état de nature dans le Contrat, elle est toujours prises dans un sens péjoratif, représentant un degré plus ou moins accusé d’animalité en face de l’état civil seul apte à instaurer l’humanité et la dignité. ↵
42. Y. Dreyfus-Brisac, Le Contrat social, édition comprenant les versions primitives de l’ou¬vrage (Paris, Alcan, 1896). ↵
43. Sittenlehre, p. 122-156. ↵
44. Sittenlehre, p. 177-178; 181-191. ↵