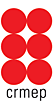Quatre essais moraux et politiques
Des premiers principes du gouvernment (1742)
Rien ne paraît plus surprenant, à qui considère les choses humaines d’un oeil philosophique, que la facilité avec laquelle la minorité gouverne le grand nombre, et l’aveugle soumission avec laquelle les hommes sacrifient leurs propres sentiments et passions à ceux de leurs gouvernants. Si nous recherchons comment se fait cette chose merveilleuse, nous verrons que, la Force étant toujours du côté des gouvernés, les gouvernants n’ont d’autre soutien que l’opinion. C’est donc sur l’opinion seule que le gouvernement est fondé; et cette maxime s’applique aux gouvernements les plus despotiques et les plus militaires aussi bien qu’aux plus libres et aux plus populaires. Le sultan d’Egypte, ou l’empereur de Rome, pouvaient bien forcer leurs innocents sujets, comme des bêtes brutes, à aller contre leurs sentiments et leur penchant, encore faut-il, au moins, qu’ils aient entraîné, l’un ses mameluks, l’autre ses cohortes prétoriennes, comme des hommes, par l’opinion.
Il y a deux sortes d’opinion, à savoir, l’opinion d’INTERÊT et l’opinion de DROIT. Par opinion d’intérêt, j’entends principalement le sentiment de l’avantage général qui résulte de tout gouvernement, joint à la conviction que le gouvernement particulier qui est présentement établi offre autant d’avantage qu’aucun autre gouvernement qui puisse être facilement installé. Cette opinion, lorsqu’elle prévaut dans l’ensemble d’un état, ou du moins parmi ceux qui détiennent la force, donne une grande sécurité au gouvernement.
Le droit est de deux sortes: droit de POUVOIR et droit de PROPRIÉTÉ. Pour comprendre quelle efficacité possède sur l’humanité la première de ces opinions, il n’y a qu’à considérer l’attachement qu’ont toutes les nations pour leur ancien gouvernement, et pour les noms même qui ont reçu la sanction de l’antiquité. L’antiquité engendre toujours l’opinion de droit; et, quelque mal que l’on puisse penser de l’humanité, on a toujours vu les hommes prodiguer leur sang aussi bien que leur fortune pour soutenir la justice publique.1 Il est [76] vrai qu’à première vue, la disposition de l’esprit humain n’apparaît jamais plus contradictoire que sur ce point précis. Lorsque les hommes agissent au sein d’une faction, ils sont prêts, sans honte ni remords, à fouler aux pieds toutes les lois de l’honneur et de la moralité afin de servir leur parti; et pourtant, lorsque les factions se forment autour d’un point de droit ou d’un principe, jamais, en aucune occasion, les hommes ne manifestent une plus grande opiniâtreté et un sentiment plus résolu de la justice et de l’équité. C’est la même disposition de l’humanité, disposition à la société, qui est cause de ces aspects contradictoires.
On voit de reste que l’opinion du droit de propriété est d’importance dans tout ce qui concerne le gouvernement. Un auteur connu a fait de la propriété le fondement de tout gouvernement, et la plupart de nos écrivains politiques semblent disposés à le suivre sur ce chapitre. C’est aller trop loin, mais il faut bien reconnaître que l’opinion du droit de propriété a une grande influence en cette matière.
C’est donc sur ces trois opinions, d’intérêt public, de droit de pouvoir et de droit de propriété que sont fondés tous les gouvernements, ainsi que toute autorité exercée par une minorité sur un grand nombre de gens. Il est vrai qu’il y a d’autres principes qui viennent renforcer ceux-ci, et déterminer, limiter ou altérer leurs opérations: tels sont l’intérêt propre, la crainte et l’affection. Mais encore pouvons-nous affirmer que ces autres principes ne peuvent avoir, à eux seuls, aucune influence, et supposent l’influence préalable des opinions dont j’ai fait mention ci-dessus. Il faut donc les considérer, non comme les principes originaires, mais comme les principes secondaires du gouvernement.
Car, premièrement, en ce qui concerne l’intérêt propre, par quoi j’entends l’attente de profits particuliers, distincts de la protection générale que nous procure le gouvernement, il est clair que, si l’autorité du magistrat n’est pas préalablement établie, ou du moins escomptée, cette attente ne saurait avoir lieu. La perspective du profit peut augmenter l’autorité du magistrat vis-à-vis de certains particuliers, mais ne peut jamais la faire naître vis-à-vis du public. C’est de leurs amis et relations que les hommes attendent naturellement les plus grands bienfaits; c’est pourquoi les espérances d’un nombre considérable de gens dans l’état ne sauraient jamais se concentrer sur un groupe déterminé de particuliers, si ces hommes n’avaient d’autre titre à la magistrature et n’exerçaient une influence différente, et indépendante, sur les opinions de l’humanité. On peut étendre la même observation aux deux autres principes de la crainte et de l’affection. On n’aurait aucune raison de craindre la fureur d’un tyran s’il ne tirait son autorité que de la crainte qu’il inspire; car, en tant qu’homme singulier, sa force corporelle se réduit à peu de chose, et tout le pouvoir qu’il possède en sus doit être fondé ou bien sur notre propre opinion, ou bien sur celle que nous présumons qu’en ont les autres. Et bien que l’affection que l’on porte à la sagesse et à la vertu rencontrées chez un souverain s’étende fort loin et ait une grande influence, il faut pourtant le supposer d’avance revêtu d’un caractère public, autrement l’estime du public ne lui serait d’aucun secours et sa vertu n’aurait d’influence que fort limitée.
Un gouvernement peut subsister durant plusieurs générations alors même que la balance n’est pas égale entre le pouvoir et la propriété. Cela se voit [77] principalement là où une classe ou un ordre de la société possède une grande part de la richesse, mais se trouve, de par la constitution originaire du gouvernement, n’avoir aucune part du pouvoir. Sous quel prétexte un individu de cette classe s’arrogerait-il l’autorité dans les affaires publiques? Les hommes étant généralement très attachés à leur ancien gouvernement, on ne doit pas attendre que le public favorise jamais de telles usurpations. Mais là où la constitution originaire accorde une part du pouvoir, même limitée, à un ordre possédant une grande part de la richesse, il est facile à celui-ci d’étendre peu à peu son autorité, et d’amener la balance du pouvoir à coïncider avec la balance de la propriété. Ce fut le cas de la Chambre des Communes en Angleterre.
La plupart des écrivains qui ont traité du gouvernement britannique ont supposé que, comme la chambre basse représente toutes les communes de Grande-Bretagne, son poids dans la balance est proportionnel à la richesse et au pouvoir de tous ceux qu’elle représente. Mais on ne doit pas tenir ce principe pour absolument vrai. Car, quoique le peuple soit disposé à s’attacher à la chambre des communes plus qu’à tout autre organe de la constitution, car il choisit cette chambre comme son représentant et le gardien public de sa liberté, il est pourtant arrivé que la chambre, lors même qu’elle s’opposait à la couronne, n’ait pas été suivie par le peuple: la chambre tory qu’il y eut sous le règne du roi Guillaume nous en donne un exemple particulièrement frappant. Cela changerait du tout au tout si les membres de la chambre étaient obligés de prendre des instructions de leurs mandataires, comme le sont les députés de Hollande; et si l’on mettait dans la balance un pouvoir et des richesses aussi immenses que ceux de toutes les communes de Grande-Bretagne, il est difficile de penser que la couronne pût avoir quelque influence sur cette multitude ou résister contre une richesse si supérieure à la sienne. Il est vrai que la couronne a une grande influence sur le corps collectif au cours de l’élection des membres de la chambre; mais si cette influence, qui pour le moment ne s’exerce qu’une fois tous les sept ans, devait être employée à convertir le peuple à chaque suffrage, elle serait bientôt réduite à rien; et ni habileté, ni popularité, ni revenu ne pourraient lui servir de soutien. Il me faut donc penser qu’un changement sur ce chapitre entraînerait un changement total de notre gouvernement, et le réduirait bientôt à une république pure et simple, et peut-être à une république d’une forme assez passable. Car, bien que le peuple, réuni en un corps comme les tribus romaines, soit tout à fait impropre au gouvernement, il est cependant, une fois dispersé en plusieurs petits corps, plus capable de raison et d’ordre; la violence des courants et marées populaires est, dans une large mesure, brisée, et l’on peut rechercher l’intérêt public avec méthode et constance. Mais à quoi bon spéculer plus longuement sur une forme de gouvernement qui ne doit vraisemblablement jamais avoir lieu en Grande-Bretagne, et à laquelle, semble-t-il, n’aspire aucun de nos partis. Chérissons plutôt le gouvernement que nous ont transmis nos ancêtres, et perfectionnons-le, autant que possible, sans encourager de passion pour de telles nouveautés, qui sont toujours dangereuses.
De l’origine du gouvernement (1742)
L’homme, naissant au sein d’une famille, est contraint de participer au maintien de la société par nécessité, par inclination naturelle et par habitude. Cette même créature, au cours de son progrès ultérieur, est obligée de fonder une société politique en vue d’administrer la justice, sans laquelle il ne peut y avoir parmi les hommes ni paix, ni sécurité, ni commerce mutuel. Il nous faut donc considérer que tout le vaste appareil de notre gouvernement n’a finalement pour objet et pour but que de rendre la justice ou, en d’autres termes, d’assister les douze juges. Rois et parlements, flottes et armées, officiers de justice et du trésor, ambassadeurs, ministres et conseillers privés, tous sont à la fin subordonnés à cette partie de l’administration. On peut même considérer avec raison que le clergé, que ses devoirs entraînent à inculquer la moralité, trouve là la seule utilité de son institution au regard de notre monde.
Tous les hommes sont sensibles à la nécessité de la justice pour maintenir la paix et l’ordre; et tous les hommes sont sensibles à la nécessité de la paix et de l’ordre pour le maintien de la société. Pourtant, malgré cette forte et évidente nécessité, telle est la faiblesse ou la perversité de notre nature! il est impossible de retenir les hommes, avec confiance et sans faillir, sur les chemins de la justice. Il peut survenir certaines circonstances extraordinaires où un homme trouve que la fraude et la rapine favorisent plus ses intérêts que ne les lèse la brèche réalisée au sein de l’union sociale par son injustice. Mais bien plus souvent, il se trouve détourné de ses intérêts éminents et importants, mais éloignés, par la séduction de tentations présentes, quoique souvent très frivoles. On ne peut guérir la nature humaine de cette grande faiblesse.
Les hommes doivent donc s’employer à atténuer ce qu’ils ne peuvent guérir. Ils sont obligés d’instituer certains personnages, sous le nom de magistrats, dont la charge propre est de manifester les arrêts de la justice, de punir les infractions, de corriger la fraude et la violence, et d’obliger les hommes, si mal disposés qu’ils soient, à consulter leurs intérêts réels et permanents. En un mot, l’Obéissance est un nouveau devoir qu’il faut inventer pour appuyer le devoir de Justice, et les liens de l’équité doivent être confirmés par ceux de la soumission.
[80]Mais encore pourrait-on penser, à examiner abstraitement ces questions, qu’on ne gagne rien à cette addition, et que, par sa nature même qui est d’être factice, le devoir d’obéissance offre à l’esprit humain un soutien aussi faible que le primitif et naturel devoir de justice. Intérêts particuliers et tentations présentes peuvent les vaincre, aussi bien l’un que l’autre. Ils sont également exposés au même inconvénient. Et de plus, l’homme qui est disposé à être un mauvais voisin est nécessairement amené par les mêmes motifs, bien ou mal conçus, à être un mauvais citoyen et un mauvais sujet. Sans compter qu’il peut souvent se faire que le magistrat soit lui-même négligent, partial ou injuste dans l’exercice de sa charge.
L’expérience prouve cependant qu’il y a une grande différence entre ces deux cas. Il nous apparaît que l’ordre est bien mieux maintenu dans la société par le moyen du gouvernement, et que les principes de la nature humaine garantissent plus rigoureusement notre devoir envers le magistrat que notre devoir envers nos concitoyens. L’amour de la puissance est si fort dans le coeur de l’homme qu’il ne manque pas de gens non seulement pour acquiescer à tous les dangers, corvées et soucis du gouvernement, mais encore pour les solliciter; et, une fois parvenus à cette condition élevée, bien qu’ils soient souvent égarés par des passions privées, ces hommes trouvent généralement un intérêt manifeste à rendre une justice impartiale. Les personnes qui acquièrent d’abord cette distinction par le consentement, tacite ou exprès, du peuple, doivent être douées de supériorités personnelles, en courage, force, intégrité ou prudence, qui commandent le respect et la confiance; et, une fois le gouvernement établi, c’est la considération de la naissance, du rang et de la condition qui a une puissante influence sur les hommes, et vient renforcer les arrêts du magistrat. Le prince ou le chef s’élève contre tout désordre qui trouble sa société. Il appelle tous ses partisans et tous les hommes de bien à l’aider à les corriger et à y mettre bon ordre: il est suivi avec empressement par toutes les personnes neutres dans l’exercice de sa charge. Il obtient bientôt le pouvoir de récompenser ces services, et, au cours du progrès de la société, il institue des ministres subordonnés et, souvent, une force militaire, qui trouvent un intérêt immédiat et évident à soutenir son autorité. L’habitude vient bientôt consolider ce que d’autres principes de la nature humaine n’avaient qu’imparfaitement fondé, et, une fois accoutumés à l’obéissance, les hommes n’ont jamais l’idée de s’écarter du chemin où ils ont, eux et leurs ancêtres, constamment marché et où les retiennent tant de motifs pressants et manifestes.
Certes, ce progrès dans les affaires humaines peut sembler certain et inévitable, et le soutien que l’obéissance apporte à la justice est fondé sur des principes évidents de la nature humaine; mais il ne faut pas s’attendre à ce que les hommes soient capables, par avance, de les découvrir et de prévoir comment ils opèrent. Les commencements du gouvernement sont plus fortuits et moins parfaits. Il est probable que, la première fois où un homme acquit de l’ascendant sur des multitudes, ce fut pendant un état de guerre, là où se manifeste le plus évidemment la supériorité du courage et du génie, où l’unanimité et le concert sont le plus indispensables, et où se ressentent le plus cruellement les effets pernicieux du désordre. Cet état de guerre interminablement prolongé - circonstance commune parmi les tribus sauvages - rompit le peuple à la soumission, et si le chef était aussi équitable que prudent et courageux, il devint jusque dans la paix l’arbitre de tous les différends, et parvint [81] progressivement, en alliant la force à la soumission, à établir son autorité. Le bénéfice sensible qui résultait de son autorité le fait aimer du peuple, de ceux du moins qui étaient disposés à la paix; et, à supposer que son fils fût doué des mêmes qualités, le gouvernement parvint au plus tôt à la maturité et à la perfection; mais il demeura dans un état de faiblesse jusqu’à ce que son développement, son perfectionnement ultérieur procurât au magistrat un revenu qui lui permit d’accorder des récompenses aux divers membres de son administration, et qu’il pût infliger des châtiments aux réfractaires et aux désobéissants. Avant ce moment, à chaque fois que s’exerça l’influence du prince, ce dut être un acte particulier, fondé sur les circonstances propres à l’affaire. Après, la soumission ne fut plus l’objet d’un choix pour la masse de la communauté, elle fut rigoureusement exigée par l’autorité du magistrat suprême.
Dans tous les gouvernements sévit perpétuellement une querelle intestine, ouverte ou dissimulée, entre l’Autorité et la Liberté, et ni l’une ni l’autre ne peut jamais l’emporter absolument dans ce conflit. Il faut nécessairement sacrifier beaucoup de sa liberté sous tout gouvernement, et cependant l’autorité même, qui restreint la liberté, ne peut jamais - et peut-être ne doit-elle jamais -, dans aucune constitution, devenir vraiment absolue et irrésistible. Le sultan est maître de la vie et de la fortune de tout individu, mais il n’aura pas le droit de prélever de nouveaux impôts sur ses sujets; un monarque français peut prélever des impôts à volonté, mais il trouverait dangereux d’attenter à la vie et à la fortune des individus. La religion elle-même, dans la plupart des pays, se trouve généralement être un principe d’insoumission, et d’autres principes ou préjugés font fréquemment obstacle à toute l’autorité du magistrat civil, dont le pouvoir est fondé sur l’opinion et ne peut donc jamais corrompre d’autres opinions, également enracinées avec celle qui lui donne droit à la domination. Le gouvernement qu’on appelle ‘libre’, selon le vocabulaire commun, est celui qui admet le partage du pouvoir entre plusieurs membres dont l’autorité réunie n’est pas moindre, ou est d’ordinaire plus grande, que celle d’un quelconque monarque; mais qui, dans le cours ordinaire de l’administration, doit agir par lois générales et équitables, qui sont au préalable connues de tous les membres, et de tous leurs sujets. En ce sens, il faut l’avouer, la liberté est la perfection de la société civile; mais encore faut-il reconnaître que l’autorité est essentielle à son existence même; et dans les litiges qui éclatent si souvent entre l’une et l’autre, l’autorité peut, pour cette raison, appeler la préférence. A moins qu’on ne puisse, peut-être, affirmer (et on peut le faire avec quelque raison) qu’une circonstance essentielle à l’existence de la société civile doit toujours se maintenir d’elle-même, et a besoin d’être protégée avec moins de vigilance qu’une autre qui contribue seulement à sa perfection, que l’indolence des hommes est si prompte à oublier ou leur ignorance à négliger.
Du contrat primitif (1752)
Aucun parti ne peut à notre époque se passer de l’appui d’un système de principes philosophiques ou spéculatifs, uni à son système politique ou pratique; aussi voyons-nous que chacune des factions entre lesquelles se divise notre nation a élevé un édifice de la première espèce afin de protéger et de couvrir son plan de conduite. Le peuple étant généralement un architecte bien maladroit, surtout en matière de spéculation, et encore plus lorsque l’anime le zèle partisan, on imagine aisément que son ouvrage doit être un peu disgracieux, et porter les marques évidentes de la violence et de la confusion dans lesquelles il fut édifié. L’un des partis fait remonter le gouvernement à la Divinité, et tente de le rendre si sacré, si inviolable que, dans quelque tyrannie qu’il puisse tomber, il doive être presque sacrilège d’y toucher ou de l’attaquer sur le moindre point. L’autre parti fonde entièrement le gouvernement sur le consentement du peuple, et suppose une sorte de contrat primitif, en vertu duquel les sujets se sont tacitement réservé le pouvoir de résister à leur souverain chaque fois qu’ils se trouvent lésés par l’autorité qu’ils lui ont, dans de certaines intentions, volontairement confiée. Tels sont les principes spéculatifs des deux partis, et telles aussi les conséquences pratiques qu’on en tire.
Je me risquerai à affirmer: que ces deux systèmes de principes spéculatifs sont également justes, quoiqu’en un sens différent de celui qu’y attachent les partis; et que les plans de conduite pratique qu’on en déduit de part et d’autre sont tous les deux très sages, mais cessent de l’être dans les conséquences extrêmes où chaque parti, en opposition à l’autre, a d’ordinaire tenté de les entraîner.
Que la Divinité est l’ultime auteur de tout gouvernement on ne le niera pas si l’on admet une providence générale et si l’on convient que tous les évènements de l’univers sont régis par un dessein uniforme et tendent à des fins pleines de sagesse. Le genre humain ne peut subsister, du moins dans un état de bien-être et de sécurité, sans la protection du gouvernement; il faut donc que cette institution ait été voulue par l’Etre bienfaisant qui se propose le bien de toutes ses créatures. Et comme cette institution est un fait universel, de tous les pays et de tous les temps, nous pouvons conclure avec une certitude encore plus grande qu’elle a été voulue par l’Etre omniscient qu’aucun événement ni [84] aucune action ne peuvent jamais tromper. Mais puisqu’il lui a donné naissance, non par une intervention particulière ou miraculeuse, mais par son efficience cachée et universelle, on ne saurait à proprement parler appeler un souverain son représentant, sinon dans ce sens qu’on peut dire de tout pouvoir, ou de toute force, qui est dérivé de la divinité, qu’il agit par sa commission. Tout ce qui arrive effectivement est compris dans lé dessein ou l’intention générale de la providence; et le plus puissant, le plus légitime des princes n’a pas plus de raison, à ce compte, d’invoquer un quelconque caractère sacré ou une autorité inviolable, que n’en a un magistrat subalterne, ou même un usurpateur, voire même un brigand et un pirate. Le même ordonnateur divin qui, pour des vues sages, investit un Titus ou un Trajan de l’autorité, accorda aussi, pour des vues assurément aussi sages quoiqu’inconnues, le pouvoir à un Borgia ou un Angria. Les mêmes causes qui dans chaque état donnèrent naissance au pouvoir souverain, y établirent également chaque juridiction subalterne et chaque autorité limitée. Un gardien de la paix agit donc, non moins qu’un roi, par commission divine, et possède un droit inattaquable.
Si nous considérons combien les hommes sont près de l’égalité quant à la force physique, et même quant à la puissance et aux facultés intellectuelles avant que l’éducation ne les cultive, nous sommes forcés d’admettre qu’il n’y a que leur propre consentement qui ait pu, à l’origine, les associer et les assujettir à une quelconque autorité. Le peuple - si l’on suit la trace du gouvernement jusqu’à sa première origine, dans les forêts et les déserts - est la source de tout pouvoir et de toute juridiction, et c’est volontairement, pour le salut de la paix et de l’ordre, qu’il abandonna sa liberté naturelle et reçut des lois d’un de ses égaux et de ses compagnons. Les conditions auxquelles il était prêt à se soumettre furent expressément déclarées, ou étaient si claires et évidentes qu’on jugea superflu de les exprimer. Si c’est là alors ce qu’on entend par contrat primitif, on ne peut nier que tout gouvernement se fonde d’abord sur un contrat, et que c’est essentiellement sur ce principe que se formèrent les plus anciennes associations, encore grossières, de l’humanité. Il serait vain de nous demander dans quelles archives est enregistrée cette charte de nos libertés. On ne l’écrivit point sur parchemin, et pas encore sur les feuilles ou l’écorce des arbres. Elle précède l’usage de l’écriture, et tous les autres arts civilisés de l’existence. Mais nous en trouvons la trace nette dans la nature de l’homme, et dans l’égalité - ou quelque chose approchant de l’égalité - qui se trouve entre tous les individus de cette espèce. La force qui maintenant emporte l’avantage, et qui est fondée sur flottes et armées, est simplement politique et dérivée de l’autorité, qui est l’effet du gouvernement établi. La force naturelle d’un homme ne consiste que dans la vigueur de ses membres, et la fermeté de son courage; choses qui ne purent jamais soumettre des multitudes au commandement d’un seul. Rien ne pût avoir cette influence, sinon leur propre consentement, et le sentiment des avantages qui résulteraient de la paix et de l’ordre.
Cependant ce consentement même demeura longtemps très imparfait, sans pouvoir être la base d’une administration régulière. Le chef, qui avait probablement acquis son influence dans un état de guerre prolongée, commandait plus par persuasion que par ordre; et jusqu’à ce qu’il pût employer la force pour réduire réfractaires et désobéissants, on ne peut guère dire que la société eût atteint un état de société civile. Aucun pacte ou arrangement ne fut, [85] c’est évident, conclu dans le sens de la soumission générale; idée très éloignée de la compréhension des sauvages. Chaque fois que le chef exerça son autorité, ce dut être un acte particulier, né des exigences présentes de la situation. L’utilité sensible qui résulta de son intervention fit que ces exercices de l’autorité devinrent de jour en jour plus fréquents; et leur fréquence produisit progressivement dans le peuple une soumission habituelle et, si l’on veut l’appeler ainsi, volontaire, par conséquent précaire.
Mais les philosophes qui ont embrassé la cause d’un parti (si tant est que ce ne soit pas une contradiction dans les termes) ne se contentent pas de ces concessions. Ils soutiennent non seulement que le gouvernement, dans sa prime enfance, est surgi des consentements, ou plutôt de la soumission volontaire du peuple, mais encore que, même à présent qu’il a atteint sa pleine maturité, il ne repose sur point d’autre fondement. Tous les hommes, affirment-ils, naissent encore égaux, et ne doivent obéissance à aucun prince ni gouvernement, à moins d’être liés par l’obligation ou la sanction d’une promesse. Et comme personne, sous quelque compensation, n’abandonnerait les avantages de sa liberté naturelle et n’irait de lui-même s’assujettir à la volonté d’autrui, cette promesse est toujours comprise comme conditionnelle et n’impose aucune obligation, à moins qu’on ne soit payé de justice et de protection par son souverain. Ces avantages, le souverain les promet en retour, et s’il manque de les procurer, il a enfreint de son côté les termes de l’engagement et dégagé par là son sujet de tous ses devoirs d’obéissance. Tel est, selon ces philosophes, le fondement de l’autorité dans tout gouvernement, et tel est le droit de résistance qui appartient à chaque sujet.
Mais que ces raisonneurs regardent ce qui se passe à l’étranger, dans le monde: ils ne sauraient rien trouver qui réponde le moins du monde à leurs idées et puisse garantir un système si subtil et si philosophique. Au contraire, nous voyons partout des princes qui revendiquent leurs sujets comme leur propriété, et affirment leur droit indépendant à la souveraineté, par conquête ou par succession. Nous voyons aussi partout des sujets qui reconnaissent ce droit à leur prince, et se voient autant nés avec l’obligation d’obéir à un certain souverain qu’ils le sont avec l’obligation du respect et du devoir à l’égard de leurs parents. Ces liaisons sont toujours considérées comme également indépendantes de notre consentement, en Perse et en Chine, en France et en Espagne, et même en Hollande et en Angleterre partout où les doctrines rapportées ci-dessus n’ont pas été inculquées. L’obéissance ou la sujétion devient si familière que la plupart des hommes n’enquêtent jamais sur son origine ou sa cause plus que sur le principe de gravité, de résistance, ou la plupart des lois universelles de la nature. Ou si jamais la curiosité les prend, à peine ont-ils appris que, depuis plusieurs générations ou depuis un temps immémorial, eux et leurs ancêtres ont été soumis à tel ou tel gouvernement, à telle ou telle famille, qu’ils acquiescent aussitôt et reconnaissent leur devoir d’obéissance. Si vous alliez prêcher, dans la plupart des contrées du monde, que les relations politiques sont entièrement fondées sur le consentement volontaire ou une promesse mutuelle, le magistrat vous ferait bientôt emprisonner comme séditieux, pour vouloir relâcher les noeuds de l’obéissance; à moins que vos amis ne vous aient auparavant fait enfermer comme extravagant, pour avancer de telles absurdités. Il est étrange qu’un acte de l’esprit que chaque individu est censé avoir effectué - et, en plus, après être parvenu au point d’user de sa raison, [86] autrement cet acte ne pourrait avoir aucune autorité - que cet acte, dis-je, soit à tous si totalement inconnu que, sur toute la superficie de la terre, il n’en reste presqu’aucune trace ni aucun souvenir.
Mais, dira-t-on, le contrat sur lequel est fondé le gouvernement est appelé contrat primitif: on peut par conséquent le supposer trop ancien pour être connu de l’actuelle génération. Si l’on entend la convention par laquelle les sauvages commencèrent à s’associer et à conjuguer leurs forces, on reconnaît sa réalité; mais puisque ce contrat est si ancien, transformé par mille changements de gouvernements et de princes, on ne peut supposer maintenant qu’il garde une quelconque autorité. Et si nous voulions parler à propos, il faudrait soutenir que tout gouvernement particulier qui est légitime et impose un devoir d’obéissance au sujet fut, à l’origine, fondé sur le consentement et sur un pacte volontaire. Mais, outre que cela suppose que le consentement des pères engage les enfants, jusqu’à la postérité la plus éloignée (ce dont les écrivains républicains ne conviendront jamais), outre cela, dis-je, ce fait n’a pour lui ni l’histoire ni l’expérience, à aucune époque et en aucun pays du monde.
Presque tous les gouvernements qui existent actuellement ou dont l’histoire nous a conservé le souvenir furent fondés à l’origine soit sur l’usurpation ou la conquête, ou les deux à la fois, sans que l’on puisse prétexter un libre consentement, soit sur la soumission volontaire du peuple. Lorsqu’un homme adroit et audacieux est placé à la tête d’une armée ou d’une faction, il lui est souvent facile, en employant tantôt la violence, tantôt de fallacieux prétextes, d’établir sa domination sur un peuple cent fois plus fort en nombre que ne le sont ses partisans. Il interdit toute communication ouverte qui permette à ses ennemis de savoir avec certitude leur force ou leur nombre. Il ne leur donne pas loisir de s’assembler en corps pour lui faire opposition. Il se peut même que tous ceux qui sont les instruments de son usurpation souhaitent sa chute; mais chacun ignorant les intentions des autres, cela les maintient dans la terreur, et est la seule cause de sa sécurité. C’est par des artifices semblables que bien des gouvernements furent établis; et c’est là le seul contrat originaire dont ils puissent se glorifier.
La face de la terre est en perpétuel changement: de petits royaumes s’accroissent pour devenir de grands empires, de grands empires se décomposent en royaumes encore plus petits, des colonies s’implantent, des tribus émigrent. Peut-on, dans tous ces évènements, trouver autre chose que force et violence? Où est la convention mutuelle, ou l’association volontaire, dont on fait tant de bruit?
Même la voie la plus douce par laquelle une nation puisse recevoir un maître étranger, le mariage ou la cession, n’est pas fort honorable pour le peuple; elle suppose qu’on dispose de lui comme d’un douaire ou d’un legs, selon le bon plaisir ou l’intérêt de ses gouvernants.
Mais là où n’intervient pas la force, où a lieu le système de l’élection, qu’est-ce que cette élection tant vantée? C’est soit l’entente de quelques grands qui décident pour tous et n’admettront aucune opposition, soit la fureur d’une populace suivant un meneur séditieux, à peine connu d’une douzaine d’entre eux, et qui ne doit son progrès qu’à sa propre impudence ou au caprice momentané de ses compagnons.
[87]Ces élections désordonnées, qui encore sont bien rares, ont-elles une puissance et une autorité assez grandes pour être le seule fondement légitime de tout gouvernement et de toute obéissance?
En réalité, il n’est pas de plus terrible éventualité qu’une dissolution totale du gouvernement donne liberté à la multitude et fait dépendre la décision ou le choix d’un nouveau régime d’un nombre de personnes qui est presque celui du peuple en corps; car il n’atteint jamais la totalité de ce corps. Il n’est point alors d’homme de sens qui ne souhaite de voir, à la tête d’une armée puissante et fidèle, un général qui puisse promptement se saisir de la proie, et donner au peuple le maître qu’il est si incapable de se choisir lui-même. Tellement le fait et la réalité sont éloignés de ces notions philosophiques!
Ne nous laissons pas abuser par l’établissement du régime qui a suivi la Révolution, qu’il ne nous rende pas amoureux d’une origine philosophique du gouvernement au point de nous faire imaginer toute autre comme monstrueuse et irrégulière. Cet évènement même fut loin de répondre à ces idées subtiles. Le changement qui se fit alors ne concerna que la succession, et ce, uniquement dans la partie royale du gouvernement; et ce fut seulement la majorité parmi sept cents personnes qui décida de ce changement pour près de dix millions de gens. Ce n’est pas que je doute, certes, que ces dix millions n’aient volontiers acquiescé à cette décision: mais l’affaire fut-elle le moins du monde laissée à leur appréciation? Ne supposa-t-on pas dès ce moment, à juste titre, que l’affaire était close, et n’a-t-on pas puni tous ceux qui refusaient de se soumettre au nouveau souverain? Comment sans cela l’affaire aurait-elle pu trouver sa fin et sa conclusion?
La république d’Athènes fut, je crois, la démocratie la plus large dont l’histoire fasse mention. Cependant, si nous faisons les exceptions requises pour les femmes, les esclaves et les étrangers, nous voyons que cette institution fut au départ réalisée, qu’aucune loi ne fut jamais votée, par un dixième des gens qui étaient obligés de s’y soumettre; sans parler des fies et des dominations étrangères, que les Athéniens revendiquent comme leurs, par droit de conquête. Et on sait combien de licence et de désordre remplirent les assemblées populaires dans cette cité, malgré les institutions et les lois destinées à les réprimer. De quel désordre encore bien plus grave ces assemblées ne feront-elles pas preuve, là où elles ne font pas partie de la constitution établie, et ne se tiennent qu’en tumulte après la dissolution de l’ancien gouvernement afin de donner naissance à un nouveau? Quelle chimère de parler de choix dans de telles circonstances?
Les Achéens jouirent de la démocratie la plus libre, la plus parfaite de toute l’antiquité; pourtant, comme nous l’apprend Polybe2 ils employèrent la force pour obliger certaines cités à entrer dans leur ligue.
Henri IV et Henri VII d’Angleterre n’avaient d’autre titre réel au trône qu’une élection parlementaire; pourtant ils n’en auraient jamais convenu, de peur d’affaiblir par là leur autorité. Etrange conduite, si le seul fondement de toute autorité est le consentement et la promesse!
[88]Il est vain de dire que tous les gouvernements sont ou devraient être, à l’origine, fondés sur le consentement populaire pour autant que le permet la nécessité des affaires humaines. Cela va dans le sens de ce que j’avance. Je soutiens que les affaires humaines ne permettront jamais ce consentement, et rarement l’apparence seule de ce consentement. Mais que la conquête ou l’usurpation, c’est-à-dire, en termes clairs, la force, en provoquant la dissolution des anciens gouvernements, est à l’origine de presque tous les nouveaux qui aient jamais été institués dans le monde. Et que dans les rares cas où un consentement peut sembler avoir eu lieu, il fut en général si irrégulier, si limité, ou si mêlé de fraude ou de violence, qu’il ne peut avoir grande autorité.
Ce n’est pas que je veuille ici empêcher le consentement du peuple d’être un juste fondement du gouvernement là où il a lieu. C’est sûrement, de tous, le meilleur et le plus sacré. Je prétends seulement qu’il a très rarement existé à un quelconque degré, et presque jamais dans sa pleine extension. Et qu’en conséquence il faut bien admettre aussi un autre fondement du gouvernement.
Si les hommes étaient tous occupés d’un respect de la justice si inflexible que, d’eux-mêmes, ils renoncent totalement aux biens d’autrui, ils seraient toujours restés dans un état de liberté absolue, sans être soumis à aucun magistrat ni à aucune société politique. Mais c’est là un état de perfection dont on a raison d’estimer la nature humaine incapable. De plus, si les hommes avaient tous un entendement si parfait qu’ils connaissent toujours leur intérêt propre, on ne se fût soumis qu’à une forme de gouvernement fondée sur le consentement et entièrement discutée par chaque membre de la société. Mais cet état de perfection est également bien au-dessus de la nature humaine. La raison, l’histoire et l’expérience nous montrent que toutes les sociétés politiques ont eu une origine bien moins juste et régulière; et s’il fallait choisir la période où l’on se préoccupe le moins du consentement du peuple dans les affaires publiques, ce serait précisément celle de la fondation d’un nouveau gouvernement. Dans un état dont la constitution est fixée, on consulte souvent les inclinations du peuple; mais dans la fureur des révolutions, des conquêtes et des convulsions publiques, c’est généralement la force militaire, ou l’habileté politique, qui tranche le débat.
Un nouveau gouvernement une fois établi, par n’importe quel moyen, le peuple en est d’ordinaire mécontent, et s’il obéit, c’est plus par crainte et nécessité que par une quelconque idée de soumission ou d’obligation morale. Le prince est vigilant et soupçonneux, il doit se garder avec soin de tout début ou de tout semblant d’insurrection. Peu à peu, le temps éloigne ces difficultés, et accoutume la nation à considérer comme ses princes légitimes ou naturels cette famille qu’elle avait d’abord considéré comme celle d’usurpateurs ou de conquérants étrangers. Et pour fonder cette opinion, ceux-ci ne recourent pas à la notion d’un consentement volontaire ou d’une promesse; ils savent bien qu’en pareil cas jamais rien de tel ne fut exigé ni attendu. C’est la violence qui a fondé l’institution originelle, et la nécessité qui a produit la soumission. L’administration qui en découle est aussi soutenue par la force, et si le peuple s’y soumet, ce n’est pas choix, mais obligation. Ce n’est pas que le peuple imagine que son consentement donne un titre au prince; mais son accord est volontaire, parce qu’il estime qu’une longue possession a acquis au prince un droit indépendant du choix et de l’inclination de ses sujets.
[89]Dira-t-on qu’en vivant dans les états d’un prince, qu’il est libre de quitter, chaque particulier a donné un consentement tacite à son autorité, et fait promesse d’obéissance? On peut répondre qu’un tel consentement implicite ne peut avoir lieu que si l’on s’imagine avoir la liberté de choisir. Mais si l’on estime (et c’est le sentiment de toute l’humanité née sous des gouvernements établis) que, de par sa naissance, on doit obéissance à un certain prince ou à une forme de gouvernement donnée, il serait absurde de supposer un choix ou un consentement auquel on renonce, dans cette occasion, et que l’on abjure en termes exprès.
Peut-on dire sérieusement qu’un pauvre paysan, qu’un pauvre artisan peut choisir librement de quitter son pays, alors qu’il ne commit ni la langue ni les usages des pays étrangers, et vit au jour la journée des petits gages que lui procure son travail? On pourrait aussi bien prétendre qu’un homme qui reste à bord d’un navire consent librement à l’autorité du capitaine, alors qu’on l’a embarqué durant son sommeil, et que, s’il veut quitter le navire, il lui faudra sauter dans l’océan et s’y noyer.
Et si le prince interdit à ses sujets de quitter ses états? Au temps de Tibère, on fit un crime à un chevalier romain d’avoir tenté de s’enfuir chez les Parthes pour échapper à la tyrannie de cet empereur.3 Et chez les anciens Moscovites, il était interdit de faire aucun voyage, sous peine de mort. Et si un prince remarquait que bon nombre de ses sujets fussent gagnés par la fièvre de l’émigration, il y mettrait bon ordre, sans aucun doute, avec grande raison et justice, afin de prévenir la dépopulation de son propre royaume. Est-ce qu’une loi si raisonnable et si sage dispenserait tous ses sujets de l’obéissance? et cependant il est sûr que cette loi leur ôte la liberté de choix.
Une troupe d’hommes qui quitteraient leur pays natal afin d’aller peupler des régions désertes pourraient rêver de recouvrer leur liberté naturelle; mais ils se verraient bientôt réclamés en forme par leur souverain, et traités en sujets jusque dans leur nouvel établissement. Et en cela le prince ne ferait qu’agir selon les idées communes de l’humanité.
Le consentement tacite le plus valide de cette espèce, qu’on puisse jamais observer, est celui d’un étranger s’installant dans un pays, et connaissant d’avance le prince, le gouvernement et les lois auxquels il se doit soumettre; et pourtant, quoique son obéissance soit plus volontaire, on en attend et on en exige beaucoup moins de lui que d’un sujet né. Au contraire, son souverain naturel affirme toujours un droit sur sa personne. Et s’il ne le punit pas comme traître lorsqu’il s’en saisit, en temps de guerre, chargé d’une commission de son nouveau prince, cette clémence ne se fonde point sur la législation intérieure des états, qui dans tous les pays condamne le prisonnier, mais sur l’indulgence dont les princes sont convenus entre eux pour éviter les représailles.
Si une génération d’hommes quittait la scène d’un seul coup et qu’une autre lui succédât, comme cela se voit chez les vers à soie et les papillons, si la génération nouvelle avait assez de sens pour choisir son gouvernement, ce qui [90] n’est assurément jamais le cas des hommes, elle pourrait volontairement et par consentement général établir sa propre forme de gouvernement civil sans s’occuper des lois ou précédents qui régnèrent parmi ses ancêtres. Mais comme la société humaine est en perpétuel changement, un homme quittant le monde à chaque heure tandis qu’un autre y entre, il est nécessaire, afin de préserver la stabilité du gouvernement, que la génération nouvelle se conforme à la constitution établie et suive de près le chemin que ses pères, marchant eux-mêmes sur les pas de leurs pères, lui ont tracé. Sans doute toute institution humaine exige-t-elle certaines innovations nécessaires: heureuse nécessité, lorsque le génie éclairé du temps les pousse dans le sens de la raison, de la liberté et de la justice. Quant aux innovations violentes, personne n’est habilité à en réaliser. Il est même dangereux que le législateur s’y emploie, il faut toujours en attendre plus de mal que de bien. Et si l’histoire fournit des exemples du contraire, n’en faisons pas des précédents: considérons-les seulement comme des preuves que la science politique fournit peu de lois qui n’admettent pas d’exception, et que la fortune et le hasard ne puissent contredire à l’occasion. Les innovations violentes qui eurent lieu sous le règne d’Henri VIII provenaient d’un monarque autoritaire, soutenu par un semblant d’autorité législative. Celles du règne de Charles Ier furent provoquées par l’esprit de parti et le fanatisme. Et elles se révélèrent toutes finalement heureuses. Mais même les innovations du premier furent longtemps la source de bien des désordres, et de dangers encore plus nombreux; et si, dans les innovations du second, on prend la mesure de la soumission, une anarchie totale s’installe à coup sûr dans la société humaine, et un point final est immédiatement mis à tout gouvernement.
Supposez qu’un usurpateur, après avoir banni son prince légitime et la famille royale, établisse sa domination sur un pays pendant dix ou douze ans, et maintienne une telle discipline parmi ses troupes, un ordre si rigoureux dans ses garnisons, qu’aucune insurrection ne se soit jamais produite, aucun murmure fait entendre, contre son administration: peut-on affirmer que le peuple, qui au fond de son coeur abhorre sa trahison, ait tacitement souscrit à son autorité, et lui ait promis obéissance, simplement parce que la nécessité le force à vivre sous sa domination? Supposez maintenant que le prince légitime soit rétabli sur le trône, grâce à une armée levée dans des pays étrangers: le peuple le reçoit avec joie et enthousiasme, montrant clairement la répugnance qu’il avait à se soumettre à un autre joug. A présent je peux demander: sur quoi est fondé le droit de ce prince? Sûrement pas sur le consentement populaire: car, quoique le peuple reconnaisse volontiers son autorité, il ne pense jamais que ce soit ce consentement qui lui ait donné la souveraineté. S’il accepte, c’est parce qu’il comprend que ce prince est déjà, par droit de naissance, son souverain légitime. Et quant à ce consentement tacite qui peut maintenant se déduire du fait qu’il vit sous la domination de ce prince, il a auparavant été accordé au tyran et à l’usurpateur tout comme il l’est à celui-ci.
Lorsque nous affirmons que tout gouvernement légitime provient du consentement du peuple, nous lui faisons assurément beaucoup plus d’honneur qu’il n’en mérite, ou même qu’il n’en attend et n’en désire de notre part. Lorsque les états romains devinrent une masse trop lourde à gouverner pour la république, les peuples, sur toute la surface du monde alors connue, surent un gré extrême à Auguste de l’autorité qu’il avait, par la violence, établie sur eux; et ils manifestèrent une semblable disposition à se soumettre au successeur qu’il [91] leur laissa par testament, en dernière volonté. Ce fut ensuite un grand malheur que la succession ne se soutint jamais longtemps et régulièrement dans une seule famille, et que la lignée des princes fût continuellement rompue par des assassinats privés ou des révoltes publiques. Une famille n’était pas plutôt éteinte que les troupes prétoriennes élisaient un nouvel empereur, les légions d’Orient un second, et parfois celles de Germanie un troisième; et le glaive pouvait seul trancher le débat. Si la condition du peuple était à plaindre sous cette puissante monarchie, ce n’était pas que le choix de l’empereur ne lui fût jamais permis - car la chose eût été irréalisable -, mais qu’il ne connût jamais une succession de maîtres qui pussent se suivre avec régularité. Quant à la violence, aux guerres et au carnage causés par chaque nouvelle vacance du trône, on ne saurait les blâmer, car ils étaient inévitables.
La maison de Lancaster régna sur notre île pendant près de soixante ans, et pourtant les partisans de la Rose blanche semblaient se multiplier de jour en jour en Angleterre. La maison qui est actuellement sur le trône rêgne depuis encore plus longtemps. Mais les motifs qui donneraient des droits à une autre famille sont-ils tous entièrement annulés? C’est encore une question, quoiqu’il n’y ait guère de personne actuellement vivante qui fût parvenue à l’âge de raison lorsque l’ancienne famille royale fut bannie, et qui pût donc consentir à sa domination ou lui promettre obéissance. Voilà une indication sans doute suffisante sur le sentiment général de l’humanité sur ce sujet. Car nous ne reprochons pas aux partisans de la famille qui a renoncé au trône d’avoir simplement conservé si longtemps leur imaginaire fidélité. Nous leur reprochons de s’attacher à une famille qui, selon nous, a été justement bannie, et qui, depuis la nouvelle succession a perdu tout droit à l’autorité.
Mais si l’on veut une réfutation plus correcte, du moins plus philosophique, du principe du contrat primitif ou du consentement populaire, peut-être les observations suivantes seront-elles suffisantes.
L’ensemble des devoirs moraux peut se diviser en deux espèces. La première comprend ceux auxquels les hommes se trouvent poussés par un instinct naturel ou un penchant immédiat, qui agit sur eux indépendamment de toute idée d’obligation et toute considération d’utilité publique ou privée. De cette nature sont l’amour pour les enfants, la reconnaissance envers les bienfaiteurs, la pitié qu’on a du malheureux. En réfléchissant à l’avantage que retire la société de tels instincts d’humanité, nous leur payons le juste tribut de l’approbation et de l’estime morale. Mais celui qui en est animé ressent leur pouvoir et leur influence avant toute réflexion de cette sorte.
Les devoirs moraux renfermés dans la seconde espèce ne sont point fondés sur un instinct originaire de la nature, mais sont accomplis exclusivement par sentiment d’obligation, si nous considérons les nécessités de la société humaine et l’impossibilité de la préserver si l’on néglige ces devoirs. C’est ainsi que la justice, qui consiste à respecter le bien d’autrui, et la fidélité, qui consiste à tenir ses promesses, deviennent obligatoires et acquièrent de l’autorité sur l’humanité. Car, étant évident que chacun a plus d’amour pour soi que pour autrui, on est naturellement poussé à étendre autant que possible ses propres acquisitions; et rien ne peut restreindre ce penchant, sinon la réflexion et l’expérience qui enseignent les effets pernicieux de cette licence, et la totale [92] dissolution de la société qui en résulte nécessairement. Ici donc, l’inclination originaire, l’instinct, est modérée et réfrénée par un jugement et une réflexion ultérieurs.
Il en est précisément de même du devoir politique ou civil d’obéissance, que des devoirs naturels de justice et de fidélité. Nos instincts primitifs nous portent soit à nous permettre une liberté illimitée, soit à chercher à dominer autrui; et ce n’est que la réflexion qui nous engage à sacrifier des passions si violentes aux intérêts de la paix et de l’ordre public. Un peu d’expérience ou d’observation suffit à nous apprendre que la société ne peut probablement pas se maintenir sans l’autorité de magistrats, et que cette autorité sombre vite dans le mépris si l’on ne lui rend pas une scrupuleuse obéissance. L’observation de ces intérêts généraux et évidents est la source de toute obéissance, et de l’obligation morale que nous lui attribuons.
Quelle nécessité y-a-t-il donc de fonder le devoir de soumission et d’obéissance aux magistrats sur la fidélité à tenir ses promesses, et de supposer que c’est le consentement de chacun qui le soumet au gouvernement, alors que, manifestement, obéissance et fidélité reposent précisément toutes les deux sur le même fondement, alors que l’humanité obéit à l’une comme à l’autre à cause des intérêts évidents et des nécessités de la société humaine? Nous sommes contraints d’obéir au souverain, dit-on, parce que nous lui avons fait une promesse tacite en ce sens. Mais pourquoi sommes-nous contraints de tenir notre promesse? Ce ne peut être que pour la raison que le commerce et les relations avec nos semblables, qui sont d’un si grand avantage, ne peuvent revêtir aucune sécurité là où les hommes ne respectent pas leurs engagements. II est, de même, tout aussi vrai de dire que les hommes ne pourraient absolument vivre en société, du moins en une société civilisée, sans lois ni magistrats ni juges destinés à prévenir les empiètements du fort sur le faible, de la violence sur la justice et l’équité. Le devoir de soumission ayant autant de force et d’autorité que le devoir de fidélité, on ne gagne rien à expliquer l’un par l’autre. Les intérêts généraux et les nécessités de la société suffisent à fonder l’un et l’autre.
Si l’on veut savoir pourquoi nous sommes obligés d’obéir au gouvernement, je répond tout de suite: parce que, sans cela, la société ne pourrait subsister. Et cette réponse est claire et intelligible à tous. Vous dites que c’est parce que nous devons tenir notre parole. Mais outre, que cette réponse ne peut être comprise ni goûtée que par une personne formée à un système philosophique, outre cela, dis-je, vous voilà bien embarrassés si l’on vous demande: pourquoi devons-nous tenir notre parole? Et il ne vous reste qu’une réponse, qui aurait immédiatement, et sans détour, rendu compte de notre devoir d’obéissance.
Mais à qui devons-nous obéissance? Et quel est notre souverain légitime? Cette question est souvent la plus délicate de toutes, et prête à des discussions infinies. Lorsque le peuple est assez heureux pour pouvoir répondre: nous devons obéissance à notre actuel souverain, qui descend en droite ligne d’une suite d’ancêtres qui nous gouvernent depuis des siècles, cette réponse n’admet pas de réplique; les historiens, en remontant jusqu’à l’antiquité la plus reculée pour y chercher l’origine de cette famille royale, auraient beau [93] découvrir que sa première autorité fût le fruit de l’usurpation et de la violence, chose d’ailleurs commune. Il est entendu que la justice privée, qui consiste à s’abstenir de toucher aux biens d’autrui, est une éminente vertu cardinale; cependant la raison nous enseigne qu’il n’est pas de possession - en ce qui concerne les choses durables, terres ou maisons, qui passent d’un propriétaire à l’autre - qui ne se montre d’un examen attentif, à un moment ou à un autre, fondée sur la fraude et l’injustice. Les nécessités de la société humaine, de la vie publique comme de la vie privée, ne permettront pas une enquête si rigoureuse; et, si nous tolérons une fausse philosophie, il n’est pas de vertu, de devoir moral, qui, à être ainsi passé au crible et à l’analyse d’une logique captieuse, à être considéré dans toutes les positions ou les éclairages possibles, ne s’en allât également en fumée.
Les questions concernant la propriété privée ont rempli d’innombrables volumes de jurisprudence et de philosophie, si l’on ajoute les commentaires ou texte original; et finalement, nous pouvons affirmer en toute sécurité que bien des règles qui s’y trouvent établies sont incertaines, ambiguës et arbitraires. On peut se faire la même opinion à propos de la succession et des droits des princes, et des formes de gouvernement. Il y a manifestement bien des cas, surtout dans l’enfance de chaque gouvernement, où l’on ne peut décider d’après les lois de la justice et de l’équité. Et Rapin, qui a écrit notre histoire, prétend que le conflit entre Edouard III et Philippe de Valois était de cette sorte, et ne pouvait être tranché que par un appel au ciel, c’est-à-dire par guerre et violence.
Qui me dira si c’était à Germanicus ou à Drusus de succéder à Tibère, à supposer qu’il fût mort de leur vivant sans avoir désigné l’un d’eux pour lui succèder? Faut-il considérer le droit d’adoption comme équivalent au droit du sang, dans une nation où il avait cette validité dans les familles des particuliers, et avait déjà eu, à deux reprises, cette validité dans la famille impériale. Fallait-il tenir Germanicus pour le fils aîné parce qu’il était né avant Drusus, ou pour le cadet parce qu’il avait été adopté après la naissance de son frère? Fallait-il tenir compte du droit d’aînesse dans une nation où il n’assurait aucune prérogative dans la succession des familles privées? Deux exemples devaient-ils suffire pour considérer à cette époque l’empire romain comme héréditaire, ou bien fallait-il considérer, même en ces temps-là, qu’étant fondé sur une usurpation si récente, il appartenait au plus fort ou à son actuel possesseur?
Commode monta sur le trône après une assez longue suite d’excellents empereurs, qui tenaient leur droit à la couronne non de leur naissance, ni de l’élection publique, mais du rite fictif de l’adoption. Ce débauché sanguinaire ayant été assassiné par une conspiration soudaine montée entre sa maîtresse et le favori de celle-ci, qui parvint à ce moment à être Préfet du Prétoire, ces deux personnages délibérèrent aussitôt pour donner un maître au genre humain pour parler le langage de ces temps là -, et jetèrent les yeux sur Pertinax. Avant que ne soit connue la mort du tyran, le Préfet alla secrètement trouver ce sénateur qui, à la vue des soldats, crut que Commode avait ordonné son exécution. Il fut sur le champ salué du nom d’empereur par l’officier et son escorte, proclamé avec enthousiasme par le peuple; il reçut la soumission mitigée des gardes, fut reconnu en bonne et due forme par le sénat, et accepté passivement par les provinces et les armées de l’empire.
[94]Le mécontentement des troupes prétoriennes éclata soudain en sédition, qui causa le meurtre de cet excellent prince. Et le monde étant alors sans prince et sans gouvernement, les gardes jugèrent bon de mettre, en bonne et due forme, l’empire en vente publique. Julien, l’acquéreur, fur proclamé par les soldats, reconnu par le sénat, et reçut la soumission du peuple; et il aurait aussi reçu celle des provinces s’il n’y avait eu l’opposition et la résistance engendrées par la haine des légions. Pescennius Niger, en Syrie, se créa lui-même empereur, se ménagea le suffrage tumultueux de son armée, et fut entouré de la bienveillance secrète du Sénat et du peuple de Rome. Albinus, en Bretagne se trouva un droit égal à prétendre au pouvoir; mais à la fin Sévère, qui gouvernait la Pannonie, l’emporta sur les deux autres. Aussi doué comme politique que comme guerrier, il trouva que sa naissance et sa dignité étaient bien trop inférieures à la couronne impériale, et commença par proclamer seulement son intention de venger la mort de Pertinax. Il entra comme général en Italie, battit Julien, et sans qu’il soit possible de fixer le moment précis où ses soldats commencèrent à l’accepter, le sénat et le peuple furent dans la nécessité de le reconnaître comme empereur; puis il soumit Niger et Albinus et s’établit tout à fait dans son autorité conquise par la violence.4
Inter haec Gordianus Caesar (dit Capitolin, en parlant d’une autre époque) sublatus a militibus. Imperator est appelatus, quia non erat alius in raesenti. Il est à remarquer que Gordien était un garçon de quatorze ans.
On trouve fréquemment des exemples semblables dans l’histoire des empereurs, dans celle des successeurs d’Alexandre, et de bien d’autres nations; et rien ne peut être plus déplorable qu’un gouvernement despotique de cette espèce, où la succession est brisée et irrégulière, et où il faut décider, à chaque vacance du trône, en recourant à la force ou à l’élection. Dans un gouvernement libre, le même recours est souvent inévitable, mais il, est aussi bien moins dangereux. Les intérêts de la liberté peuvent ici, bien souvent, conduire le peuple, pour sa propre défense, à changer l’ordre de la succession à la couronne. Et la constitution, étant mixte et composée de parties, peut encore conserver une stabilité suffisante: si la partie monarchique subit de temps en temps une modification destinée à l’accorder aux autres parties, la constitution peut cependant s’appuyer sur les membres de l’aristocratie et du peuple.
Sous un gouvernement absolu, lorsqu’il n’y a pas de prince légitime qui ait un droit au trône, on peut dire en toute certitude que celui-ci appartient au premier occupant. Les exemples de ce type ne sont que trop fréquents, surtout dans les monarchies orientales. Lorsqu’une lignée de princes vient à s’éteindre, la volonté du dernier souverain, ou la nomination qu’il aura faite, sera tenue pour un titre. Ainsi l’édit de Louis XIV appelant à la succession les princes bâtards en cas d’extinction de tous les princes légitimes aurait quelque autorité en pareille occurrence.5 Ainsi la volonté de Charles II a régi toute la monarchie [95] espagnole. La cession par l’ancien possesseur, surtout si elle est jointe à la conquête, est de même considérée comme un titre valable. L’obligation générale qui nous lie au gouvernement, c’est l’intérêt et les nécessités de la société, et cette obligation est très forte. Mais le choix de tel ou tel prince particulier, de telle ou telle forme de gouvernement est souvent plus sujet au doute et à l’incertitude. La possession actuelle a dans ce cas une autorité considérable, encore plus grande que pour la propriété privée, à cause des désordres qui accompagnent toujours les révolutions et les changements de gouvernement.6
Nous conclurons seulement par la remarque suivante: que si, dans les sciences spéculatives, métaphysique, philosophique naturelle ou astronomie, il peut paraître déplacé et peu concluant d’en appeler à l’opinion générale, en revanche il n’y a, en ce qui concerne la morale aussi bien que la critique, pas d’autre critère décisif. Et rien ne prouve plus clairement la fausseté d’une théorie que les paradoxes qui en résultent, paradoxes qui répugnent autant aux sentiments communs de l’humanité qu’à la pratique et à l’opinion de toutes les nations et de tous les temps. Telle est, manifestement, la doctrine qui fonde tout gouvernement légitime sur un contrat originaire ou sur le consentement populaire; et le plus connu de ses défenseurs, en en tirant les conséquences, n’a pas hésité à dire que la monarchie absolue est incompatible avec la société civile, et ne peut donc absolument pas être la forme du gouvernement civil,7 et que le pouvoir suprême ne peut ôter à quiconque, par taxes et impôts, aucune partie de son bien, sans son propre consentement ou celui de ses représentants.8 Quelle autorité peut avoir, en tout autre lieu qu’en Angleterre, un raisonnement moral dont les conséquences sont si éloignées de la pratique générale de l’humanité, voilà qui est facile à décider.
Le seul passage que je rencontre dans toute l’antiquité où le devoir d’obéissance au gouvernement soit attribué à une promesse se trouve dans le Criton de Platon, où Socrate refuse de s’enfuir de sa prison parce qu’il a fait [96] la promesse tacite d’obéir aux lois. Ainsi déduit-il une maxime “tory” - l’obéissance passive - d’un principe “whig” - le contrat originaire.
Il ne faut pas attendre de nouvelles découvertes en ces matières. Si on ne s’est pour ainsi dire jamais avisé, que fort tard, de fonder le gouvernement sur un contrat, c’est certainement qu’il ne peut, en règle générale, avoir un tel fondement.
De l’obéissance passif (1752)
Dans l’essai précédent, nous tentons de réfuter les systèmes spéculatifs de politique qu’on avance dans notre nation: tant le système religieux du premier parti que le système philosophique de l’autre. Nous en venons maintenant à examiner les conséquences pratiques, relatives au degré de soumission dû aux souverains, qu’en tire chaque parti.
Puisque le devoir de justice est entièrement fondé sur les intérêts de la société, qui exigent un respect mutuel de la propriété afin de sauvegarder la paix parmi l’humanité, il est évident que, si la pratique de la justice devait avoir des conséquences très funestes, il faudrait se dispenser provisoirement de cette vertu afin que, dans des circonstances si extraordinaires et si pressantes, elle fasse place à l’utilité publique. La maxime: fiat Justitia et ruat Coelum - que justice se fasse et que périsse l’univers - est manifestement fausse et, en sacrifiant la fin aux moyens, donne une idée inversée de la hiérarchie des devoirs. Quel est le gouverneur de ville qui hésite à brûler les faubourgs s’ils facilitent l’avancée de l’ennemi? Quel est le général qui s’interdise de piller un pays neutre quand l’exigent les nécessités de la guerre, et qu’il ne peut autrement entretenir son armée? Il en est de même du devoir de soumission; et le sens commun nous enseigne que, puisque le gouvernement nous contraint d’obéir pour le seul motif qu’il tend à l’utilité publique, il faut toujours, dans les cas extraordinaires où l’obéissance entraînerait de toute évidence la ruine publique, se laisser aller à l’obligation primitive et originaire. Salus populi suprema lex - le salut du peuple est la loi suprême. Cette maxime s’accorde avec les sentiments de l’humanité à toutes les époques; et il n’est personne qui, à la lecture des insurrections contre Néron ou Philippe II, soit assez aveuglé par les systèmes partisans pour ne pas souhaiter le succès de l’entreprise et glorifier ceux qui l’ont formée. Il n’est pas jusqu’à nos éminents monarchistes qui, dans de telles occasions, ne soient forcés de renoncer à leur théorie sublime, et de juger, de sentir et d’opiner tout comme le reste de l’humanité.
La résistance étant donc admise dans les circonstances extraordinaires, la seule question qui se pose alors aux bons esprits concerne le degré de nécessité qui puisse justifier la résistance, et la rendre légitime ou louable. Et là, je dois avouer que je pencherai toujours du côté de ceux qui resserrent très étroitement les liens de l’obligation, et en considèrent l’infraction comme le [98] dernier recours dans les cas désespérés, lorsque la violence et la tyrannie font courir au public les plus grands dangers. Car, outre les méfaits d’une guerre civile, qui succède d’ordinaire à l’insurrection, il est sûr que la disposition à la révolte manifestée par un peuple est une cause décisive de la tyrannie de ses gouvernants, qui les contraint à prendre des mesures violentes qu’ils n’auraient jamais adoptées si chacun avait été enclin à la soumission et à l’obéissance. C’est ainsi que le tyrannicide, l’assassinat du tyran approuvé par les maximes anciennes, au lieu de maintenir usurpateurs et tyrans dans la terreur, les rendait dix fois plus cruels et impitoyables; et aujourd’hui c’est à juste titre, pour cette raison, qu’il est banni par le droit des gens, et universellement condamné comme un moyen abject et perfide de ramener aux lois de la justice ces perturbateurs de la société.
En outre, il faut considérer que l’obéissance étant notre devoir dans le cours ordinaire des choses, on ne saurait assez l’inculquer, et que rien peut y être plus contraire que de s’inquiéter scrupuleusement d’établir tous les cas où la résistance est permise. De même, un philosophe peut avec raison, au cours d’un raisonnement, reconnaître qu’en cas de nécessité pressante on peut se dispenser des règles de justice; mais que dirions-nous d’un prédicateur ou d’un casuiste qui se donnerait pour premier objet d’étude la découverte de cas semblables, et leur prêterait toute la force de l’argumentation et la véhémence de son éloquence? Ne ferait-il pas mieux de s’employer à inculquer la doctrine générale, plutôt qu’à faire étalage de cas particuliers que nous ne sommes peut-être que trop enclins, par nous-mêmes, à adopter et à étendre au-delà de leurs limites?
On peut cependant alléguer deux raisons pour la défense du parti qui a propagé parmi nous, et avant tant de persévérance, les maximes de résistance: maximes qui sont en général, il faut bien le reconnaître, si pernicieuses et si destructrices de la société civile. La première raison est que ses opposants portent la doctrine de l’obéissance jusqu’à l’extravagance, au point non seulement de ne jamais mentionner les exceptions dans les cas extraordinaires (ce qui serait peut-être excusable), mais encore de nier en termes exprès qu’il existe de telles exceptions: il est donc devenu nécessaire d’insister sur ces exceptions et de défendre les droits de la vérité et de la justice bafouées. La seconde raison, et peut-être la meilleure, est fondée sur la nature de la constitution britannique et la forme de son gouvernement.
C’est presque une singularité propre à notre constitution de conférer à un magistrat une prééminence et une dignité telles que, bien que limité par les lois, il est en quelque façon au-dessus des lois quant à sa propre personne, et ne peut être interpellé ni puni pour une injustice ou une faute qu’il a pu commettre. Ses ministres seuls, ou ceux qui agissent par sa commission, peuvent être traduits en justice; le prince, ainsi assuré de sa sécurité personnelle, a tendance à donner libre carrière aux lois, cependant qu’on obtient, en fait, une sécurité publique aussi grande tant que l’on peut châtier les coupables subalternes, et en même temps on évite la guerre civile qui s’ensuivrait fatalement si, à tout moment, on s’attaquait directement au souverain. Cependant, quelque utilité que présente cette sorte de compliment fait au souverain par la constitution, on ne saurait raisonnablement entendre que, par cette maxime, elle ait signé sa propre destruction, et se soit engagée à une obéissance servile au cas où le roi, [99] protégeant ses ministres, persévèrerait dans l’injustice et usurperait le pouvoir tout entier de la communauté. Il est vrai que ce cas n’est jamais expressément envisagé par les lois, car il leur est impossible, dans leur carrière ordinaire, d’y porter remède, et d’établir un magistrat pourvu d’une autorité supérieure, pour corriger les excès du prince. Mais comme un droit serait absurde sans le moyen de remédier à son abus, le remède est dans ce cas celui, extraordinaire, de la résistance, lorsque les choses en sont venues à cette extrémité que la constitution ne puisse être sauvée par une autre voie. C’est pourquoi, bien sûr, la résistance est nécessairement plus fréquente dans le gouvernement britannique qu’en d’autres, plus simples, composés de moins de parties et de ressorts. Un souverain absolu n’est guère tenté de commettre des actes d’une tyrannie assez criante pour faire naître de justes sujets de rébellion; tandis qu’un prince dont le pouvoir est limité, sans avoir de grands vices, et cour peu qu’il joigne l’imprudence à l’ambition, peut se précipiter dans cette périlleuse situation. On pense généralement que ce fut le cas de Charles Ier; et si nous pouvons parler franchement, maintenant que les animosités ont cessé, disons que ce fut aussi le cas de Jacques II. Ceux-ci étaient inoffensifs, même s’ils n’étaient pas, quant à leur caractère privé, des hommes de bien; mais ils se méprirent sur la nature de notre constitution et absorbèrent l’ensemble du pouvoir législatif: aussi devint-il nécessaire de s’opposer à eux avec quelque force, et même de dépouiller le dernier, en bonne et due forme, de l’autorité dont il avait usé si imprudemment, et avec tant d’indiscrétion.
Notes
1. Cette passion, nous pouvons l’appeler enthousiasme, ou lui donner le nom qu’on veut; mais un politique qui en négligerait l’influence sur les affaires humaines ne ferait preuve que d’une intelligence bornée. ↵
2. Liv. II, ch. 32. ↵
3. Tacite. Ann. VI. ch. 14. ↵
4. Hérodianus. Liv. II. ↵
5. Il est remarquable que, dans la remontrance présentée contre cet édit par le duc de Bourbon et les princes légitimes, on insiste sur la doctrine du contrat primitif, même sous ce gouvernement absolu. La nation française, disent-ils, en choisissant Hugues Capet et sa postérité pour la gouverner, elle et sa postérité, s’est tacitement réservé le droit de choisir une nouvelle famille royale lorsque celle de Capet viendrait à s’éteindre; et ce droit est lésé par l’édit appelant au trône les princes bâtards, sous le consentement de la nation. Mais le comte de Boulainvilliers, qui plaida la cause des princes bâtards, tourne la notion de contrat primitif en ridicule, et surtout l’application qu’on en faisait à Hugues Capet; ce roi, dit-il, parvint au trône par les mêmes artifices dont usèrent toujours tous les conquérants et les usurpateurs. Certes, il vit son droit reconnu par les états du royaume, après s’en être rendu possesseur: mais peut-on appeler cela un choix ou un contrat? Le comte de Boulainvilliers, on peut le remarquer, était connu pour âtre républicain; mais étant un homme de savoir, et très versé dans l’histoire, il n’ignorait pas que le peuple n’est presque jamais consulté dans les révolutions des états et les nouveaux établissements qui s’ensuivent, et que le temps seul accorde droit et autorité à ce qui n’était d’abord fondé, généralement, que sur la force et la violence. Voir Etat de la France, vol. III. ↵
6. Les anciens désignaient généralement le crime de rébellion par le mot de υεωτερίζειυ (novas res moliri). ↵
7. V. Locke sur le Gouvernement, ch. VII, par. 90. ↵
8. V. Locke, ch. II, par. 138, 139, 140. ↵