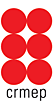Pour qu’une religion et un état obtiennent une longue existence, ils doivent souvent être ramenés à leur principe (Discorsi, III, 1)
[63]C'est une vérité constante que l'existence de toutes les choses de ce monde a un terme. Mais celles-là seules remplissent toute la carrière que le ciel leur a généralement marquée, qui se maintiennent dans leur ensemble avec une telle régularité, qu'elles ne peuvent éprouver de changement, ou que, si elles en éprouvent, c'est plutôt pour leur bien que pour leur mal.
Comme je parle ici de corps composés, tels que les républiques ou les religions, il m'est démontré qu'il n'y a pour eux de salutaire que les changements qui les ramènent à leur principe. Ainsi les mieux constitués, ceux dont l'existence se prolonge davantage, sont ceux auxquels leurs institutions permettent de se renouveler le plus souvent, ou qui, par quelque accident heureux, étranger à ces institutions, peuvent parvenir à ce renouvellement.
Il est plus évident que le jour, que lorsque ces corps ne se renouvellent pas, ils ne peuvent durer. La marche à suivre pour parvenir à ce renouvellement est, comme je l'ai déjà dit, de les ramener à leur principe. Il existe en effet, dans le principe des religions, des républiques, des monarchies, une certaine vertu au moyen de laquelle elles peuvent ressaisir leur premier éclat et le premier moteur de leur accroissement. Et comme le progrès du temps altère nécessairement cette vertu, tout le corps succombe sans retour, s'il ne survient quelque événement heureux qui le reporte à ses commencements. Aussi ceux qui sont versés dans la science de la médecine disent-ils, en parlant du corps humain: Quod quotidie aggregatur aliquid, quod quandoque indiget curatione.
Ce retour d'une réplique vers sont principe a lieu, ou par un accident extérieur, ou par une sagesse qui existe en elle.
[64]Pour le premier cas, on voit qu'il était nécessaire que Rome tombât entre les mains des Gaulois pour reprendre son existence, et pour qu'en renaissant elle retrouvât pour ainsi dire une nouvelle vie et une nouvelle vigueur, et reprît l'observance de la religion et de la justice, qui commençaient à perdre de leur pureté. C'est ce que Tite-Live développe admirablement dans son histoire, où il fait voir que, lorsqu'on envoya l'armée romaine à la rencontre des Gaulois, et qu'on procéda à l'élection des tribuns consulaires, on négligea l'observation de toutes les cérémonies religieuses. C'est ainsi que, loin de punir les trois Fabius, qui, malgré le droit des gens, avaient combattu les Gaulois, on les nomma tribuns. D'où l'on peut aisément conclure que les autres sages institutions que l'on tenait de Romulus et de la prudence de ses successeurs étaient déjà moins respectées qu'il ne fallait pour conserver un gouvernement libre.
Ce désastre étranger était donc nécessaire pour remettre en vigueur toutes les institutions qui faisaient la force de l'Etat, et faire sentir au peuple qu'il est indispensable non-seulement de maintenir la religion et la justice, mais encore d'entourer d'estime les citoyens vertueux, et de faire plus de cas de leur vertu que de ces avantages trompeurs dont leurs grandes actions semblaient le frustrer.
C'est, en effet, ce que l'on vit arriver. A peine Rome eut été reprise, qu'on s'empressa de rétablir toutes les institutions du culte antique; on punit les Fabius, qui avaient combattu contre le droit des gens, et l'on poussa si loin la reconnaissance pour les vertus et la magnanimité de Camille, que le sénat et le peuple, mettant de côté tout sentiment d'envie, remirent entre ses mains tout le fardeau de la république.
Il est donc nécessaire, comme je l'ai dit, que les hommes qui vivent réunis sous un gouvernement quelconque soient contraints de rentrer souvent en eux-mêmes, par la force des événements extérieurs, ou de ceux qui naissent dans son sein. Dans ce dernier cas, la réforme provient ou d'une loi qui oblige les membres de l'Etat à rendre un compte fréquent de leur conduite, ou d'un homme vertueux qui, né au milieu de ses concitoyens, les instruise d'exemple, et dont les nobles actions aient sur eux la même influence que les lois. L'ordre, dans une république, dépend donc ou de la sagesse d'un seul homme ou du pouvoir d'une institution. Dans ce dernier exemple, les institutions qui ramenèrent la république romaine à son principe furent l'établissement des tribuns du peuple, celui des censeurs, et toutes les lois que l'on porta contre l'ambition et l'orgueil des citoyens.
Ces réformes ont besoin de recevoir la vie des vertus d'un citoyen qui concoure avec courage à leur exécution, malgré la puissance de ceux qui outrepassent les lois. Parmi les châtiments mémorables de ce genre que Rome présente avant d'avoir été prise par les Gaulois, on remarque le supplice des fils de Brutus, la mort des décemvirs et celle de Spurius Moelius; après la prise de Rome, le supplice de Manlius Capitolinus, la condamnation du fils de Manlius Torquatus, le châtiment imposé par le consul Papirius Cursor à Fabius, son général de cavalerie; et enfin l'accusation intentée contre les Scipion. Ces exemples, que leur sévérité rendait d'autant plus remarquables, rappelaient, toutes les fois qu'ils se présentaient, les citoyens à leurs institutions primitives.
[65]A mesure qu'ils se montrèrent plus rares, la corruption rencontra un champ plus vaste, et ils devinrent plus difficiles et plus dangereux. Aussi ne faudrait-il pas qu'il se passât plus de dix ans entre les jugements de cette nature, parce qu'au delà de ce terme les hommes changent d'habitudes et commencent à s'élever au-dessus des lois. S'il n'arrive pas un événement qui réveille la crainte du châtiment et qui rétablisse dans tous les coeurs l'épouvante qu'inspirait la loi, les coupables se multiplient au point qu'on ne peut désormais les punir sans danger.
Ceux qui ont gouverné la république de Florence depuis l'an 1434 jusqu'en 1494 disaient, à ce propos, qu'il était nécessaire de reprendre le gouvernement tous les cinq ans, si l'on voulait pouvoir le maintenir; et ils appelaient reprendre le gouvernement, faire renaître dans l'âme des citoyens cette terreur et cette épouvante qu'ils avaient inspirées pour s'en emparer, en abattant tous ceux qui, selon les idées accréditées en ce moment parmi eux, n'avaient pas bien agi: parce qu'en effet, lorsque la mémoire de ces châtiments vient à s'éteindre, les hommes s'enhardissent à tenter des choses nouvelles et à se répandre en murmures. Il est nécessaire alors de prévenir ces maux, en ramenant l'Etat à son principe.
Ce retour d'une république à son principe naît encore des simples vertus d'un homme, et sans qu'aucune loi contraigne à y revenir: l'influence et l'exemple de ces vertus ont effectivement tant de force, que les hommes vertueux ne désirent rien tant que de l'imiter, et que les méchants mêmes rougiraient de paraître mener une vie opposée à la sienne. Ceux dont l'exemple eut particulièrement dans Rome cette heureuse influence sont les Horaclius Coclès, les Scevola, les Fabricius, les deux Decius, les Regulus, et tant d'autres dont la conduite rare et vertueuse produisit dans la république des effets presque aussi puissants que ceux qu'auraient pu obtenir les lois et les institutions antiques. Si les châtiments que nous avons rapportés, joints à l'exemple donné par de simples citoyens, s'étaient reproduits dans Rome au moins tous les dix ans, il en serait nécessairement résulté qu'elle ne se fût jamais corrompue. Mais à mesure que ces exemples commencèrent à devenir plus rares, la corruption s'étendit, et Marcus Regulus est le dernier modèle qu'elle offre à notre admiration. Quoique Rome ait vu naître depuis dans son sein les deux Caton, il y avait si loin d'eux au temps où vivait Regulus, la distance même qui les sépare l'un de l'autre était si grande, ils parurent tellement isolés au milieu de la corruption générale, que l'exemple de leurs vertus fut perdu pour leurs concitoyens. Le dernier Caton surtout, trouvant la république en grande partie corrompue, ne put, par son exemple, rendre ses concitoyens meilleurs. Mais j'en ai dit assez pour ce qui concerne les républiques.
Ces réformes ne sont pas moins nécessaires aux religions, et l'exemple de la nôtre en est une preuve convaincante. Si saint François et saint Dominique ne l'avaient rappelée à l'esprit de son institution, elle serait aujourd'hui entièrement éteinte; mais, en remettant en vigueur la pauvreté et l'exemple du Christ, ils la réveillèrent dans l'esprit des hommes, où elle était déjà expirante; et leurs règles nouvelles ont conservé un tel crédit, que la corruption des prélats et des chefs de la religion n'a pu causer sa ruine. En effet, par la pauvreté de leur vie, par l'influence que leur donnent sur le peuple la confession et la prédication, ils sont parvenus à lui persuader que c'est un péché de médire, [66] même du mal, et un mérite de vivre sous l'obéissance de ses chefs, et qu'on doit laisser à Dieu le soin de châtier leurs fautes; d'où il suit qu'on voit les prélats s'abandonner le plus qu'ils peuvent à leurs penchants criminels, parce qu'ils ne craignent point un châtiment qui ne frappe pas leurs yeux, et auquel ils ne croient point. Cette réforme a donc régénéré la religion, et c'est elle qui la maintient encore.
Les monarchies ont également besoin de se renouveler et de rappeler leurs lois à l'esprit de leur institution. C'est surtout dans le royaume de France que l'on découvre l'effet salutaire que produit cette conduite, son gouvernement, plus que tout autre, étant soumis à l'empire des lois et des institutions. Ce sont ses parlements, et surtout celui de Paris, qui en sont les conservateurs et les gardiens. Les constitutions de l'Etat sont remises en vigueur toutes les fois qu'ils portent une sentence contre un des princes du royaume, et que leurs jugements atteignent le roi-lui-même. S'ils ont pu se maintenir jusqu'à nos jours, c'est pour s'être constamment opposés avec courage aux prétentions de la noblesse; mais s'ils en laissaient une seule impunie, et qu'elles vinssent à s'accroître, il en résulterait nécessairement, ou que les abus ne pourraient se corriger sans de grands désordres, ou que le royaume tomberait en ruine.
Il faut conclure de ce que je viens d'exposer que, dans tout ordre social quelconque, soit qu'il appartienne à une religion, à un royaume ou à une république, rien n'est plus nécessaire que de lui rendre cette prospérité qu'il avait dans son principe, et de faire en sorte qu'il la redoive, soit à l'excellence de ses lois, soit à l'exemple des citoyens vertueux, et non pas à l'emploi d'une force étrangère. Quoique ce moyen soit quelquefois excellent, comme le prouve l'exemple de Rome, il est tellement dangereux d'en faire usage, qu'il faut plutôt craindre que désirer de s'en servir. Au surplus, pour prouver combien l'exemple des simples citoyens contribua à la grandeur de Rome, et l'influence qu'il exerça sur la république, j'en ferai la matière des chapitres suivants; et c'est sur ce sujet que roulera le troisième et dernier livre de ces réflexions sur la première décade de l'historien romain. Et, bien que les hauts faits de ses rois méritent d'être célébrés, néanmoins, comme les historiens les ont rapportés en détail, je les passerai sous silence, à l'exception de quelques faits particuliers opérés par eux dans leur intérêt personnel. Je commencerai par Brutus, le père de la liberté romaine.