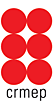Quatre lettres sur Machiavel
I. Elisabeth à Descartes
La Haye, juillet 1646
Monsieur Descartes,
Puisque votre voyage est arrêté pour le 3me/13 de ce mois, il faut que je vous présente la promesse que vous m’avez faite de quitter votre agréable solitude, pour me donner le bonheur de vous voir, avant que mon partement d’ici m’en fasse perdre l’espérance pour six ou sept mois, qui est le terme le plus éloigné que le congé de la Reine ma mère, de M. mon frère, et le sentiment des amis de notre maison ont prescrit à mon absence. Mais il me serait encore trop long, si je ne m’assurais que vous y continuerez la charité de me faire profiter de vos Méditations par vos lettres, puisque, sans leur assistance, les froideurs du nord, et le calibre des gens avec qui je pourrais converser, éteindraient ce petit rayon de sens commun que je tiens de la nature, et dont je reconnais l’usage par votre méthode. On me promet en Allemagne assez de loisir et de tranquillité pour la pouvoir étudier, et je n’y amène de plus grands trésors, d’où je prétends tirer plus de satisfaction, que vos écrits. J’espère que vous me permettrez d’emporter celui des passions, encore qu’il n’a été capable de calmer ceux que notre dernier malheur avait excités. Il fallait que votre présence y apportât la cure, que vos maximes ni mon raisonnement n’avaient pu appliquer. Les préparations de mon voyage et les affaires de mon frère Philippe, joints à une complaisance de bienséance pour les plaisirs de ma tante, m’ont empêchée jusqu’ici de vous rendre les remerciements que je vous devais pour l’utilité de cette visite; je vous prie de les recevoir à cette heure de
Votre très affectionnée amie à vous servir,
Elisabeth.
[54]Je suis obligée d’envoyer celle-ci par le messager, parce que sa promptitude m’est plus nécessaire, à cette heure, que sa sûreté.
II. Descartes à Elisabeth
Egmond, septembre 1646
Madame,
J’ai lu le livre dont Votre Altesse m’a commandé de lui écrire mon opinion, et j’y trouve plusieurs préceptes qui me semblent fort bons; comme entre autres au 19 et 20e chapitres: Qu’un Prince doit toujours éviter la haine et le mépris de ses sujets, et que l’amour du peuple vaut mieux que les forteresses. Mais il y en a aussi plusieurs autres que je ne saurais approuver. Et je crois que ce en quoi l’Auteur a le plus manqué, est qu’il n’a pas mis assez de distinction entre les Princes qui ont acquis un Etat par des voies justes, et ceux qui l’ont usurpé par des moyens illégitimes; et qu’il a donné à tous, généralement, les préceptes qui ne sont propres qu’à ces derniers. Car comme, en bâtissant une maison dont les fondements sont si mauvais qu’ils ne sauraient soutenir des murailles hautes et épaisses, on est obligé de les faire faibles et basses, ainsi ceux qui ont commencé à s’établir par des crimes sont ordinairement contraints de continuer à commettre des crimes, et ne se pourraient maintenir s’ils voulaient être vertueux.
C’est au regard de tels Princes qu’il a pu dire, au chapitre 3: Qu’ils ne sauraient manquer d’être haîs de plusieurs; et qu’ils ont souvent plus d’avantage à faire beaucoup de mal qu’à en faire moins, pour ce que les légères offenses suffisent pour donner la volonté de se venger, et que les grandes en ôtent le pouvoir. Puis, au chapitre 15: Que, s’ils voulaient être gens de bien, il serait impossible qu’ils ne se ruinassent parmi le grand nombre de méchants qu’on trouve partout. Et au chapitre 19: Qu’on peut être haî pour de bonnes actions aussi bien que pour de mauvaises.
Sur lesquels fondements il appuie des préceptes très tyranniques, comme de vouloir qu’on ruine tout un pays, afin d’en demeurer le maître; qu’on exerce de grandes cruautés, pourvu que ce soit promptement et tout à la fois; qu’on tâche de paraître homme de bien, mais qu’on ne le soit pas véritablement; qu’on ne tienne sa parole qu’aussi longtemps qu’elle sera utile; qu’on dissimule, qu’on trahisse; et enfin que, pour régner, on se dépouille de toute humanité, et qu’on devienne le plus farouche de tous les animaux.
[55]Mais c’est un très mauvais sujet pour faire des livres, que d’entreprendre d’y donner de tels préceptes, qui, au bout du compte, ne sauraient assurer ceux auxquels il les donne; car, comme il avoue lui-même, ils ne se peuvent garder du premier qui voudra négliger sa vie pour se venger d’eux. Au lieu que, pour instruire un bon Prince, quoique nouvellement entré dans un Etat, il me semble qu’on lui doit proposer des maximes toutes contraires, et supposer que les moyens dont il s’est servi pour s’établir ont été justes; comme, en effet, je crois qu’ils le sont presque tous, lorsque les Princes qui les pratiquent les estiment tels; car la justice entre les Souverains a d’autres limites qu’entre les particuliers, et il semble qu’en ces rencontres Dieu donne le droit à ceux auxquels il donne la force. Mais les plus justes actions deviennent injustes, quand ceux qui les font les pensent telles.
On doit aussi distinguer entre les sujets, les amis ou alliés et les ennemis. Car, au regard de ces derniers, on a quasi permission de tout faire, pourvu qu’on en tire quelque avantage pour soi ou pour ses sujets; et je ne désapprouve pas, en cette occasion, qu’on accouple le renard avec le lion, et qu’on joigne l’artifice à la force. Même je comprends, sous le nom d’ennemis, tous ceux qui ne sont point amis ou alliés, pour ce qu’on a droit de leur faire la guerre, quand on y trouve son avantage, et que, commençant à devenir suspects et redoutables, on a lieu de s’en défier. Mais j’excepte une espèce de tromperie, qui est si directement contraire à la société, que je ne crois pas qu’il soit jamais permis de s’en servir, bien que notre Auteur l’approuve en divers endroits, et qu’elle ne soit que trop en pratique: c’est de feindre d’être ami de ceux qu’on veut perdre, afin de les pouvoir mieux surprendre. L’amitié est une chose trop sainte pour en abuser de la sorte; et celui qui aura pu feindre d’aimer quelqu’un, pour le trahir, mérite que ceux qu’il voudra par après aimer véritablement, n’en croient rien et le haïssent.
Pour ce qui regarde les alliés, un Prince leur doit tenir exactement sa parole, même lorsque cela lui est préjudiciable; car il ne le saurait être tant, que la réputation de ne manquer point à faire ce qu’il a promis lui est utile; et il ne peut acquérir cette réputation que par de telles occasions, où il y va pour lui de quelque perte; mais en celles qui le ruineraient tout à fait, le droit des gens le dispense de sa promesse. Il doit aussi user de beaucoup de circonspection, avant que de promettre, afin de pouvoir toujours garder sa foi. Et bien qu’il soit bon d’avoir amitié avec la plupart de ses voisins, je crois néanmoins que le meilleur est de n’avoir point d’étroites alliances, qu’avec ceux qui sont moins puissants. Car, quelque fidélité qu’on se propose d’avoir, on ne doit pas attendre la pareille des autres, mais faire son compte qu’on en sera trompé, toutes les fois qu’ils y trouveront leur avantage; et ceux qui sont plus puissants l’y peuvent trouver, quand ils veulent, mais non pas ceux qui le sont moins.
Pour ce qui est des sujets, il y en a de deux sortes: à savoir les grands et le peuple. Je comprends, sous le nom de grands, tous ceux qui peuvent former des partis contre le Prince, de la fidélité desquels il doit être très assuré; ou, s’il ne l’est pas, tous les politiques sont d’accords qu’il doit employer tous ses soins à les abaisser, et qu’en tant qu’ils sont enclins à brouiller l’Etat, il ne les doit considérer que comme ennemis. Mais, pour ses autres sujets, il doit surtout éviter leur haine et leur mépris; ce que je crois qu’il peut toujours faire, pourvu qu’il observe exactement la justice à leur mode (c’est-à-dire suivant [56] les lois auxquelles ils sont accoutumés), sans être trop rigoureux aux punitions, ni trop indulgent aux grâces, et qu’il ne se remette pas de tout à ses Ministres, mais que, leur laissant seulement la charge des condamnations plus odieuses, il témoigne avoir lui-même le soin de tout le reste; puis aussi, qu’il retienne tellement sa dignité, qu’il ne quitte rien des honneurs et des déférences que le peuple croit lui être dues, mais qu’il n’en demande point davantage, et qu’il ne fasse paraître en public que ses plus sérieuses actions, ou celles qui peuvent être approuvées de tous, réservant à prendre ses plaisirs en particulier, sans que ce soit jamais au dépens de personne; et enfin qu’il soit immuable et inflexible, non pas aux premiers desseins qu’il aura formés en soi-même, car d’autant qu’il ne peut avoir l’oeil partout, il est nécessaire qu’il demande conseil, et entende les raisons de plusieurs, avant que de se résoudre; mais qu’il soit inflexible touchant les choses qu’il aura témoigné avoir résolues, encore même qu’elles lui fussent nuisibles; car malaisément le peuvent-elles être tant que serait la réputation d’être léger et variable.
Ainsi je désapprouve la maxime du chapitre 15: Que, le monde étant fort corrompu, il est impossible qu’on ne se ruine, si l’on veut être toujours homme de bien, et qu’un Prince, pour se maintenir, doit apprendre à être méchant, lorsque l’occasion le requiert; si ce n’est peut-être que, par un homme de bien, il entende un homme superstitieux et simple, qui n’ose donner bataille au jour du Sabbat, et dont la conscience ne puisse être en repos, s’il ne change la religion de son peuple. Mais, pensant qu’un homme de bien est celui qui fait tout ce que lui dicte la vraie raison, il est certain que le meilleur est de tâcher à l’être toujours.
Je ne crois pas aussi ce qui est au chapitre 19: Qu’on peut autant être haî pour les bonnes actions, que pour les mauvaises, sinon en tant que l’envie est une espèce de haine; mais cela n’est pas le sens de l’Auteur. Et les Princes n’ont pas coutume d’être enviés par le commun de leurs sujets; ils le sont seulement par les grands, ou par leurs voisins, auxquels les mêmes vertus qui leur donnent de l’envie, leur donnent aussi de la crainte; c’est pourquoi jamais on ne doit s’abstenir de bien faire, pour éviter cette sorte de haine; et il n’y en a point qui leur puisse nuire, que celle qui vient de l’injustice ou de l’arrogance que le peuple juge être en eux. Car on voit même que ceux qui ont été condamnés à la mort, n’ont point coutume de haîr leurs juges, quand ils pensent l’avoir méritée; et on souffre aussi avec patience les maux qu’on n’a point mérités, quand on croit que le Prince, de qui on les reçoit, est en quelque façon contraint de les faire, et qu’il en a du déplaisir; pour ce qu’on estime qu’il est juste qu’il préfère l’utilité publique à celle des particuliers. Il y a seulement de la difficulté, lorsqu’on est obligé de satisfaire à deux partis qui jugent différemment de ce qui est juste, comme lorsque les Empereurs Romains avaient à contenter les Citoyens et les Soldats; auquel cas il est raisonnable d’accorder quelque chose aux uns et aux autres, et on ne doit pas entreprendre de faire venir tout d’un coup à la raison ceux qui ne sont pas accoutumés de l’entendre; mais il faut tâcher peu à peu, soit par des écrits publics, soit par les voix des Prédicateurs, soit par tels autres moyens, à la leur faire concevoir. Car enfin le peuple souffre tout ce qu’on lui peut persuader être juste, et s’offense de tout ce qu’il imagine d’être injuste; et l’arrogance des Princes, c’est-à-dire l’usurpation de quelque autorité, de quelques droits, ou de quelques honneurs qu’il croit ne leur être point dus, ne lui est odieuse, que pour ce qu’il la considère comme une espèce d’injustice.
[57]Au reste, je ne suis pas aussi de l’opinion de cet Auteur, en ce qu’il dit en sa Préface: Que, comme il faut être dans la plaine, pour mieux voir la figure des montagnes, lorsqu’on en veut tirer le crayon ainsi on doit être de condition privée, pour bien connaître l’office d’un Prince. Car le crayon ne représente que les choses qui se voient de loin; mais les principaux motifs des actions des Princes sont souvent des circonstances si particulières que, si ce n’est qu’on soit Prince soi-même, ou bien qu’on ait été fort longtemps participant de leurs secrets, on ne les saurait imaginer.
C’est pourquoi je mériterais d’être moqué, si je pensais pouvoir enseigner quelque chose à Votre Altesse en cette matière; aussi n’est-ce pas mon dessein, mais seulement de faire que mes lettres lui donnent quelque sorte de divertissement, qui soit différent de ceux que je m’imagine qu’elle a en son voyage, lequel le jui souhaite parfaitement heureux: comme sans doute il le sera, si Votre Altesse se résout de pratiquer ces maximes qui enseignent que la félicité d’un chacun dépend de lui-même, et qu’il faut tellement se tenir hors de l’empire de la Fortune, que, bien qu’on ne perde pas les occasions de retenir les avantages qu’elle peut donner, on ne pense pas toutefois être malheureux lorsqu’elle les refuse; et pour ce qu’en toutes les affaires du monde il y a quantité de raisons pour et contre, qu’on s’arrête principalement à considérer celles qui servent à faire qu’on approuve les choses qu’on voit arriver. Tout ce que j’estime le plus inévitable sont les maladies du corps, desquelles je prie Dieu qu’il vous préserve; et je suis avec toute la dévotion que je puis avoir, etc ...
III. Elisabeth à Descartes
Berlin, 10 octobre 1646
Monsieur Descartes,
Vous avez raison de croire que le divertissement que vos lettres m’apportent, est différent de celui que j’ai eu au voyage, puisqu’il me donne une satisfaction plus grande et plus durable; encore que j’aie trouvée en celui-ci toute celle que me peuvent donner l’amitié et les caresses de mes proches, je les considère comme choses qui pourraient changer, au lieu que les vérités que celles-là m’apprennent laissent des impressions en mon esprit, qui contribueront toujours au contentement de ma vie.
J’ai mille regrets de n’avoir point amené le livre, que vous avez pris la peine d’examiner pour m’en dire votre sentiment, par terre, me laissant persuader que le bagage que j’enverrais par mer à Hamburg, serait ici plus tôt [58] que nous; et il n’y est pas encore, quoi que nous y sommes arrivés le 7/17 septembre du passé. C’est pourquoi je ne me saurais représenter des maximes de cet auteur qu’autant qu’une très mauvaise mémoire me peut fournir d’un livre que je n’ai point regardé de six ans. Mais il me souvient que j’en approuvais alors quelques-unes, non pour être bonnes de soi, mais parce qu’elles causent moins de mal que ceux dont se servent une quantité d’ambitieux imprudents, que je connais, qui ne tendent qu’à brouiller, et laisser le reste à la fortune; et celles de cet auteur tendent toutes à l’établissement.
Il me semble aussi que, pour enseigner le gouvernement d’un Etat, il se propose l’Etat le plus difficile à gouverner, où le prince est un nouvel usurpateur, au moins en l’opinion du peuple; et en ce cas, l’opinion qu’il aura lui-même de la justice de sa cause, pourrait servir au repos de sa conscience, mais non à celui de ses affaires, où les lois contrarient son autorité, où les grands la contreminent et où le peuple la maudit. Et lorsque l’Etat est ainsi disposé, les grandes violences font moins de mal que les petites, parce que celles-ci offensent aussi bien que celles-là, et donnent sujet à une longue guerre; celles-là en ôtent le courage et les moyens aux grands qui la pourront entreprendre. De même, lorsque les violences viennent promptement et tout à la fois, elles fâchent moins qu’elles n’étonnent, et sont aussi plus supportables au peuple qu’une longue suite de misères que les guerres civiles apportent.
Il me semble qu’il y ajoute encore, ou bien l’enseigne, par l’exemple du neveu du pape Alexandre, qu’il propose comme un politique parfait, que le Prince doit employer à ces grandes cruautés quelque Ministre qu’il puisse par après sacrifier à la haine du peuple, et quoi qu’il paraisse injuste au Prince de faire périr un homme qui lui aurait obéi, je trouve que des personnes si barbares et dénaturées, qui se veulent employer à servir de bourreau à tout un peuple, pour quelque considération que ce soit, ne méritent point de meilleur traitement; et pour moi, je préfèrerais la condition du plus pauvre paysan d’Hollande, à celle du Ministre qui voudrait obéir à pareils ordres, ou à celle du Prince qui serait contraint de les donner.
Lorsque le même auteur parle des alliés, il les suppose, pareillement, aussi méchants qu’ils peuvent être, et les affaires en telle extrémité, qu’il faut perdre toute une république, ou rompre sa parole à ceux qui ne la gardent qu’aussi longtemps qu’elle leur est utile.
Mais, s’il a tort de faire des maximes générales de ce qui ne se doit pratiquer qu’en fort peu d’occasions, il pèche en cela également avec presque tous les Saints-Pères et les anciens philosophes, qui en font de même; et je crois que cela vient du plaisir qu’ils prennent à dire des paradoxes, qu’ils peuvent après expliquer à leurs écoliers. Lorsque cet homme ici dit qu’on se ruine, si on veut toujours être homme de bien, je crois qu’il n’entend point que, pour être homme de bien, il faut suivre les lois de la superstition, mais cette loi commune, qu’il faut faire à chacun, comme on voudrait avoir fait à soi: ce que les princes ne sauraient presque jamais observer à un particulier de leurs sujets, qu’il faut perdre toutes les fois que l’utilité publique le requiert. Et puisque, devant vous, personne n’a dit que la vertu ne consiste qu’à suivre la droite raison, mais lui ont prescrit quelques lois ou règles plus particulières, il ne faut point s’étonner qu’ils ont manqué à la bien définir.
[59]Je trouve que la règle, que vous observez en sa préface, est fausse, parce qu’il n’a point connu de personne clairvoyante en tout ce qu’elle se propose, comme vous êtes, par conséquent qui, de privée et retirée hors de l’embarras du monde, serait néanmoins capable d’enseigner aux princes comme ils doivent gouverner, comme il parait à ce que vous en écrivez.
Pour moi, qui n’en ai que le titre, je n’étudie qu’à me servir de la règle que vous mettez à la fin de votre lettre, en tâchant de me rendre les choses présentes les plus agréables que je puis. Ici je n’y rencontre point beaucoup de difficulté, étant en une maison où j’ai été chérie depuis mon enfance et où tout le monde conspire à me faire des caresses. Encore que ceux-là me détournent quelquefois d’occupations plus utiles, je supporte aisément cette incommodité, par le plaisir qu’il y a d’être aimé de ses proches. Voilà, Monsieur, la raison que je n’ai eu plutôt le loisir de vous rendre compte de l’heureux succès de notre voyage, comme il s’est passé sans incommodité aucune, avec la promptitude que je vous ai dit ci-dessus, et de la fontaine miraculeuse dont vous me parlâtes à La Haye.
Je n’en ai été qu’une petite lieue éloignée, à Cheuningen, où nous avons rencontré toute la famille de céans qui en venait. M. l’Electeur m’y voulait mener pour la voir; mais puisque le reste de notre compagnie opinait pour un autre divertissement, je n’osais point leur contredire, et me satisfaisais d’en voir et goûter l’eau, dont il y a diverses sources de différent goût; mais on ne se sert principalement que de deux, dont la première est claire, salée, et une forte purge; l’autre, un peu blanchâtre, goûte comme de l’eau mêlée avec du lait, et est, à ce qu’on dit, rafraîchissante. On parle de quantité de guérisons miraculeuses qu’elles font; mais je n’en ai pu apprendre de personne digne de foi. Ils disent bien que ce lieu est rempli de pauvres, qui publient avoir été nés sourds, aveugles, boiteux ou bossus, et trouvé leur guérison en cette fontaine. Mais puisque ce sont des gens mercenaires, et qu’ils rencontrent une nation assez crédule aux miracles, je ne crois pas que cela doive persuader les personnes raisonnables. De toute la cour de M. l’Electeur mon cousin, il n’y a eu que son grand Ecuyer, qui s’en est bien trouvé. Il a eu une blessure sous l’oeil droit, dont il a perdu la vue d’un côté, par le moyen d’une petite peau, qui lui est venue dessus cet oeil; et l’eau salée de cette fontaine, étant appliquée sur l’oeil, a dissipé ladite peau, tellement qu’il peut, à cette heure, discerner les personnes en fermant l’oeil gauche. Outre qu’étant homme de complexion forte et de mauvaise diète, une bonne purge ne lui pouvait nuire, comme elle a fait à plusieurs autres.
J’ai examiné le chiffre que vous m’avez envoyé, et le trouve fort bon, mais trop prolixe pour écrire tout un sens; et si on n’écrit que peu de paroles, on les trouverait par la quantité des lettres. Il vaudrait mieux faire une clef des paroles par l’alphabet, et puis marquer quelque distinction entre les nombres qui signifient des lettres et celles qui signifient des paroles.
J’ai ici si peu de loisir à écrire, que je suis contrainte de vous envoyer ce brouillon, où vous pouvez remarquer, à la différence de la plume, toutes les fois que j’ai été interrompue. Mais j’aime mieux paraître devant vous avec toutes mes fautes, que de vous donner sujet de croire que j’ai un vice si éloigné de mon naturel, comme celui d’oublier mes amis en l’absence, principalement [60] une personne que je ne saurais cesser d’affectionner, sans cesser d’être aussi raisonnable, comme vous, Monsieur, à qui je serai toute ma vie,
Votre très affectionnée amie à vous servir,
Elisabeth.
IV. Descartes à Elisabeth
Novembre 1646.
Madame,
J’ai reçu une très grande faveur de Votre Altesse, en ce qu’elle a voulu que j’apprisse par ses lettres le succès de son voyage, et qu’elle est arrivée heureusement en un lieu où, étant grandement estimée et chérie de ses proches, il me semble qu’elle a autant de biens qu’on en peut souhaiter avec raison en cette vie. Car, sachant la condition des choses humaines, ce serait trop importuner la fortune, que d’attendre d’elle tant de grâces, qu’on ne pût pas, même en imaginant, trouver aucun sujet de fâcherie. Lorsqu’il n’y a point d’objets présents qui offensent les sens, ni aucune indisposition dans le corps qui l’incommode, un esprit qui suit la vraie raison peut facilement se contenter. Et il n’est pas besoin, pour cela, qu’il oublie ni qu’il néglige les choses éloignées; c’est assez qu’il tâche à n’avoir aucune passion pour celles qui lui peuvent déplaire: ce qui ne répugne point à la charité, pour ce qu’on peut souvent mieux trouver des remèdes aux maux qu’on examine sans passion, qu’à ceux pour lesquels on est affligé. Mais, comme la santé du corps et la présence des objets agréables aident beaucoup à l’esprit, pour chasser hors de soi toutes les passions qui participent de la tristesse, et donner entrée à celles qui participent de la joie, ainsi, réciproquement, lorsque l’esprit est plein de joie, cela sert beaucoup à faire que le corps se porte mieux, et que les objets présents paraissent plus agréables.
Et même aussi j’ose croire que la joie intérieure a quelque secrète force pour se rendre la Fortune plus favorable. Je ne voudrais pas écrire ceci à des personnes qui auraient l’esprit faible, de peur de les induire à quelque superstition; mais, au regard de Votre Altesse, j’ai seulement peur qu’elle se moque de me voir devenir trop crédule. Toutefois j’ai une infinité d’expériences, et avec cela l’autorité de Socrate, pour confirmer mon opinion. Les expériences sont que j’ai souvent remarqué que les choses que j’ai faites avec un coeur gai, et sans aucune répugnance intérieure, ont coutume de me succéder heureusement, jusques là même que, dans les jeux de hasard, où il n’y a que Fortune seule qui règne, je l’ai toujours éprouvée plus favorable, ayant d’ailleurs [61] des sujets de joie, que lorsque j’en avais de tristesse. Et ce qu’on nomme communément le génie de Socrate, n’a sans doute été autre chose, sinon qu’il avait accoutumé de suivre ses inclinations intérieures, et pensait que l’événement de ce qu’il entreprenait serait heureux, lorsqu’il avait quelque secret sentiment de gaieté, et, au contraire, qu’il serait malheureux, lorsqu’il était triste. Il est vrai pourtant que ce serait être superstitieux, de croire autant à cela, qu’on dit qu’il faisait; car Platon rapporte de lui que même il demeurait dans le logis, toutes les fois que son génie ne lui conseillait point d’en sortir. Mais, touchant les actions importantes de la vie, lorsqu’elles se rencontrent si douteuses, que la prudence ne peut enseigner ce qu’on doit faire, il me semble qu’on a grande raison de suivre le conseil de son génie, et qu’il est utile d’avoir une forte persuasion que les choses que nous entreprenons sans répugnance, et avec la liberté qui accompagne d’ordinaire la joie, ne manqueront pas de nous bien réussir.
Ainsi j’ose ici exhorter Votre Altesse, puisqu’elle se rencontre en un lieu où les objets présents ne lui donnent que de la satisfaction, qu’il lui plaise aussi contribuer du sien, pour tâcher à se rendre contente; ce qu’elle peut, ce me semble, aisément, en n’arrêtant son esprit qu’aux choses présentes, et ne pensant jamais aux affaires, qu’aux heures où le courrier est prêt de partir. Et j’estime que c’est un bonheur que les livres de Votre Altesse n’ont pu lui être apportés sitôt qu’elle les attendait; car leur lecture n’est pas si propre à entretenir la gaieté, qu’à faire venir la tristesse, principalement celle du livre de ce Docteur des Princes, qui, ne représentant que les difficultés qu’ils ont à se maintenir, et les cruautés ou perfidies qu’il leur conseille, fait que les particuliers qui le lisent, ont moins de sujet d’envier leur condition, que de la plaindre.
Votre Altesse a parfaitement bien remarqué ses fautes, et les miennes; car il est vrai que c’est le dessein qu’il a eu de louer César Borgia, qui lui a fait établir des maximes générales, pour justifier des actions particulières qui peuvent difficilement être excusées; et j’ai lu depuis ses discours sur Tite-Live, où je n’ai rien remarqué de mauvais. Et son principal précepte, qui est d’extirper entièrement ses ennemis, ou bien de se les rendre amis, sans suivre jamais la voie du milieu, est sans doute toujours le plus sûr; mais, lorsqu’on n’a aucun sujet de craindre, ce n’est pas le plus généreux.
Votre Altesse a aussi fort bien remarqué le secret de la fontaine miraculeuse, en ce qu’il y a plusieurs pauvres qui en publient les vertus, et qui sont peut-être gagés par ceux qui en espèrent du profit. Car il est certain qu’il n’y a point de remède qui puisse servir à tous les maux; mais, plusieurs ayant usé de celui-là, ceux qui s’en sont bien trouvés en disent du bien, et on ne parle point des autres. Quoi qu’il en soit, la qualité de purger, qui est en l’une de ces fontaines, et la couleur blanche avec la douceur et la qualité rafraîchissante de l’autre, donnent occasion de juger qu’elles passent par des mines d’Antimoine ou de Mercure, qui sont deux mauvaises drogues, principalement le Mercure. C’est pourquoi je ne voudrais pas conseiller à personne d’en boire. Le vitriol et le fer des eaux de Spa sont bien moins à craindre; et pour ce que l’un et l’autre diminue la rate et fait évacuer la mélancolie, je les estime.
[62]Car Votre Altesse me permettra, s’il lui plaît, de finir cette lettre par où je l’ai commencée, et de lui souhaiter principalement de la satisfaction d’esprit et de la joie, comme étant non seulement le fruit qu’on attend de tous les autres biens, mais aussi souvent un moyen qui augmente les grâces qu’on a pour les acquérir; et bien que je ne sois pas capable de contribuer à aucune chose qui regarde votre service, sinon seulement par mes souhaits, j’ose pourtant assurer que je suis plus parfaitement qu’aucun autre qui soit au monde etc.