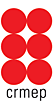Gravité de Rousseau
[43]Des premiers Discours aux Rêveries l’oeuvre de Rousseau ne cesse de désigner, à l’intérieur d’elle-même, son propre extérieur; travail de partage obstiné, opéré sur un monde d’abord perçu comme obscur, confus, contradictoire, et qui peu à peu le constitue en système: l’autre système, système tout à la fois extérieur et de l’extériorité, qui n’est chassé dans le dehors de l’oeuvre que parce qu’il est le dehors même de la nature en étant sa représentation aliénée; et que l’oeuvre, elle, ne se veut rien d’autre que le système même de la nature réapparaissant au regard dans l’intégralité de sa présence. Il n’y aurait pas eu d’oeuvre si, au départ, il n’y avait pas eu douleur, contradictions, déchirement du sujet, - symptômes non pas d’un ordre qui se défait, mais comme d’une maladie qui gagne, active, vivante, proliférant sur le champ ordonné de la nature, dont elle utilise les forces pour la retourner contre elle-même. L’oeuvre de Rousseau est profondément une oeuvre de réaction. Elle ne naît, ne se constitue, ne se développe en système que de se provoquer elle-même.
Il y a deux sortes de silence chez Rousseau. Celui de l’origine, où il n’y a rien à dire, parce qu’il n’y a rien d’autre à dire que la nature même: langage silencieux des gestes, du visage qui n’est en quelque sorte que la nature jouissant d’elle-même, jouant avec sa propre multiplicité. Rien n’est signe et tout est signe. La voix même est comme muette, elle ne survient pas à la nature pour la représenter: chantant elle est la nature s’enchantant. Ce silence bruissant infiniment riche d’expression est celui du sauvage. L’enfant le retrouve: “On a longtemps cherché s’il y avait une langue naturelle et commune à tous les hommes, sans doute, il y en a une; et c’est celle que les enfants parlent avant de savoir parler”.1 Mais c’est aussi le silence de l’homme naturel accompli, devant le texte2> d’une nature déployée dans toute sa diversité, et que seul son regard, coextensif à elle, peut entendre et comprendre: l’oeil écoute et parle. Et c’est encore le silence des peuples heureux, dans un état où la Volonté Générale n’a pas à prendre la parole parce que l’état, à tout moment, est cette parole même.
[44]A l’opposé, il y a un autre silence, qui est celui de l’esclavage. La Volonté Générale se tait sous la tyrannie, la conscience sous l’opinion, la parole sous l’écriture, et en général le sujet sous la voûte de ses représentations qui lui échappent, captent, détournent et emportent sa voix: il était le sujet de ses représentations, elles s’assujettissaient à lui au point de ne s’en pas distinguer. Il en est maintenant le sujet, mais assujetti à elles dans une sujétion qui lui ôte toute liberté. Et, ici aussi, le plus profond silence se donne sous l’apparence d’un perpétuel bruissement: Tout est devenu signe, mais rien n’est plus signe. Muet parce qu’il était pris dans le discours de la nature, le sujet est maintenant pris tout entier dans le discours de l’autre de la nature, qui lui impose silence.
C’est entre ces deux silences que naît l’oeuvre de Rousseau, rompant l’un pour échapper à l’autre.
Depuis le jour où l’équilibre en repos de la Nature première a été anéanti, par “celui qui toucha du doigt l’axe du globe et l’inclina sur l’axe de l’univers”3 l’histoire du monde est la recherche sans fin d’un centre de gravité introuvable, dans un déséquilibre qui va en s’aggravant. Le monde est aujourd’hui le produit, complexe et monstrueux, d’un long procès de perversion, tant de la Nature que du Droit, par lequel le sujet (l’homme ou l’Etat) a peu à peu basculé hors de lui-même pour ne vivre-désormais que dans l’excentricité de leur représentation.
Contre ce monde, l’oeuvre de Rousseau fonctionne comme un contrepoids ou plus exactement comme un système de contrepoids. Au vrai, comme nous le verrons, l’oeuvre donne en elle-même la théorie de sa propre fonction. Il suffit ainsi de se référer à la théorie de l’instinct physique ou moral, développé par exemple dans la Profession de foi: l’instinct est toujours instinct de conservation d’un sujet qui doit être un sans être simple, c’est-à-dire équilibré, et il maintient cet équilibre en contrebalançant le développement hypertrophique et pathologique de telle ou telle faculté. On retient le plus souvent de ce principe d’équilibre, son utilisation par Rousseau pour rendre compte de la genèse des facultés de l’homme: une faculté (la raison, l’imagination, etc ...) ne se développe que lorsque le besoin s’en fait sentir, lorsque des obstacles se présentent qui ne peuvent pas être surmontés par les moyens déjà existants. Mais cette actualisation des facultés virtuelles n’est que l’aspect normal du jeu de ce principe d’équilibre, celui qui est à l’oeuvre dans la genèse d’un sujet de droit comme Emile qui n’a de rapport qu’avec les choses, et non avec les hommes et leur représentation d’eux-mêmes et des choses, - ou [45] dans celle de l’Etat du Contrat Social, qui lui aussi est seul et n’a de rapport avec aucun autre.
Mais ce qui est donné à l’homme d’aujourd’hui, ce n’est plus l’immédiateté de la nature, mais le monde excentrique de la représentation, et l’homme de l’homme. L’instinct joue alors pour supprimer le déséquilibre créé par les facultés mêmes de l’homme. Aussi se déplace-t-il et prend-il différents noms, selon la faculté dont il doit balancer les excès: sentiment lorsque la raison, sans frein, se lance dans les constructions chimériques d’un système matérialiste, où la pensée en vient à se nier elle-même, raison au contraire lorsque l’imagination se perd dans les absurdités de la religion révélée, conscience lorsque la passion emporte au mal. Si loin qu’il ait été entraîné par le procès de perversion, l’individu ne peut faire qu’il se dénature absolument, qu’il bascule une fois pour toutes et rompe définitivement le fil qui le relie à son origine. La voix de la nature parlera toujours, si un moment on l’écoute dans le silence des passions. De même, la Volonté Générale, dans l’Etat, est indestructible: elle parlera toujours, pour peu qu’on lui en donne l’occasion en l’interrogeant pertinemment, et le lieu en rassemblant le peuple entier dans l’enclos des Comices, tout gouvernement et toute autre autorité que la sienne étant du même coup suspendue.
L’oeuvre de Rousseau veut n’être pour la nature et le droit, que cette occasion et ce lieu. Son écriture se donne comme le recueil même de la nature et du droit, et dégage, découvre inlassablement un lieu pour les laisser apparaître dans leur immédiateté, et parler sans Représentant: “A l’instant que le Peuple est légitimement assemblé en corps Souverain, toute juridiction du Gouvernement cesse, la puissance exécutive est suspendue … parce qu’où se trouve le Représenté, il n’y a plus de Représentant.”4 C’est pourquoi, paradoxalement, la fin qui hante dès son début, est d’être un discours sans sujet, d’être le discours même de la Nature, le calque de ce texte immense qui se propose au regard du Vicaire Savoyard. La référence au Moi n’est pas d’abord le retour à une subjectivité singulière, mais bien l’étape obligée par quoi l’on doit passer pour retrouver le lieu commun où le regard se confond avec le spectacle.
En cela, Rousseau ne diffère pas des empiristes et sensualistes du XVIIIe siècle, de Locke à Condillac. Il y a toujours deux sortes de moi, dont l’un n’est que superficiel: pris tout entier dans le préjugé et dans l’opinion, il n’est, peut-on dire, que leur effet: c’est le moi de l’amour propre qui se compare, qui n’existe que de se différer des autres. Mais il y a, sous les préjugés, l’opinion, les mots, un moi que tous peuvent retrouver au plus profond d’eux-mêmes, et qui est le lieu terne de la nature: comble de la subjectivité, si l’on veut, mais aussi le seul véritable fondement de l’objectivité. De Locke à Berkeley et à Condillac, la critique des systèmes repose toujours sur cette critique première: [46] l’auteur n’est pas revenu assez profondément en lui-même. Ainsi Locke critiquait l’innéisme de Descartes, ainsi Condillac critiquait l’innéisme tacite de Locke. C’est à cette exigence de retour à un moi qui n’est que le lieu de l’originel, et permet de voir se développer la nature avant les préjugés d’une expérience reçue du dehors, qui la pervertiront, - que Rousseau se réfère. Disant “moi”, il n’est qu’un guide. Mais un guide nécessaire, parce que le seul qui connaisse encore le fil qui rattache à leur origine le monde et les hommes pervertis:
Ces traits si nouveaux pour nous et si vrais trouvaient bien encore au fond des coeurs l’attestation de leur justesse, mais jamais ils ne s’y seraient rencontrés d’eux mêmes si l’historien de la nature n’eût commencé par ôter la rouille qui les cachait5.
De sorte que le discours de Rousseau se déploie tout entier dans la différence, comme la différence entre l’excentrique et le centre; il mesure rigoureusement la gravité du mal à son éloignement de l’origine, non pas seulement par le moyen d’échelles et de règles que sont ses concepts théoriques (“Avant d’observer, il faut se faire des règles pour ses observations: il faut se faire une échelle pour y rapporter les mesures qu’on prend. Nos prinçipes de droit politique (mon Emile), sont cette échelle. Nos mesures sont les lois politiques de chaque pays”), mais parce qu’à tout moment il n’est que la distance maintenue entre un extérieur qu’il repousse sans jamais pouvoir cesser de lui appartenir, puisqu’il est discours écrit et représentation, et un centre silencieux qu’il n’a jamais fini d’atteindre, puisque l’atteindre serait se taire et se supprimer comme discours. Si bien que cette oeuvre, qui ouvre le monde refermé sur ses origines, doit s’ouvrir elle-même en elle-même perpétuellement. L’écriture même qui conteste le monde et porte la nature et le droit bascule dans le monde de la représentation. De même que les gestes et les actes de Rousseau, expression immédiate d’un sujet naturel, dans un monde dont les Dialogues décriront le système achevé deviennent éléments du système de la représentation, qui les recompose de telle sorte qu’ils renvoient désormais à l’être “le plus chimérique qu’on puisse imaginer”, de même son écriture se défigure pareillement au seul contact du monde qui la reçoit.
La même “jaunisse universelle” qui infecte le regard de l’homme et l’empêche de voir la nature telle qu’elle est, dans l’univers, l’empêche aussi de la voir dans les livres qui la disent: “lecteurs, vous aurez beau faire, vous ne verrez jamais mon Emile comme je le vois.” L’histoire de l’oeuvre de Rousseau est l’histoire d’un partage intérieur au monde, qui devient, peu à peu, intérieur à l’écriture même. L’oeuvre est ainsi prise elle-même dans le procès de perversion qu’elle dénonce, elle l’achève en le disant. Cet achèvement, ce sont les Dialogues, qui ne sont plus le discours d’un sujet cherchant à se défendre contre la défiguration que subira sa représentation, mais qui, d’emblée se donnent comme le discours [47] de l’autre: discours dont le sujet lui-même s’est exclu, pour retrouver, dans le dehôrs à quoi ouvrent les Rêveries, cette autre vie, et cet autre ordre de choses qui doivent nécessairement exister pour compenser, balancer l’impossibilité de vivre et le malheur qui sont le lot du juste en ce monde.
Dans cette histoire de l’oeuvre, qui répète en elle-même l’histoire du monde, l’Emile marque un point remarquable. Et d’abord pour Rousseau lui-même, qui y voit la clef permettant de comprendre son oeuvre comme un système théorique rigoureux. Il fait dire en effet au Français des Dialogues:
J’avais senti dès ma première lecture que ces écrits marchaient dans un certain ordre qu’il fallait trouver pour suivre la chaîne de leur contenu. J’avais cru voir que cet ordre était rétrograde à celui de leur publication, et que l’Auteur, remontant de principes en principes n’avait atteint les premiers que dans ses derniers écrits. Il fallait donc pour marcher par synthèse commencer par ceux-ci, et c’est ce que je fis en m’attachant d’abord à l’Emile par lequel il a fini.6
En vérité, ce que Rousseau présente comme une ‘chaîne’ de principes est plutôt une constellation de réponses, que l’Emile permet d’organiser en un système en équilibre dont le concept qu’est l’Emile serait le centre de gravité.
Le monde en effet que l’Emile désigne comme son autre est le produit complexe de deux perversions, celle de l’homme comme individu et celle de l’état. On retrouve décrit dans l’Emile l’état de guerre de la fin du second Discours, mais élargi, et transposé dans le champ des intérêts économiques, sociaux, intellectuels, - en bref, dans le champ de l’opinion et de la représentation. Mais dans le second Discours, cet état limite ouvrait à une solution, la solution par l’état politique, dont le contrat social développe les fondements. Or en fait, le Contrat Social est moins la suite théorique du second Discours, qu’une réponse à un second aspect de la perversion de ce monde: la dégradation des Etats et leurs contradictions.
A ce monde double correspond un sujet double lui aussi. Les deux “manières d’être” de l’homme-naturelle et politique, les deux ordres [48] de légalité - de la nature et des hommes - qui se succédaient du deuxième Discours au Contrat Social, se recouvrent maintenant sans coïncider.
De ces contradictions naît celle que nous éprouvons sans cesse en nous-mêmes. Entraînés par la nature et par les hommes dans des routes contraires, forcés de nous partager entre ces diverses impulsions, nous en suivons une composée qui ne nous mène ni à l’un ni à l’autre but. Ainsi combattus et flottants durant tout le cours de notre vie, nous la terminons sans avoir pu nous accorder avec nous, et sans avoir été bons ni pour nous ni pour les autres.7
Il faut souligner que la duplicité du monde et de l’homme n’est pas simplement réunion ou addition de l’ordre de la Nature et de l’ordre civil, de l’homme de la nature et du citoyen, mais désigne un mixte nouveau, dont les éléments sont désormais inséparables, tout en étant contradictoires.
Dans ces conditions, quelles solutions théoriques s’offrent à Rousseau pour que le sujet échappe à une contradiction interne qui fait son malheur?
Rousseau en écarte deux, comme impossibles aujourd’hui: celle du retour à l’état du sauvage du second Discours et celle du, retour à l’état de pur citoyen, semblable à celui de Sparte par exemple. D’un côté en effet: “un homme abandonne dès sa naissance à lui-même parmi les autres serait le plus défiguré de tous”, de l’autre “... les deux mots de patrie et de citoyen doivent être effacés des langues modernes. Où il n’y a plus de patrie, il n’y a plus de citoyens.”
Il en écarte enfin une troisième, qui est précisément la pseudosolution des contemporains et consiste à masquer la contradiction des deux premières. On aboutit alors à cet être mixte, qui n’est proprement rien: “Celui qui, dans l’ordre civil, veut conserver la primauté des sentiments de la nature ne sait ce qu’il veut. Toujours en contradiction avec lui-même, toujours flottant entre ses penchants et ses devoirs, il ne sera jamais ni homme ni citoyen, il ne sera bon ni pour lui, ni pour les autres. Ce sera un de ces hommes de nos jours, un Français, un Anglais, un bourgeois; ce ne sera rien.”8
Reste la solution qu’est Emile. Emile, c’est l’homme naturel vivant dans l’état civil, mais il n’est pas, comme le bourgeois, le résultat [49] du mélange contradictoire d’une nature pervertie et d’un état dégradé, il sera “un sauvage fait pour habiter les villes.” Il se distingue donc du bourgeois comme le droit du fait. Ainsi l’Emile accomplissant en cela le mouvement de partage dont nous parlions plus haut, désintrique les deux ordres de la nature et des hommes qui se recouvrent et interfèrent dans ce monde, et les répartit sur deux plans différents. Ce qui commande, nous allons le voir, la composition de l’Emile.
Il s’agira d’abord de produire et de développer le concept d’un homme de la nature; l’artifice d’une éducation permettra à la nature de poursuivre sa marche, sans se trouver dévié dès le départ, comme elle l’est aujourd’hui, où le nouveau-né, - seul lieu où la nature pointe encore, - se trouve immédiatement pris et pour toujours dans les restes de l’ordre de l’homme (le maillot n’est que la figure matérielle de cette emprise multiple qu’a la représentation adulte sur l’enfant: “les enfants entendent parler dès leur naissance”, on leur impose convenances, devoirs, habitudes sociales etc). L’Emile choisit donc de porter à son achèvement l’ordre de la nature en retardant à l’extrême le moment de son contact avec l’ordre des hommes, en permettant au sauvage de n’être plus exclu dans le lointain temporel des premiers Temps, ou spatial des terres non civilisées, mais d’arriver aux portes mêmes de nos villes, et de les tenir sous la pureté naturelle d’un regard qui éclairera leurs contradictions.
Toute la première partie de l’Emile, jusqu’à la Profession de foi se déroule selon le droit d’une genèse-modèle des facultés. En fait Rousseau présente cette genèse normale comme “la marche même de la nature.” Nous l’avons vu plus haut: Si l’oeuvre paraît celle d’un auteur, d’un original, d’un visionnaire, c’est qu’on n’y voit pas que c’est la nature même qui est là sous nos yeux, simplement présentée à travers une écriture qui voudrait n’être que pure transparence. L’aspect autoritaire, normatif du traité vient de l’autorité, de la norme qu’est la nature elle-même.
Rousseau insiste à tout instant sur la nécessité interne qui conduit la réalité qu’il se contente de voir s’ordonner sous son regard, seul regard original parce qu’il est originaire, et parce qu’entre l’oeil et le spectacle il n’y a pas le filtre déformant des représentations: “Ils cherchent toujours l’homme dans l’enfant.” Le spectacle de la nature ne peut être donné qu’à un regard naturel: “Je sais que, s’obstinant à n’imaginer possible que ce qu’ils voient, ils prendront le jeune homme que je figure pour un être imaginaire et fantastique, parce qu’il diffère de ceux à qui ils le comparent.” Et le regard dénaturé des hommes de ce siècle ne peut constituer, sous le nom de vérité, de nature et de droit que des images en miroir de leurs erreurs, de leur dénaturation, de leurs crimes. Aussi faut-il pour voir Emile tel qu’il est, le rejoindre en soi-même, sous les préjugés, voir Emile (et se voir) avec les propres yeux d’Emile: “Un sauvage nous juge plus sainement que ne fait un philosophe. Celui-ci sent ses vices, s’indigne des nôtres, et dit en lui-même: nous sommes tous des méchants. L’autre nous regarde sans s’émouvoir et dit: vous êtes des fous.”
[50](Cette neutralité du regard détaché des préjugés et dont le discours ne serait que le décalque, Rousseau la revendique aussi bien ailleurs: aussi les “erreurs” dans les théories politiques de Hobbes, Grotius etc ... ne sont que des perversions du regard: on juge de ce qu’on doit voir par ce qu’on voit).
Le problème de la norme de la genèse et du fondement des principes est en fait au coeur du discours empiriste, quoique non formulé comme tel. L’Essai sur l’entendement humain de J. Locke prétendait déjà, en partant des idées simples, montrer comment toute la connaissance pouvait se constituer selon l’ordre naturel de l’expérience, sans recourir à l’innéisme cartésien. On voit bien pourtant que cette genèse de l’entendement à partir du simple suppose une analyse préalable mais implicite de l’entendement déjà constitué, qui dessine le cadre vide dans lequel la genèse se développe. Ainsi, c’est le sujet du discours empiriste qui est lui-même l’horizon et la fin de la genèse qu’il décrit: la description est toujours normative. C’est pourquoi l’empirisme est la philosophie du traité d’éducation, qui se donne comme complément et application de la théorie, et n’est en fait, rien d’autre qu’un dédoublement du discours empiriste sur la genèse. Et l’éducateur n’est rien d’autre que le sujet de ce discours, mais représenté, mis en scène dans le discours lui-même. Cet éducateur n’est pas un maître, de même que le sujet du discours - le philosophe - n’est pas un auteur: Il n’impose pas sa loi, ne donne pas d’ordres, puisque la loi, l’ordre, c’est la nature à l’oeuvre dans le développement de son élève. Mais si l’élève est lui-même le jeu de la nature, il en est du même coup le jouet: il ne la saisit pas comme loi. Le rôle de l’éducateur est alors de renvoyer en miroir à l’élève l’image de son propre développement, en lui donnant ainsi force de loi. L’éducateur n’est pas la loi, il la révèle. Il est l’artifice par quoi le jeu de la nature qu’est l’enfant se réfléchit lui-même, prenant conscience de sa légalité. Mais que l’éducateur impose à l’enfant une légalité qui ne soit pas l’exacte représentation de celle qui, implicitement, le commande, alors les principes mêmes de l’empirisme s’effondrent, puisque ce n’est plus la nature qui mène la genèse, mais l’arbitraire des hommes. Aussi Condillac écrit-il, en des termes que Rousseau pourrait reprendre à son compte: “Il fallait me rapprocher de mon élève, et me mettre tout à fait à sa place, il fallait être enfant plutôt que précepteur. Je le laissais donc jouer et je jouai avec lui, mais je lui faisais remarquer tout ce qu’il faisait, et comment il avait appris à le faire.”9
Mais une différence essentielle sépare Rousseau de Condillac, c’est que son élève n’est pas simplement un entendement. Il y a, chez Condillac, un ordre pour l’enseignement des sciences (l’ordre de leur genèse historique) mais cet ordre est logique, et non temporel. Condillac écrit bien: “Il n’y a point d’âge où l’on puisse comprendre les principes généraux d’une science, si l’on n’a pas fait les observations qui ont [51] conduit à ces principes. L’âge de raison est donc celui où l’on a observé.” Mais il ajoute aussitôt: “et, par conséquent, la raison viendra de bonne heure, si nous engageons les enfants à faire des observations.”10 Il n’y a donc qu’une seule et même raison de l’enfant à l’homme, et une éducation bien conduite est celle qui fait gagner du temps, en multipliant les observations: la raison se constituera d’autant plus tôt que les observations auront été plus nombreuses.
Or, si le modèle sensualiste de la sensation transformée détermine bien aussi la genèse des facultés et des connaissances d’Emile, cette genèse est chez Rousseau commandée par une temporalité réelle, celle d’un individu vivant, qui naît, souffre, désire et peut à tout instant mourir, - bref fait d’un esprit et d’un corps. Aussi la genèse dans l’Emile n’est-elle pas une transformation linéaire de la sensation, mais une double transformation parallèle; non pas une succession de formes de l’entendement, mais une succession de couples de formes équilibrées.
La vie d’Emile de l’enfance à l’âge adulte sera donc une suite d’états d’équilibre. Rousseau définit l’unité du sujet11 comme une fraction dont le quotient serait égal à 1 ou comme une différence égale à zéro. Le progrès d’Emile, le progrès de son ‘Empire’ , sera comme la suite: d/f = 2d/2f = 3d/3f, etc.... d représentant les besoins du corps ou les désirs et f les forces physiques ou les facultés intellectuelles qui peuvent les satisfaire. Cette unité dans l’équilibre est pour Rousseau la condition de la liberté et du bonheur. Tel sera donc le principe de l’éducation: “En quoi consiste la sagesse humaine ou la route du vrai bonheur? Ce n’est pas précisément à diminuer nos désirs; car, s’ils étaient au-dessous de notre puissance, une partie de nos facultés resterait oisive, et nous ne jouirions pas de tout notre être. Ce n’est pas non plus à étendre nos facultés, car si nos désirs ne s’étendaient à la fois en plus grand rapport, nous n’en deviendrions que plus misérables. Mais c’est à diminuer l’excès des désirs sur les facultés, et à mettre en égalité parfaite la puissance et la volonté. C’est alors seulement que, toutes les forces étant en action, l’âme cependant restera paisible, et que l’homme sera bien ordonné.”12
Ce principe d’équilibre13 permet de jouir pleinement à tout moment, à tout âge, de tout son être. Qu’est-ce donc que la mauvaise éducation? Celle, dit Rousseau, qui ne sait pas “voir l’enfant dans l’enfant”, [52] c’est-à-dire celle qui introduit le déséquilibre dans l’enfant. On peut provoquer ce déséquilibre de deux façons: soit en ajoutant, soit en retranchant quelque chose sur l’un des deux bras du levier. On ajoute quelque chose, par exemple, lorsqu’on se plie au caprice de l’enfant, lorsqu’on “met ses bras au bout des siens.” Dès lors en devenant tyran, il perd sa liberté: “le seul qui fait sa volonté est celui qui n’a pas besoin, pour la faire, de mettre les bras d’un autre au bout des siens.” On retranche quelque chose, lorsqu’on l’enserre dans des contraintes et des limites qui ne sont pas celles de la nature (maillot, devoirs etc ...). Et, de même que l’accroissement de force dans le premier cas n’est qu’illusoire, et se retourne en son contraire la servitude, de même, une limitation violente de la liberté n’est que provisoire, elle finira par être débordée et conduira à la licence dont nous verrons plus loin les effets.
Si l’on veut se représenter le mécanisme de la perversion dans sa plus grande généralité, il suffit de dire qu’il est la méconnaissance de la temporalité de la nature. On détache les représentations de l’adulte de leur sujet pour les reporter sur un sujet enfant. L’Homme est celui qui pré-vient la nature et la fait se recouvrir elle-même: par qui la diversité des climats, avec les fruits, les caractères humains, les langues qui y correspondaient adéquatement, s’est fondue, donnant un mixte contradictoire et insipide: l’Essai sur l’Origine des Langues décrit bien ce recouvrement progressif et mutuel du Nord et du Midi, ce pliage de la terre sur elle-même par le jeu de la représèntation.
Examinons un instant le spectacle du monde créé par l’homme: “l’homme force une terre à nourrir les productions d’une autre, un arbre à porter les fruits d’un autre; il mêle et confond les climats, les éléments, les saisons ... Il bouleverse tout, il défigure tout, il aime la difformité, les monstres.” L’ordre de la nature, c’était une certaine distribution dans l’espace, un espacement géographique (climats, terrains), aussi bien que temporel (saisons), un accord tel finit avec son climat, ou sa saison. L’ordre de l’homme, c’est simplement la nature se recouvrant elle-même sans coïncider, mais en interférant, le Sud et ses produits venant s’appliquer sur le Nord, et l’été sur l’hiver, comme un livre qu’on ferme. La nature aujourd’hui est ce livre fermé dont les pages se superposent, rendant la lecture impossible. Il en est de même chez l’homme d’aujourd’hui, produit d’une éducation qui au lieu d’espacer son développement dans une succession d’âges avec leurs représentations, l’écrase dès sa naissance des représentations de sa fin.
L’Emile est le livre rouvert, le texte étalé, réordonné: le sujet s’espace dans le temps naturel de sa genèse, et il sera celui qui laisse devant lui la nature s’espacer, différer d’elle-même, dans un équilibre de variétés, où toutes ses forces sont en action. Au livre IV de l’Emile, Rousseau, (se supposant riche) au lieu d’être celui en qui et par qui la nature se contredit elle-même, sera celui qui se diversifie avec elle en quelque sorte, qui la rend presque plus nature que nature. Il écrit, dans un texte qui répond exactement à celui que nous citions quelques lignes plus haut: “Je n’imiterais pas ceux qui mettent toujours les saisons en contradiction [53] avec elles-mêmes, et les climats en contradiction avec les saisons; qui, cherchant l’été en hiver, et l’hiver en été, vont avoir froid en Italie et chaud dans le Nord … Moi, je resterais en place, ou je prendrais tout le contre-pied: je voudrais tirer d’une saison tout ce qu’elle a d’agréable, et d’un climat tout ce qu’il a de particulier. J’irais passer l’été à Naples et l’hiver à Pétersbourg ... etc ...”14
“Chaque âge, chaque état de la vie a sa perfection convenable, sa sorte de maturité qui lui est propre”, mais Emile accroit cependant peu à peu son empire. Cet empire n’est, à la vérité que l’élargissement et le perfectionnement de la représentation qu’il se fait de la nature, chaque faculté n’apparaissant qu’au moment favorable (et tout l’art de l’éducation est de reconnaître ce moment favorable), c’est-à-dire au moment où elle est nécessaire à un sujet qui est mûr pour la recevoir. Chaque progrès intellectuel et moral, chaque progrès de la raison répond à un progrès du corps.
On en arrive ainsi à cet âge où le corps cesse de se développer, et du même coup la raison.
L’empire d’Emile, est alors la représentation de la nature entière: la nature a produit, par une genèse naturelle, un sujet naturel capable de la représenter adéquatement. C’est le moment du spectacle de la nature étalé sous les yeux au pied de la colline, le moment de son texte ouvert au regard.
L’homme est maintenant au centre de la nature à sa place, puisqu’il est ordonné par elle pour l’ordonner: “Il est donc vrai que l’homme est le roi de la terre qu’il habite; car non seulement il dompte tous les animaux, non seulement il dispose des éléments par son industrie, mais lui seul sur la terre en sait disposer, et il s’approprie encore, par la contemplation, les astres mêmes dont il ne peut approcher.”15
On peut se demander si, à ce moment Emile aura l’idée de Dieu. Il semble bien que non, dans la mesure précisément où il est un sujet fini mais qui n’a pas conscience de sa finitude, qui du même coup n’a pas l’idée d’une être infini et transcendant. L’idée de Dieu va apparaître pour répondre à un nouveau besoin, à un nouveau déséquilibre: il est remarquable que l’idée de Dieu apparaît chez Emile en même temps que net en lui le désir sexuel, que Rousseau assimile au désir de la reproduction: le désir c’est la finitude, consciente d’elle-même, l’ouverture à l’autre, à l’infini: “le vrai moment de la nature arrive enfin, il faut qu’il arrive. Puisqu’il faut que l’homme meure, il faut qu’il se reproduise, afin que l’espèce dure et que l’ordre du monde soit conservé.”16 [54] Le moment de ce désir indéfini (qui n’est pas perçu encore par Emile comme désir de l’autre sexe) est le moment favorable à l’apparition de l’idée de Dieu, qui l’équilibrera. Aussi le rôle de l’éducateur est-il ici de différer le moment de la satisfaction sexuelle, qui plongerait Emile dans le mauvais infini de la licence.
Cette “licence” est le lot des jeunes gens victimes d’une mauvaise éducation, à qui l’on a essayé trop tôt d’inculquer l’idée de Dieu. Ne répondant pas à un désir infini, ni à une raison parfaitement développée, cette idée sera immédiatement déchue en une image défigurée de la diversité. Mais surtout il ne sera plus possible ensuite de retrouver une idée adéquate de la divinité: “Le grand mal des images difformes de la Divinité qu’on trace dans l’esprit des enfants est qu’elles y restent toute leur vie, et qu’ils ne conçoivent plus, étant hommes, d’autre Dieu que celui des enfants.”17 En conséquence, lorsqu’arrivera le moment du désir, le jeune homme ne disposera plus de ce contrepoids indéfini qu’est l’idée de Dieu. Il sera jeté dans la licence, qui est une infinie recherche de l’équilibre. Il faut voir d’ailleurs que cette licence est aussi bien licence sexuelle que licence intellectuelle - d’une raison qui a perdu la clef de l’ordre de la nature. Aussi le matérialisme du siècle est-il essentiellement et profondément lié à sa licence morale. Mais la licence, morale et intellectuelle, est elle-même l’effet d’un déséquilibre premier, celui de la révélation de Dieu à un sujet qui ne l’attend pas. Révéler Dieu même s’il s’agit du vrai Dieu, c’est toujours le défigurer.18 Prêtres autoritaires de la Religion Révélée et philosophes athées sont ainsi profondément complices et appartiennent au même système, en déséquilibre perpétuel, qui n’est fait que de leur antagonisme sans fin.
On se presse d’enseigner le vrai Dieu pour prévenir la licence, mais la licence naît de ce déséquilibre premier, en entraîne en conséquence le redoublement de l’autorité du prêtre etc ....19 Toute la Profession de Foi du Vicaire Savoyard entreprend de rétablir l’équilibre, en appuyant sur le seul centre de gravité qui soit fixe: le sujet de la religion. Or ce n’est pas par hasard que Rousseau a inséré la ‘Profession de Foi’ dans l’Emile, ni à l’endroit précis où elle est insérée. Lorsque le Vicaire, devant les contradictions qui le déchirent, entreprend de rentrer en [55] lui-même pour considérer ce qu’il lui importe vraiment de croire, il rejoint très précisément le lieu du sujet naturel dont l’Emile vient de développer la genèse.20 L’Emile fournit ainsi le concept théorique d’un sujet naturel qui doit servir de fondement rigoureux pour une religion naturelle.
Et, de même qu’Emile est “l’Homme abstrait, qui n’est d’aucun temps ni d’aucun pays”, sa religion sera la base commune de toutes les religions particulières, qui n’en sont que la diversification accidentelle, selon les pays et les hommes.
Mais, sans nous interroger pour le moment sur le détail de cette religion naturelle, et sur sa fonction, examinons comment se poursuit l’éducation d’Emile.
Nous avons vu que l’Emile, des deux ordres qui se nouaient et interféraient dans ce monde, choisissait d’en développer un, celui de la nature, jusqu’à son achèvement. Emile sera d’abord Homme de la nature. A la fin du livre V, cet Homme de la nature rencontre l’ordre civil mais sous sa forme actuelle, c’est-à-dire dégénérée: Or, loin de conseiller à Emile de fuir un tel ordre, son précepteur l’engage au contraire à y entrer: comme si les lois humaines même infidèles à leur essence qui est d’exprimer la volonté générale, étaient bonnes du seul fait qu’elles sont lois. “Ô Emile! où est l’homme de bien qui ne doit rien à son pays? Quel qu’il soit, il lui doit ce qu’il y a de plus précieux pour l’homme, la moralité de ses actions et l’amour de la vertu. Né dans le fond d’un bois, il eût vécu plus heureux et plus libre; mais n’ayant rien à combattre pour suivre ses penchants, il eût été bon sans mérite, il n’eût point été vertueux, et maintenant il sait l’être malgré ses passions. La seule apparence de l’ordre le porte à le connaître, à l’aimer ... Elles lui donnent le courage d’être juste, même parmi les méchants.”21 On voit donc que l’ordre naturel, selon lequel s’est constitué Emile, ne se soutient pas de lui-même, et doit s’appuyer sur l’ordre civil de la loi. L’Homme n’est pas vraiment Homme s’il n’est pas aussi citoyen.
Il est alors intéressant de relire le Contrat Social, qui développe les fondements non pas comme l’Emile, de l’ordre de la nature, mais de l’ordre civil. Il propose lui aussi un Etat conçu comme sujet de droit, norme de référence pour tous les états de faits. Mais on s’aperçoit que, sous l’exposé des principes d’un état de droit, on peut lire à travers les exemples choisis par Rousseau, une certaine histoire, qui conduit vers un certain Etat, celui très précisément du dernier chapitre.
[56]Or cet Etat politique ne se soutient qu’en s’appuyant sur la garantie d’une religion civile, dont les articles reproduisent presque exactement les dogmes de la Religion Naturelle.
On arrive donc ainsi à un état où le pur citoyen peut et doit être en même temps un Homme. Et ceci, par une véritable éducation des états, qui se dessine à travers le Contrat Social et n’est pas l’éducation civile des citoyens,22 mais une éducation comparable à celle d’Emile: le sujet de l’éducation n’est plus un individu humain, son champ une vie humaine, mais un peuple et l’histoire des peuples. Comme l’enfant, le peuple porte en lui la loi mais ne la reconnaît pas ni ne l’exprime comme telle. De là la nécessité du législateur,23 qui n’a aucun pouvoir pour imposer sa loi, et doit n’être, - comme l’éducateur l’était pour la raison naissante que le porte-parole de la volonté générale. Et comme l’éducateur devait employer des artifices et des ruses pour donner force à la raison et la faire accepter par l’enfant,24 de même le législateur utilisera ici la force de la religion.
L’éducation historique des peuples repose, elle aussi sur les deux principes d’équilibre des besoins et des facultés, et sur celui de moment favorable.
C’est pourquoi la tâche du législateur, quoique analogue dans sa structure à celle de l’éducateur, la dépasse infiniment en difficulté: “Il faudrait des Dieux pour donner des lois aux Hommes.”25
Or, c’est précisément ce à quoi va conduire l’histoire, telle que la dit implicitement Rousseau. On a vu dans l’Emile que le précepteur représentait, à chaque âge, la force de la raison pour son élève, jusqu’au moment où Dieu est reconnu comme la raison suprême de l’ordre et l’auteur du ‘texte’ de la nature. Le précepteur au même moment s’évanouit comme précepteur, et devient simplement ami. C’est Dieu maintenant qui est la force de la loi.
26Dans l’histoire, il y a plusieurs peuples, donc plusieurs législateurs, mais Rousseau les distribue selon une hiérarchie qu’on peut rétablir comme suit. Il faut commencer par mettre hors jeu dans cette histoire [57] tous les faux législateurs qui imposent leur volonté particulière au peuple, donc une législation où la Volonté Générale ne peut se reconnaître. Ces faux législateurs sont vite dénoncés comme tels, et leur apparition n’est qu’une péripétie dans l’histoire.
Il y a donc d’abord le bon législateur (Solon, Lycurgue) qui ont bien compris et exprimé la Volonté Générale de leur peuple, mais de leur peuple seulement, et à telle période historique seulement. Aussi leurs lois sont-elles bonnes pour un temps. Bientôt après elles s’efforceront devant d’autres, comme les dieux particuliers qui avaient servi de garants à leur autorité.
Il y a ensuite le législateur sublime, qui est Moïse: Moïse a su, à travers la Volonté Générale de son peuple, lire une Volonté Générale qui résiste au temps: sa loi dure, et le Dieu qui la garantissait aussi. L’écriture devient Ecriture: Ce qui demeure en elle, c’est ce qui a atteint sous le citoyen l’Homme de la nature. Mais il n’en reste pas moins que la loi mosaïque était là pour un peuple élu, et ne se donnait pas explicitement et consciemment comme loi pour le genre humain.
Arrive enfin le législateur Divin, qui est Jésus. Mais cette idée de législation divine, les hommes n’ont pas su la recevoir comme telle. L’idée d’un royaume divin s’est immédiatement dégradée en idée d’un royaume politique temporel. “Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur la terre un royaume Spirituel ... Or cette idée nouvelle d’un royaume de l’autre monde n’ayant pu jamais entrer dans la tête des païens ils regardèrent toujours les Chrétiens comme les vrais rebelles, qui, sous une hypocrite soumission, ne cherchaient que le moment de se rendre indépendants et maîtres, et d’usurper adroitement l’autorité qu’ils feignaient de respecter dans leur faiblesse.”27. En fait, cette dégration historique, et le malheur qui va s’ensuivre (la contradiction de deux pouvoirs dans l’état) trouve un fondement anthropologique dans l’Emile: si Dieu a été immédiatement défiguré, c’est parce qu’il a été révélé. Personne ne peut révéler Dieu; c’est lui qui se révèle comme corrélat nécessaire d’un sujet qui est l’Homme considéré comme humanité. La révélation fait naître immédiatement et nécessaire un rapport d’autorité; c’est pourquoi “Ce que les païens avaient craint est arrivé; alors tout a changé de face, les humbles chrétiens ont changé de langage, et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l’autre monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci”.28
De là vient la contradiction intérieure qui fait le malheur des états d’aujourd’hui. C’est, pensons-nous, cette contradiction dominante que doit résoudre pour Rousseau le Contrat Social. Mais cette contradiction [58] se répercute et s’inscrit au coeur de l’individu. C’est elle qui fait le malheur du Vicaire Savoyard, et que l’Emile permet, de son côté de résoudre, en produisant le concept d’un sujet de droit capable de se donner, par la raison, une religion qui ne se juxtapose pas aux autres, mais qui, étant la base même de toutes les autres, lève leurs contradictions en montrant qu’elles ne sont que des variétés d’une même religion.
Or, dans le Contrat Social29 comme au début de l’Emile, Rousseau examine les solutions possibles à cette contradiction. Et comme dans l’Emile, il en exclut trois qui répètent très exactement, au niveau non pas du sujet individuel, mais de l’Etat, celles qu’exclut l’Emile: Pour que religion et politique ne se contredisent pas, on peut, première solution, réduire la religion à la politique: mais cette solution, comme celle du pur citoyen, conduisant à une espèce de ‘Théocratie’ , “bonne en ce qu’elle réunit le culte divin et l’amour des lois, et que faisant de la patrie l’objet de l’adoration des Citoyens, elle leur apprend que servir l’Etat, c’est en servir le Dieu tutélaire”, est impossible aujourd’hui. De plus, elle est mauvaise en ce que - (de même que le pur citoyen est l’ennemi de tout ce qui n’est pas son concitoyen) - “elle rend le peuple sanguinaire et intolérant” et le met “dans un état naturel de guerre avec tous les autres, très nuisible à sa propre sûreté.”
La seconde solution serait, au contraire, de réduire la politique à la vraie religion, de constituer une république de chrétiens: mais “le Christianisme est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des choses du Ciel: la patrie du chrétien n’est pas de ce monde.” Aussi la loi selon laquelle elle vit sera immédiatement défigurée, elle aura un représentant visible, qui, inévitablement sera Tyran: “les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves.”
La troisième est la plus mauvaise, elle consiste à maintenir ensemblent, dans un même état, les deux pouvoirs, et à masquer la contradiction, en les résumant dans un même chef: “La troisième est si évidemment mauvaise que c’est perdre son temps à le démontrer. Tout ce qui rompt l’unité sociale ne vaut rien: Toutes les institutions qui mettent l’homme en contradiction avec lui-même ne valent rien.”
Reste la quatrième solution. L’Emile, nous l’avons vu, revient au sujet de droit. Rousseau, de même, écrit ici: “Mais laissant à part les considérations politiques, revenons au droit.” Ce droit, c’est le Souverain, dont le Contrat Social tout entier, définit les principes: “Il y a une profession de foi purement civile, dont il appartient au Souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de Religion, mais comme sentiments de sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être bon Citoyen ni sujet fidèle.” Or ces articles sont précisément ceux de la religion naturelle, celle de l’Homme.
[59]Ainsi, l’Emile et le Contrat Social, qui se développent apparemment dans deux champs indépendants convergent en fait vers un centre qui n’est jamais dit comme tel: l’idéologie morale et religieuse ne se soutient que de s’appuyer sur une légalité politique, positive, et l’état politique ne trouve son assiette fixe qu’avec une idéologie morale et religieuse. Tel serait peut-être le centre de gravité de l’oeuvre théorique de Rousseau: chaque religion, chaque système de lois, comme chaque langue ne sont qu’une variété positive, liée à la différence irréductible des climats et des pays, de la Religion, du Droit, du langage et peuvent coexister sans se contredire. On retrouverait ainsi, après le détour immense qu’a été l’histoire des hommes, l’état heureux de la jeunesse du monde, où les représentations correspondaient adéquatement à leurs représentés, comme les fruits aux climats, les caractères aux pays, et les langues aux caractères, sur une terre diverse, mais équilibrée, une dans la multiplicité. Mais cette différence que telle religion, ou tel système de lois, représentant telle ou telle variété de pays de climats ou de moeurs, représentent aussi la Religion et le Droit, c’est-à-dire en définitive peuvent être rapportés à un même Sujet universel de raison, l’Homme, au coeur de qui la loi de Dieu se donne sans intermédiaire. L’Emile et le Contrat Social gravitent l’un et l’autre autour de ce Dieu de l’Homme et cet Homme de Dieu, l’un effaçant la plainte du Vicaire: “Que d’hommes entre Dieu et moi!”, l’autre celle qui semble sourdre à travers l’Histoire que décrit Rousseau: “Que de dieux entre l’Homme et moi!”
En fait, la théorie de la Religion civile dans un état idéal fonctionnant selon les normes du Contrat Social est contradictoire avec le concept et la théorie rousseauistes de la religion. Ou plutôt, la promulgation des articles d’une Religion civile n’est nécessaire que parce que jamais l’état de fait ne peut reproduire l’état de droit, et qu’il est dans le système de fait des relations internationales. Elle est le contrepoids idéologique qui balance le déséquilibre inévitable, la perversion qui toujours déjà menace l’état. Et cette fonction de contrepoids fait l’essence de la religion chez Rousseau.
Wolmar peut en effet vivre athée et vertueux parce qu’il vit dans une société close organisée selon l’ordre de la nature. Que l’ordre dégénère, que le mal développe son système alors naît le besoin, pour continuer à vivre juste en ce monde, d’une religion consolante. Plus étroite sera dans ce monde la place laissée aux justes par l’ordre du mal, plus violente l’adversité qu’ils rencontrent, plus profond leur déchirement, et plus apparaîtra nécessaire le dédommagement d’une autre vie, dans un autre et meilleur ordre. Les dogmes de la religion rousseauiste sont ainsi déduits par une sorte de calcul de proportions. Ainsi pour le dogme de l’immatérialité de l’âme, donc de sa survie possible après la mort: “Si l’âme est immatérielle, elle peut survivre au corps; et si elle lui survit, [60] la Providence est justifiée. Quand je n’aurais d’autre preuve de l’immatérialité de l’âme que le triomphe du méchant et l’oppression du juste en ce monde, cela seul m’empêcherait d’en douter. Une si choquante dissonance dans l’harmonie universelle me ferait chercher à la résoudre. Je me dirais: Tout ne finit pas pour nous avec la vie, tout rentre dans l’ordre à la mort.”30 Quant à l’existence même de Dieu: “Mon fils, tenez votre âme en état de désirer toujours qu’il y ait un Dieu, et vous n’en douterez jamais.”Emile, p. 385.
Le caractère essentiel de cette théologie Rousseauiste est qu’elle permet de restaurer un ordre où le sujet retrouve son unité et cesse d’être indéfiniment aliéné dans la représentation. Le monde d’ici bas est irrémédiablement obscur, confus, brouillé, tous y vivent hors d’eux mêmes, nulle part la représentation n’y correspond à son représenté. Dans l’autre monde au contraire, le sujet retrouvera son unité dans une présence à soi sans intermédiaire: “Je serai moi sans contradiction, sans partage, et n’aurai besoin que de moi pour être heureux.”Emile, p. 358.
La Providence ne s’en tient pas, d’ailleurs, à contrebalancer ce monde par un autre monde, où le sujet juste sera rétabli dans son unité. L’idée même d’un triomphe absolu des méchants ici bas signifierait la disparition totale de la nature. Dans les tous premiers temps de la Terre, dit l’Essai sur l’Origine des Langues, la Nature, par des révolutions fréquentes, ne cessait de se rééquilibrer elle-même: “Dans ces temps reculés, où les révolutions étaient fréquentes, tout croissait confusément: nulle espèce n’avait le temps de s’emparer du terrain qui lui convenait le mieux et d’y étouffer les autres: elles se séparaient lentement, peu à peu; et puis un bouleversement survenait qui confondait tout ... Sans cela je ne vois pas comment le système eût pu subsister, et l’équilibre se maintenir. Dans les deux règnes organisés, les grandes espèces eussent, à la longue, absorbé les petites: toute la terre n’eût bientôt été couverte que d’arbres et de bêtes féroces; à la fin tout eût péri.”31
Puis, l’homme est apparu, à qui ce rôle d’équilibrateur fut délégué. Mais il a failli à sa tâche. Bien plus, c’est lui qui, peu à peu, a défiguré la nature, jusqu’à son dernier représentant: Rousseau. Aussi la dé-figuration définitive de Rousseau dans la mémoire des hommes, serait la mort même de la nature. La nature rétablira donc son équilibre, d’elle-même, comme aux premiers temps, par une révolution subite qui dévoilera l’innocence de Rousseau: “Je ne puis regarder comme une chose indifférente aux hommes le rétablissement de ma mémoire.” La revolution [61] qui doit “désabuser le public sur son compte” viendra nécessairement. “Je suis sûr de la chose, quoique j’en ignore le temps ... L’ordre sera rétabli tôt ou tard, même sur la terre, je n’en doute pas”.32
La défiguration totale des gestes, des actes, du visage même de Rousseau, bref de tout ce qui de lui le représente dans le monde et l’aliène immédiatement sous le regard dénaturé des méchants, est donc balancée par la certitude du dédommagement dans ces utopies, ou ces autres mondes de la religion ou de l’histoire. Mais l’écriture même dans laquelle il dit cet équilibre lui échappe et devient à son tour représentation errante. Paradoxalement, la constatation qu’il faisait du déséquilibre du monde se retourne contre lui: “Nous n’existons plus où nous sommes, nous n’existons qu’où nous ne sommes pas. Est-ce la peine d’avoir une si grande peur de la mort, pourvu que ce en quoi nous vivons reste? ...” Or, lui-même, c’est dans l’écriture qu’il vit, et c’est en elle qu’il est défiguré. Les Confessions sont la première et la dernière tentative pour faire de l’écriture un monde où le sujet peut vivre dans la plénitude de sa présence à soi sous le regard des autres. Mais comme on l’exclut du monde, on le chasse de son propre discours. Alors, Rousseau renverse sa stratégie, abandonne son écriture au monde, en fait lettre morte, et vit désormais dans l’exil, le silence, la mort, “impassible comme Dieu même.”
Michel Foucault présentait naguère les Dialogues comme des “anti-Confessions”33. Mais ne pourrait-on pas dire que les Dialogues et les Rêveries sont l’un et l’autre, de façon inverse mais complémentaire, des “anti-Confessions”, dans la mesure où ils contestent le discours des Confessions en étant, pour ainsi dire les produits de sa décomposition? Ce discours “Mélodique et linéaire”, “simple sillage d’un moi ponctuel”, où, sans plus d’ombre intérieure le sujet se portait dans le jour des signes, à la lumière du monde qui aurait dû le recevoir -, ce discours se fend sur toute sa longueur: obscurcis et pétrifiés par un regard dénaturé, les signes d’une part sont repris dans la forme prégnante du système de “ces Messieurs”, (qui n’est que l’achèvement d’une perversion inscrite dans l’origine), et recomposés de telle sorte que le sujet à quoi leur nouvelle configuration renvoie comme à sa raison est “l’être le plus chimérique et le plus extravagant que le délire de la fièvre puisse faire imaginer.”34 Par une sorte de doute hyperbolique sur les signes, le peu de défaut que portait leur transparence est poussé jusqu’à l’opacité complète: Tel est le mouvement qui conduit aux Dialogues. Au lieu de se servir de l’écriture pour transparaître, Rousseau s’en sert pour disparaître. [62] Les Dialogues sont tout entiers le discours de l’autre, et l’immense répertoire des techniques de la défiguration. Mais ils sont aussi la description d’un discours en perpétuel déséquilibre, cercle qui ne parvient pas à se fermer; semblable, très exactement, au discours de la ‘Philosophie’ ou de la Religion révélée, qui ne sont que le bavardage sans fin d’une imagination délirante,35 destiné à combler le vide originaire qui le constitue, où Philosophes et prêtres sont les administrateurs de la pénurie. Rousseau, en s’annulant dans les Dialogues (“Je suis nul désormais parmi les hommes”) rend cette pénurie définitive, et l’abandonne à l’agitation de ces Messieurs: “le concours général du tout n’est aperçu que des directeurs, qui travaillent sans relâche à démêler ce qui s’embrouille, à ôter les tiraillements, les contradictions, et à faire jouer le tout d’une manière uniforme.”36
Mais si la voix des Confessions s’est tue dans les Dialogues, elle va sourdre d’un tout autre point, impossible à situer avec les coordonnées de ce monde-ci, puisqu’il est pur dehors: “habitée par des êtres qui ne me sont rien, [la terre] est pour moi comme une autre sphère, et je suis aussi peu curieux désormais d’apprendre ce qui se fait dans le monde, que ce qui se passe à Bicêtre ou aux petites Maisons.”37
Ce lieu insituable, ce sont les Rêveries. Tout se passe comme si les Dialogues avaient eu pour effet d’extraire, dans sa pureté, sa plénitude et sa transparence, le sujet des Confessions, et étouffant Rousseau sous le poids de la représentation, de produire comme nécessairement, le contrepoids: “Voilà le contrepoids de leurs succès et de toutes leurs prospérités ... Ils ont fait trouver à J.J. des ressources en lui-même qu’il ne connaîtrait pas sans eux ... Ils l’ont forcé de se réfugier dans des azyles où il n’est plus en leur pouvoir de pénétrer.”38 Rousseau, désormais s’installe dans la mort, cette autre vie, “où je serai moi-même sans contradiction” que la Religion et l’Histoire avaient fait apercevoir, et à quoi appartiennent, dès ici bas, les Rêveries: “Oui sans doute, il faut que j’aie fait sans que je m’en aperçusse un saut de la veille au sommeil, ou plutôt de la vie à la mort.”
Les Rêveries ne “prolongent” pas les Confessions: l’hétérogénéité entre elles est complète, parce que la position du sujet par rapport à son écriture a radicalement changé. Il n’est plus question de conduire un sujet, jusque là caché et secret, dans la lumière publique des signes, [63] il ne s’agit plus de se communiquer: il n’y a plus désormais d’autres, et plus rien à dévoiler: “Qu’aurais-je encore à confesser quand toutes les affections terrestres sont arrachées?” Le discours des Rêveries, ce n’est plus celui d’un sujet éclairé par la lumière des mots pour le regard des autres, mais au contraire, autour d’un sujet présent à lui-même dans son intégralité et vivant dans un tout autre ordre que celui de ce monde, des mots rassemblés qui reçoivent de lui leur lumière. Mais, de même que, du discours ouvert des Confessions, les Dialogues, appuyant à l’extrême la part d’opacité et d’inertie que recélaient les signes, retenaient du sujet cependant le minimum nécessaire pour qu’ils se constituent en discours, de même les Rêveries, gravitant autour du pur sujet, laissent aux mots le peu de poids qu’il leur faut pour qu’elles se constituent en ce texte, éclairé de l’intérieur et comme fluorescent, qui gardera la présence pour une jouissance indéfinie: “Je n’écris mes rêveries que pour moi … Leur lecture me rappellera la douceur que je goûte à les écrire, et faisant renaître ainsi pour moi le temps passé, doublera pour ainsi dire mon existence.”39
Mais il reste que, parce qu’il y a oeuvre, l’altérité entre les deux mondes n’est jamais que dite et représentée dans la même écriture continue, échiquier d’une partie où Dialogues et Rêveries sont les positions de deux adversaires, de part et d’autre d’un front désormais immobile et figé: face à face, deux mondes - discours sans profondeur, où représenté et représentation coîncident parfaitement, mais pour l’un parce qu’il n’y a plus de représenté, pour l’autre parce que la représentation s’est quasiment évanouie.
Les pages qui précèdent avaient pour seule ambition d’essayer de penser ensemble ce qu’on a coutume de séparer et d’opposer chez Rousseau, la ‘théorie’ et la ‘littérature.’
Il nous a semblé que l’une et l’autre étaient commandées par cette même configuration inconsciente du savoir classique dont Michel Foucault, dans les Mots et les Choses dessinait la structure. Le monde que dénonce l’oeuvre ‘théorique’ de Rousseau est celui que, longtemps déjà, avait découvert Don Quichotte. Le monde est devenu illisible, étranger à son propre sens; représentation errante et aberrante. Le recours à l’origine, au droit, chez Rousseau, c’est à la fois une critique de la représentation, et la tentative de réformer cette représentation, de rendre le monde lisible. Mais rendre ce monde lisible, c’est revenir, à travers [64] les représentations jusque vers le lieu, (ou le temps), où le représenté et la représentation “se nouent en leur essence commune”: jeunesse du monde, constitution de l’état politique. Ce n’est pas proprement lui donner un sens, mais glisser sous lui le Livre original dont il est seulement la reproduction brouillée, la représentation seconde et défigurée. C’est ce Livre original, cette représentation confondue avec la chose elle-même dans sa présence, bref la Nature et le Droit eux-mêmes que désigne, de loin, l’oeuvre ‘théorique’ de Rousseau. Mais ce retour passe par un livre, et la lisibilité du monde n’est possible que par la lisibilité des livres de Rousseau. Il faut donc, pour que le Livre original du monde transparaisse sous sa représentation brouillée qu’on puisse lire, dans leur original, les livres mêmes de Rousseau. Et toute l’histoire de l’oeuvre de Rousseau, le passage de la ‘théorie à la littérature’ , c’est le passage d’une exigence qui est de faire se recouvrir la représentation du monde et le monde même, bref de le nommer, à l’exigence préalable de faire coïncider la représentation que j’en donne à la représentation que j’en ai, bref de me nommer. Michel Foucault écrit, à propos de la Pensée classique, et de “son utopie d’un langage parfaitement transparent où les choses elles-mêmes seraient nommées sans brouillage”: “On peut dire que c’est le Nom qui organise tout le discours classique; parler, écrire, ce n’est pas dire les choses ou s’exprimer, ce n’est pas jouer avec le langage, c’est s’acheminer vers l’acte souverain de nomination, aller, à travers le langage, jusque vers le lieu où les choses et les mots se nouent en leur essence commune, et qui permet de leur donner un nom. Mais ce nom, une fois énoncé, tout le langage qui a conduit jusqu’à lui ou qu’on a traversé pour l’atteindre, se résorbe en lui et s’efface. De sorte qu’en son essence profonde, le discours classique tend toujours à cette limite; mais il ne subsiste que de la reculer. Il chemine dans le suspens sans cesse maintenu du nom.”40 La ‘littérature’ de Rousseau n’est que le déplacement à l’intérieur de sa propre écriture, d’un problème posé par la théorie. Sa littérature est mise en scène, dramatisation de la théorie. Le complot des “Messieurs” se dessine déjà à travers le monde que dénonce le premier Discours. Et la trame immense qui obsède les Dialogues n’est que l’achèvement du système qui s’ébauchait dans le premier Discours. La littérature vérifie et rend vraie la théorie, la théorie justifie et rend nécessaire la littérature. C’est pourquoi l’oeuvre de Rousseau est inséparablement littérature et théorie de la littérature, théorie et littérature de la théorie. La littérature surgit nécessairement, parce que pour nommer le monde, je dois m’être nommé pour rendre transparent le discours qui s’abolira en nommant le monde. Et toute l’oeuvre existe, en fin de compte, parce que le sujet est l’innommable.
Notes
1. Emile, Ed. Garnier, p. 45. ↵
2. Profession de foi, in Emile, p. 320. ↵
3. Essai sur l’origine des langues. Ed. Belin, p. 521. ↵
4. Contrat social (III, XIV). ↵
5. Dialogue Troisième, Bibliothèque de Cluny, p. 276 ↵
6. Dialogue troisième p. 273 ↵
7. Emile, p. 11. ↵
8. Emile, p. 10. ↵
9. Condillac, Cours d’Etudes, Corpus des philosophes français, p. 408. ↵
10. Cours d’Etudes, ‘Discours préliminaire’, p. 397. ↵
11. On verra que cette définition de l’unité du sujet vaut aussi pour ce sujet qu’est l’Etat politique. ↵
12. Emile, p. 63-64. ↵
13. Il est inutile de montrer ici comment le principe d’équilibre, ce véritable calcul de la liberté et du bonheur joue ailleurs, et en particulier dans le Contrat Social, où il va même jusqu’à donner lieu à de savants calculs. ↵
14. Emile, p. 432. ↵
15. Profession de Foi. ↵
16. Emile, p. 362. ↵
17. Emile, p. 311. ↵
18. “Gardons-nous d’annoncer la vérité à ceux qui ne sont pas en état de l’entendre, car c’est vouloir y substituer l’erreur”, Emile p. 312. La licence civile dans l’état aura exactement la méme origine. C’est pourquoi la liberté une fois perdue ne se retrouve jamais, et que l’histoire d’un peuple qui a perdu sa liberté oscillera sans fin entre la licence et la servitude: “Les peuples une fois accoutumés à des maîtres ne sont plus en état de s’en passer. S’ils tentent de secouer le joug, ils s’éloignent d’autant plus de la liberté que, prenant pour elle une licence effrénée qui lui est opposée, leurs révolutions les livrent presque toujours à des séducteurs qui sous le leurre de la liberté ne font qu’aggraver leurs chaines” (‘Epître dédicatoire’ du Discours sur l’inégalité). ↵
19. Sur l’origine historique de ce déséquilibre, il faut lire le ch. VIII du Livre IV du Contrat Social. ↵
20. Emile, p. 605. ↵
21. “Il faut donc tourner d’abord mes regards sur moi pour connaître l’instrument dont je veux me servir...” ‘Profession de Foi’, in Emile, p. 325. ↵
22. Comparable à celle qui est esquissée dans les Considérations sur le Gouvernement de Pologne (Pléiade p. 366-399). ↵
23. cf. Contrat Social II, VI, p. 380. ↵
24. “Il importe à tout âge de revêtir la raison des formes qui la fassent aimer”, Emile, p. 404. ↵
25. Contrat Social II, VII, ‘Du législateur’, p. 381. ↵
26. Emile, p. 389. ↵
27. Contrat Social IV, VIII, p. 462 ↵
28. Contrat Social, ibid. ↵
29. Contrat Social IV, VIII. ↵
30. Emile, p. 343. ↵
31. Essais sur l’origine des Langues, Ed. Belin, 523-524. ↵
32. Dialogue Troisième, Ed. Cluny, p. 293-294. ↵
33. cf. Préface à l’édition des Dialogues, biblioth. Cluny. ↵
34. Dialogues. ↵
35. Exemples: le grand animal (Emile, p. 333), l’ange (Emile p. 378) etc ... ↵
36. Dialogues, cf. aussi “En ne me laissant rien, ils se sont tout ôté à eux-mêmes” (Rêverie, I). ↵
37. ‘Note’ aux Dialogues, p. 250. ↵
38. Dialogue Troisième, p. 291-292. ↵
39. Rêverie, ‘Première promenade.’ ↵
40. Les Mots et les choses, p. 133. ↵