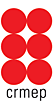Sarrasine ou la castration personnifiée
[91]Qu’on cherche mon page Honoré,
Qu’on le mette en quatre quartiers
Commère, il faut chauffer le lit;
N’entends-tu pas sonner minuit?
Chanson anonyme.
Mais une heure stérile a sonné: le cheval
Et le boeuf ont bridé leurs ardeurs, et personne
N’osera plus dresser son orgueil génital
Dans les bosquets où grouille une enfance bouffonne
A. Rimbaud (‘Les Stupra’).
En novembre 1830, un an après la mort de son père, Balzac, qui a 31 ans, écrit la 3ème nouvelle du tome II des Scènes de la vie parisienne, Sarrasine1 - une trentaine de feuillets glissés comme un signet (ou un signal) entre les mastodontes de la Comédie humaine. (Rien de plus ‘réduit’ , dans l’oeuvre - même La femme abandonnée, qui ravissait Marcel Proust). Le récit est rédigé en première personne, ce qui en souligne le ton personnel et confidentiel. Il comporte un prologue, un récit et un épilogue. Son caractère onirique frapperait le moins averti; il ne tient que peu aux prestiges, cependant très perceptibles, du roman noir qui satura l’époque et qui, paradoxalement, amortissent [92] ici l’angoisse sous leur poncif exténué; bien davantage à la permanente érosion du contenu explicite par le contenu latent d’où l’amour et la mort, échangeant leurs insignes et leurs pouvoirs, n’émergent l’un de l’autre disjoints que pour se résorber aussitôt dans l’énigme qui les noue.
Le narrateur se trouve, accompagné d’une dame, au bal des Lanty, de riches banquiers dont Paris ne sait rien, sinon leur fabuleuse richesse. Il est minuit, comme aux premiers accords d’‘Igitur’ (“le minuit où doivent être jetés les dés”). Le narrateur s’efforce de nous communiquer le sentiment de dissociation qu’il éprouve, qui est le thème de la nouvelle et qui ne sera éclairci que par le dévoilement progressif de la situation. “Assis dans l’embrasure d’une fenêtre et caché sous les plis onduleux d’un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l’hôtel où je passais la soirée. Les arbres imparfaitement couverts de neige se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux, à peine blanchi par la lune. Vus au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leurs linceuls, image gigantesque de la fameuse danse des morts.”
Partagé entre ce paysage d’arbres spectraux derrière la vitre, éclairés dans la neige par la lune et la tiède splendeur des salons où il se retrouve en se retournant, le conteur n’hésite point à se situer là comme entre la vie et la mort; et la banalité de l’antithèse romantique se réactive dans le prosaïsme d’une sensation physique qui sectionne en son corps notre dandy, après ce morcellement d’âme: “Du pied gauche je marquais la mesure, et je croyais avoir l’autre dans un cercueil. Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une moitié du corps tandis que l’autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal.”
Mais le thème s’enfle brusquement jusqu’à évoquer à propos de l’hôtesse, la comtesse de Lanty, l’image d’une mutilation précise: “Pour ces sortes de femmes, un homme doit savoir, comme Monsieur de Jaucourt, ne pas crier quand, en se cachant au fond d’un cabinet, la femme de chambre lui brise deux doigts dans la jointure d’une porte.”
Ces préparations savamment graduées ne servent qu’à introduire sous les lambris dorés le monstre dont la description fantastique n’exigera pas moins d’une dizaine de pages. “C’était un homme”, nous est-il déclaré, la suite s’évertuant à nous persuader du contraire et ne visant en cela qu’à nous égarer sur les vraies dimensions du leurre, jusqu’à ce que tombent enfin les masques.
L’être en question laisse un sillage de froid sur les épaules des danseuses qu’il frôle. C’est un vieillard, mais qui évoque à la fois le vampire, la goule et l’homme artificiel. Certains vont jusqu’à le [93] tenir pour Cagliostro, d’autres pour le Comte de Saint-Germain, qui passent, comme chacun sait, pour immortels. Il est le mystère insondable de cette famille de Lanty, ne se manifestant qu’ “aux équinoxes et aux solstices”, ce qui semble lui conférer la fatale périodicité de quelque astre maléfique, une Lune Noire du faubourg St-Germain. Assassin, banqueroutier, esprit? Les invités s’interrogent. Ses mouvements ont la “lourdeur froide” et la “stupide indécision qui caractérise les gestes d’un paralytique”. Serait-ce la statue du Commandeur, quelque Nosferatu ou notre Belphégor télévisé? Ses yeux glauques, sans chaleur, ne peuvent se comparer qu’à de la nacre ternie. “Créature sans nom dans le langage humain, forme sans substance, être sans vie ou vie sans action”, ses petites jambes sont “deux os mis en croix sur une tombe”.
Ce squelette illuminé de diamants et paré de dentelles surannées, d’une coquetterie féminine et funèbre, sent le cimetière, la Jézabel et - pour tout dire - la mort. Ainsi glisse-t-il sur ses pieds débiles comme une allégorie pétrifiante mêlée à la volupté des danses, des parfums, du luxe et de l’or, jusqu’à ce que vienne l’escamoter par une porte dérobée la radieuse fille de la maison, sur laquelle, avant de disparaître, il secoue, comme un palmier ses dattes, des joyaux dont elle recueille l’un en son giron.
Le narrateur a avoué à sa compagne, bouleversée par cette vision d’Outre-tombe, qu’il connait l’histoire de l’horrible homme des soirées et s’engage à la lui conter chez elle, le lendemain. Fin du prologue.
Or le récit qui suit semble n’avoir aucun rapport avec les événements de la veille et concerner un nouveau personnage: le sculpteur Sarrasine, dont le patronyme à désinence féminine évoque un Islam de turquerie, bien qu’il fût de sang bisontin. Nous apprenons la turbulence de ses années de collège et que, dans ses rixes d’adolescent, lorsqu’il était le plus faible, il mordait. Maudit de son père pour ses extravagances impies, il trouve asile à Paris dans l’atelier de Bouchardon, y manifeste son génie naissant et y récupère la faveur paternelle grâce à l’entremise de son maître. Ce dernier “étouffe son énergie sous des travaux continus” et réduit sa fougue par l’inflexible douceur de son autorité et de la reconnaissance filiale qu’elle éveille en lui. Le résultat en est qu’il n’a d’abord pas d’autre maîtresse que la sculpture, puis Clotilde, une fille d’Opéra qui le rend bientôt à l’amour des arts, et dont on s’étonnait, autour d’eux, qu’elle ait pu l’emporter, quelque temps, sur des statues.
Ainsi entretenu dans une “ignorance profonde sur les choses de la vie”, il part pour Rome, “reine des ruines”. Un soir, assis au théâtre entre deux prêtres, il s’y trouve foudroyé d’amour pour la Zambinella, prima donna qui lui arrache des cris de plaisir. Et ici [94] se place à nouveau une remarque très inattendue sur le corps morcelé. “Il admirait en ce moment la beauté idéale de laquelle il avait jusqu’alors cherché çà et là les perfections dans la nature, en demandant à un modèle, souvent ignoble, les rondeurs d’une jambe accomplie; à tel autre, les contours du sein; à celui-là ses blanches épaules; prenant enfin le cou d’une jeune fille, et les mains de cette femme, et les genoux polis de cet enfant. La Zambinella lui montrait réunies, bien vivantes et délicates, ces exquises proportions de la nature féminine si ardemment désirées. C’était plus qu’une femme, c’était un chef-d’oeuvre.”
Sarrasine avait donc jusque là vécu entre des miroirs mensongers qui ne lui offraient de lui-même et de l’objet impossible que l’image de membres épars, comme autant d’ex-votos dédiés aux ruines exquises d’un Eros désarticulé. Toutes ses oeuvres étaient des ‘restaurations’ avortées, des tentatives de regrouper des échantillons éparpillés dans la multiplicité d’un ‘Fort!’ , ‘morceaux choisis’ à recoller pour rejoindre le ‘Da!’ d’une totalité humaine. Ce qui lui apparaît au bord des quinquets de l’Argentina, c’est cette chose incroyable: une femme entière. Du désir partiel et métonymique de l’objet, il bondit sur l’image spéculaire d’un être structuré et, projeté dans ce petit autre imaginaire, se constitue au même instant que l’autre peut lui apparaître enfin comme constituée.
Désormais, il a un moi pour rejoindre l’autre, et les deux viennent de nature ensemble. La Zambinella n’a rien à redouter, comme il en était de la pauvre clotilde, de la rivalité des statues. “Etre aimé d’elle ou mourir”, se jure Sarrasine désirant son désir. II ne sait pas que la minute de vérité du corps assumé lui cache le piège mortel par quoi il va retomber dans une dissociation irréversible. Mais pour l’heure sa furie amoureuse ne veut rien savoir de ces rires, sur son passage, dans les coulisses, ni des avertissements étouffés du cardinal Cicognara, protecteur de sa beauté. Cependant la Zambinella se refuse, jusqu’à le menacer d’un poignard quand il se fait trop pressant, sans se départir d’une coquetterie qui exaspère le désir du soupirant. Les propos insolites qu’elle lui tient semblent tomber dans le vide; et pourtant, comment mieux dire sans dire? “J’abhorre les hommes encore plus peut-être que je ne hais les femmes. Le monde est désert pour moi. Je suis une créature maudite, condamnée à comprendre le bonheur, à le sentir, à le désirer et, comme tant d’autres, forcée à le voir me fuir à toute heure. Si je disais un mot, vous me repousseriez avec horreur.”
Enfin elle va à l’extrême de la limite jusqu’où elle peut aller: “Si je n’étais pas une femme …?”
Le sculpteur s’obstine à la méconnaître, trop fier d’écraser devant elle la tête d’un serpent qui l’a effrayée: il est dit qu’il piétinera [95] aussi lourdement les symboles que les sous-entendus. Jusqu’au soir où sollicitant du prince Chigi un surcroît d’information sur la Zambinella qui chante, habillée en homme, une épée au côté, il est foudroyé pour la deuxième fois en apprenant du vieux seigneur ce qu’il était seul à ignorer: “Elle! Qui elle? Vous moquez-vous? D’où venez-vous? Est-il jamais monté de femme sur les théâtres de Rome? Et ne savez-vous pas par quelles créatures les rôles de femme sont tenus dans les états du Pape?”
Le mot n’a pas été prononcé; prohibé par son horreur sacrée, sur ces terres dédiées à Priape et au ‘Cazzo’ , fétiche de lui-même, il ne figurera jamais dans la nouvelle. Mais surtout, élidée dans le langage, la chose le sera jusqu’aux frontières du possible, dans la situation réelle.
Sarrasine nie la possibilité de la castration, agrippé jusqu’à la fin à cette bouée percée de la dénégation. Mais Balzac, lui, lâche sa créature, utilisant maintenant le ‘il’ et non plus ‘elle’ pour désigner Zambinella. La même nuit, le sculpteur enlève l’être ambigu, l’enferme dans son atelier et l’interpelle, épée en main, comme au terme d’une corrida: “‘Tu n’est rien. Homme ou femme, je te tuerais! Mais ...’. Il fit un geste de dégoût”.
Ce qu’il dit ensuite montre la profondeur de son identification et l’angoisse liée aux fantasmes qu’elle a réactivés; ou plutôt il n’est plus que le sujet barré obombré par le signifiant venu de l’autre, pour l’autre - et ce sont maintenant deux castrats qui s’affrontent. “Tu m’as ravalé jusqu’à toi. Aimer, être aimé, sont désormais des mots vides de sens pour moi comme pour toi. Sans cesse je penserai à cette femme imaginaire en voyant une femme réelle ... Elle signera toutes les autres femmes d’un cachet d’imperfection! Monstre! toi qui ne peux donner la vie à rien, tu m’as dépeuplé la terre de toutes les femmes.”
Ce cachet d’imperfection, la castration réelle y rejoint le manque imaginaire du phallus maternel, dont le problème éludé ou refoulé se pose à nouveau brusquement. Tout travesti et transvesti qu’il fût, Zambinella avait à cacher (à la différence des femmes) bien plus que ce qu’il n’avait pas: ne pouvant faire qu’il ne l’eût eu et perdu, mais perdu réellement, il proclamait par là que tout le monde était exposé à le perdre, devenant ainsi être-pour-la-castration, c’est-à-dire être-pour-la-mort.
Frustré, on peut le penser d’après ce que nous savons de lui, de la castration symbolique qui crée une existence à travers le réel sans créer du réel, et par quoi le sacrifice s’engrène à la loi, la dette à la promesse et à l’échange, Sarrasine porteur d’un pénis mal assuré pour ne l’avoir pas reçu deux fois, ne peut que le remettre en question [96] sitôt que confronté, dans le réel, à un homme amputé chirurgicalement du sien.
Voici qu’à peine parvenu au stade du miroir, au bord de la fédération narcissique de lui-même par lui-même, à travers l’autre, il se retrouve, du fait de l’autre, en son morcellement, devant le miroir profané.
Il ne peut s’approprier, en l’excluant chez l’autre spéculaire, le génital, puisque l’autre ne l’a pas. Pour lui, il n’y a plus de femmes: rien que des hommes mutilés; il n’y a même plus que des hommes en sursis: rien que des virilités condamnées. C’est pourquoi, bien éloigné du ricanement grinçant des ‘philosophes’ de son temps (voir l’eunuque de Candide: “che sciagura d’esser’senza coglioni!”), il brandit son fer symbolique sur le chanteur et tombe au même instant sous les trois coups de stylet des trois bravi du cardinal. Castration et mort, le cycle fatal est fermé.
L’épilogue de Sarrasine ne fera que rouvrir en quelques lignes le cercle, pour l’édification de la belle danseuse. Oui, le monstre de chez les Lanty, le Fantômas des quadrilles, le Juif-Errant, l’abominable homme des salons, c’est la Zambinella, à qui les libéralités cardinalices ont permis d’enrichir ses arrière-neveux; c’est la castration personnifiée. On comprend dès lors toutes les images de morcellement, de sectionnement par courants d’air, de doigts écrasés (voir L’homme aux loups) qui cristallisaient inexplicablement autour du narrateur. Balzac efface enfin l’angoisse sous des fadaises mondaines échangées par les interlocuteurs, et qui ne sont supportables qu’au titre de rite de sortie. “Les âmes pures ont une patrie dans le ciel”, assure la marquise. Ces deux-là pourront encore jouer à l’amour.
Cette nouvelle brève, chargée comme un voult de forces d’autant plus disruptives, à l’époque, qu’elles n’étaient nullement élucidées (et d’abord pour l’auteur lui-même), n’a guère d’analogues dans la littérature française.2 Dans le Diable amoureux de Cazotte, Alvare commet aussi une erreur sur la personne, mais le page Biondetto, sous ces travestis, n’évolue que de la fille au dromadaire et n’est finalement que le Diable, avec qui la conduite à tenir fut codifiée de longue date par ses familiers et de Goethe à Valery.
Cazotte et Faust ont réponse prête à sa question sinistrement naïve, celle-là même que pose à l’homme le phallus absent: “Che vuoi?” Mais l’homme ne sait justement pas ce qu’il veut et la question ne peut que rester question de la question, celle du manque, de l’objet impossible, perdu, aux substituts éternellement inadéquats.
Notes
1. Comédie Humaine (Pléiade VI, 79-111). Trois lignes de Georges Bataille, disparu sans avoir trouvé le temps d’y aller voir de plus près, nous mirent sur la voie de Sarrasine. A sa chère mémoire, nous faisons hommage de cette petite étude qui est loin d’épuiser notre dette. ↵
2. Par contre, le thème imaginaire du grand pénis paternel se trouve thématisé en clair et en mode fascinant dans les ‘Remembrances du vieillard idiot’, signées François Coppée par A. Rimbaud dans son Album Zutique, pendant la Commune (Pléiade p. 116). ↵