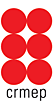Grammaire d’Aragon
[45]Certaines oeuvres font régner le silence autour d’elles, non pas que le discours n’y ait aucune prise, mais il arrive qu’elles puissent, en leur déploiement, absorber la lecture qui s’en propose, et s’intégrer le discours critique, l’abolissant pour en faire un de leurs éléments.
Propriété sans doute qui de la Mise à mort donne la singularité et justifie la paralysie dont elle doit frapper tout commentateur. Faut-il se risquer pourtant à ne pouvoir faire plus que reconnaître l’effet et en affirmer une cause? N’est-il pas possible de saisir en cette absorption même de discours critiques, l’indice qu’une structure est présente, dont c’est là le fonctionnement spécifique et dont on ne saurait parler qu’à en admettre l’existence et à en suivre le développement?
Or, ne s’agirait-il pas simplement d’employer une clé qu’Aragon ne nous refuse pas, lui qui de son roman, nous dit explicitement qu’il est un jeu? Le prendre comme tel est sans doute s’insérer dans la machine même de l’oeuvre et se plier à ses effets, mais, à le faire en connaissance de cause, nous nous plaçons au point où les effets peuvent se résumer en une règle déterminante, et former un ensemble référable à une loi.
Soit donc la Mise à mort un jeu composé de figures:
A et A′ se ressemblent au point de ne se distinguer que par la couleur des yeux, le nom et la propriété singulière qu’a l’une de n’avoir pas de reflet.
Entre A et A′, intervient une figure B, dont la place se définit de ceci que A est l’image de A′ que B est censée aimer.
[46]Les figures entrent dans des liaisons qui se génèrent et se poursuivent d’elles-mêmes:
- la perte du reflet instituant A comme image sans reflet de A′, A′ comme servant à A de miroir.
- la figure A, donnée comme écrivain célèbre, romancier réaliste, se découvrant telle au regard du témoin A′, dans l’espace d’un roman où tous deux fonctionnent comme personnages.
- l’amour refluant de telle sorte qu’il engendre la jalousie, et que la jalousie suscite, en quelque point qu’elle se porte, une figure C de son engendrement infini.
Soit donc un jeu, dont les fonctions seraient amour, dépersonnalisation et roman, et les figures, personnages dénommés A ou Antoine, A′ ou Alfred, B ou Fougère, C ou Christian.
Si l’on recherche les discours qui veulent en rendre compte et du roman énoncer la constitution, la raison apparaît pourquoi ils peuvent échouer s’ils s’attachent au plus visible: l’arithmétique naïve est d’emblée récusée puisque chaque terme est ici multipliable à l’infini. La psychologie sans cesse vient à manquer, dénoncée par une règle qui la fait vaciller, définissant le personnage comme fonction incarnée du jeu. L’analyse structurale est sans prise immédiate sur un objet qui se constitue d’un débordement incessant de soi-même.
Etant admis que la Mise à mort soit un jeu, il faut se porter au niveau radical et viser à reconnaître ce qui dans les éléments du jeu - figures et fonctions - rend compte de ce fonctionnement indéfiniment élargi qui le fait dévorant.
“Le trouble dans cette affaire, nous dit l’auteur, est que tout ce que j’écris est situé dans le jeu d’Antoine, que je n’en ai nulle part édicté les règles, elles sont supposées connues.” La tache pourtant ne serait pas d’expliciter les règles, mais étant donné lé jeu, de definir ce qu’il faut que soient les personnages pour qu’ils puissent fonctionner comme les pièces d’un jeu, et prêter leurs traits aux fonctions que leur assigne leur place.
En s’attachant ainsi à ce qui dans la construction de l’élément, entraîne la singularité visible de l’ensemble, peut-être découvrirait-on ce qui s’y amorce d’un déplacement tel que la machine finie du roman s’ouvre à une succession indéfinie d’états.
[47]Sans doute le roman classique est, lui aussi, de toujours, un jeu unissant et opposant des personnages, mais comment douter qu’il ne s’instaure en le dissimulant d’un stratagème où les fonctions du jeu ne doivent se dessiner que par la ruse de l’individuation? Ce serait le mince déport qu’à suivre les parties jouées, l’analyse structurale devrait subir dans le silence, elle qui doit tout parler, la profondeur qu’il lui faut admettre, elle qui doit tout dévoiler en surface: le mouvement par lequel les noeuds où les fonctions se lient, reçoivent un contenu qui, tout à la fois, les repère et recouvre leurs relations.
Si les personnages ne sont tels qu’en tant que sur eux l’espace de l’oeuvre imprime les effets de sa règle, ils ne sont tels aussi qu’à recouvrir, méconnaître et faire méconnaître ces effets et la règle qu’ils impliquent. Chacun d’eux-métaphorise la fonction, la fait tomber sous soi, récusant l’oeuvre comme l’espace délimité où ils se meuvent, la faisant valoir pour un monde infini - et n’en donne plus que la monnaie métonymique, soit les marques d’une fonction désormais recouverte.
Qu’est-ce à dire, sinon que ce qui vient en place du noeud fonctionnel, est le masque de la personne en tant qu’elle porte les insignes de son individuation: les traits d’une singularité (physionomie, nom, caractère …) rassemblés dans le reflet où le personnage se reprend, d’où il tire le je qui le résume - ce je à partir duquel, dans un mouvement de retour, il exerce sur ses traits rassemblés en insignes, une maîtrise de propriétaire.
Un système est constitué, où le roman classique pourrait reconnaître son principe en tant qu’on le décrit par les rapports qu’il établit entre des éléments dénommés personnages. Dans ce système, le personnage comme tel doit trouver son organisation interne par une double corrélation unissant les traits qu’il croit siens au je qu’il profère et par quoi il s’annonce:
- corrélation de propriété, où disant je, il exerce sa maîtrise sur les traits qui le singularisent.
- corrélation de distinctivité, où les traits assurent le personnage que son je possède un contenu singulier et distinct.
Entre les traits, les insignes et les marques, la relation est dès lors si étroite qu’il suffirait d’une modification en un seul de ses termes pour que se disperse le tout. Mais s’il faut, réciproquement, que les personnages deviennent les pièces d’un jeu où ils fonctionnent en tant même qu’ils sont figures, où leur autonomie personnelle doit présenter immédiatement et sans dissimulation la spécificité d’une fonction incarnée, la voie nécessaire est de récuser, en dissociant [48] leurs composants le double rapport de propriété et de distinction qui les constitue.
Si donc Aragon prend le parti de construire un jeu explicite, où les pièces ne sont pièces qu’autant qu’elles sont figures autonomes, mais ne peuvent, dans leur constitution de figures, que démontrer leur dépendance réciproque, un cycle de transformation s’engage, dont il faut suivre le développement.
Supposons, par exemple, que le sujet - disons Antoine - soit par le chant de Fougère, privé du reflet qui rassemblait ses traits: faut-il dire qu’Antoine y doit trouver son autonomisation - que c’est là ce qui le distingue? Sans doute, mais de cette distinction, il ne saurait y avoir propriété, si vraiment le reflet est comme la totalisation des biens dont le personnage se veut maître - où il se reconnait grâce au double réfléchi par le miroir.1 Cela même qui le distingue, Antoine, privé du reflet, ne peut s’en savoir propriétaire.
Mais par un mouvement corrélatif de cette perte, la ressemblance unissant le sujet à son double réfléchi - ressemblance si fidèle qu’il la veut croire réduplication - désormais sans support, se déplace et se fixe sur une seconde figure que la perte ici engendre comme son complémentaire: Alfred, qui doit se saisir dans cette ressemblance même entre l’image que lui renvoie son miroir et un autre qui se distingue de ne pas faire tache dans le miroir. Alfred sait de quoi se dire le propriétaire, il peut de ses traits reconnaître le dessin, mais jamais il ne peut les savoir siens: dans la réduplication de la ressemblance, la propriété vacille, chaque trait d’Alfred demeurant toujours conférable à Antoine: “à quel détail reconnaître Sosie?”
D’Antoine privé du reflet qui lui donnerait à connaître ce dont il est propriétaire ou d’Alfred, confondu par la ressemblance qui, des traits où il devrait se ressaisir, abolit la distinctivité, aucun ne saurait assurer son individuation par les traits qu’il se donne: recusant [49] en sa double portée la corrélation qui composait le personnage classique, la dépossession s’installe en son coeur même; les traits et le je désassemblés ne sauraient plus fonctionner conjointement comme insignes; l’individuation détachée doit trouver une autre garantie, le masque de la personne se fend et laisse apercevoir les fonctions qu’ailleurs il lui faut recouvrir.
Un reploiement s’accomplit par quoi les traits d’Antoine et d’Alfred deviennent les marques qui les unissent en les opposant. Dans les jeux du roman classique, les marques signalant les fonctions ne sauraient affecter le personnage même, puisqu’ils reposent tout entiers sur son intégrité de personne individuelle. Le discours critique est censé rechercher ces marques hors du personnage, dans l’insistance d’une structure rejetée. Ici, au contraire, il apparaît que la fonction qui unit Alfred à Antoine, le sosie à son autre, doit se donner sans détour à la place même de leur individuation et se signaler au niveau de la collection de ces particularités qui sont si volontiers insignes de l’intimité séparée de la personne - couleur des yeux, fonctions corporelles (le reniflement), caractère (la jalousie) -
La couleur des yeux désormais est repère de différence, sans doute, mais plus encore, dans l’oscillation qui unit le bleu au noir, marque la prise dont s’assure ici une relation fonctionnelle de ressemblance et de complémentarité. Il ne suffit pas de dire en effet que la couleur des yeux oppose Alfred à Antoine, car le plus singulier n’est-il pas que la couleur des yeux puisse venir à être le trait qui les oppose?
De ce point de reploiement, il est possible de faire naître une série de variantes où marques, traits et insignes, se combinant, délimiteraient des places distinctes, caractérisées chacune par un enclenchement propre des pièces d’un système ruiné, - et composant, dans leur suite les figures du roman: Fougère, dont les noms se multiplient - Ingeborg, Madame d’Usher, Murmure, autour d’une physionomie identique à elle-même; dont il faudrait dire que le chant est son insigne - mais son chant peut la fuir, et cet insigne n’est autre que le tranchant de la dépossession, la faille où dans l’abolition de tous les insignes, tombent les cosmologies centrées autour d’un moi leurré. La voix de Fougère, qui devait être son insigne, n’est alors que la marque lui assignant la place fonctionnelle où passent les réseaux de l’individuation qu’au gré de l’amour et de la jalousie, elle confère et retire.
- Christian, dont le reflet - subtilement différent du réfléchi - multiplie la physionomie autour d’un nom identique; dont, aussi bien, les noms - Christian, Jérôme - se pluralisent autour d’une ressemblance. A la fois singularisé, et dans sa singularité, indéfini, il est [50] catégorie, quand Fougère, par son chant, ouvrait un monde. Son visage et son nom, variant tour à tour, lui confèrent l’individuation sérielle du type, du personnage de fiction que l’on invente pour que la jalousie s’y pose, comme si, dans l’éclatement du masque personnel qu’effectue l’oscillation alternante du nom et de la physionomie, devait apparaître la phase fonctionnelle de ceux qui masquent la fonction.2
Place encore d’Alfred et d’Antoine qu’il faut retrouver puisqu’elle a le privilège d’être le lieu du je, insigne des insignes, fondement du jeu, puisqu’Antoine ne saurait être pris pour séparable d’Alfred que dans la mesure exacte où il peut se désigner comme source autonome de l’énoncé.
A ce niveau, sans doute, le je de dialogue n’est qu’un repère, le signal d’une différence redoublant l’opposition des yeux où l’absence de reflet. Mais laissé seul, ce repère se vide de tout pouvoir, fût-ce dans la répartie: “Je réponds: ‘C’est moi ....’ avec le pincement au coeur de l’équivoque”. Le je ne fonctionnant comme distinctif qu’à désigner un locuteur déjà distingué en son unicité, pour répondre à l’interrogation “qui est-ce?” ou “qui, je?”, il faut que l’un et l’autre, Antoine comme Alfred, donnent à ce shifter commun - sous peine de le réduire à la sonorité d’un chuchotement - le contenu venu d’ailleurs d’une possession.
Privé de reflet, ses yeux marqués d’une couleur dont rien ne l’assure, doté d’une jalousie qu’il récuse, Antoine ne saurait trouver de contenu à donner au je qui dans le dialogue, l’autonomise, sinon par les oeuvres qu’il signe et qui, grâce à la célébrité qu’elles lui confèrent, lui fournissent même un nom: Antoine Célèbre, écrivain réaliste.
[51]Mais le rapport ici s’inverse, puisque le littéraire peut être aussi bien le lieu où la perte de l’image se consomme, où le sujet peut se dissimuler sous des noms arbitraires et achever sa dépersonnalisation grâce aux variations de l’effacement que sont les nouvelles de la Chemise rouge.
Veut-il même maintenir son je dans l’oeuvre, veut-il dans ce qui doit consolider sa différence, replacer le je qui la supporterait, Antoine le soumet du même coup à des lois qui échappent à son arbitre personnel; écrivant je, il le sépare de lui, le jette dans cet espace où les repères s’effacent: “il existe une zone de confusion, une région où nos silhouettes tendent à se superposer, .... c’est où l’un comme l’autre nous cessons d’exister pour autrui, pour n’être que soi-même, je veux dire quand nous écrivons.”
Un glissement perpétuel est ainsi défini où, si l’on accepte de donner Antoine pour possesseur d’un écrire, il a la possession, mais non pas l’instrument qui lui permettrait de s’annoncer possesseur, puisque ce qu’il possède efface le je distinct d’où il pourrait revenir comme propriétaire.
En face de lui, Alfred ne peut trouver de son je qu’un contenu dédoublé, les traits que lui renvoie son miroir étant ceux-là mêmes dont il faudra doter Antoine, la jalousie dont on le blâme n’étant que la jalousie qu’Antoine récuse. Ayant l’insigne du possesseur, tout ce qu’il y rapporte est dépossession: le seul bien qui lui reste est le sigle de son je qu’inlassablement il adjoint à ses biens dédoublés - au point qu’il nous faut dire qu’Alfred, en face d’Antoine, propriétaire de l’écrire, est propriétaire du je.
Mais dans ce paradoxe qu’Alfred doive assurer son je de l’affirmation d’un ‘c’est moi’ répété, qu’il lui faille posséder ce point d’où part toute propriété, le je, devenu objet de propriété, ne peut plus être rapporté qu’à un vide anonyme. Si le seul bien d’Alfred est de pouvoir dire ‘c’est moi’ , il lui faut pour le posséder, reculer jusqu’à une troisième personne: “celui-là qui t’a dit: ‘je t’aime’, Fougère, ô Fougère, as-tu donc oublié que c’était moi?.”
Par ce recul d’un je possédé à un point de possession anonyme, le dédoublement s’établit au coeur même d’Alfred, et de la division qui le sépare d’Antoine, fait la présence en lui pour toujours insistante.
Si pour Antoine, l’écrire suscite, en la consommant, la dépossession qui frappe le je de dialogue que le jeu lui confère, Alfred, de la dépossession, fait surgir un écrire: dédoublé dans ses traits, dédoublé dans son je, conscience de ce dédoublement, il écrit en première [52] personne comme un témoin du jeu dont il est, à ce titre, partie.3
Que reste-t-il alors de la distinction entre Antoine et Alfred? Si l’écrire en face du dialogue est cette bande inorientable où les repères s’effacent, comment le je écrit pourrait-il de deux figures reprendre l’opposition? La relation du témoin ne cesse pas de verser dans la confession de l’acteur - en un glissement perpétuel du je dont les premières pages représentent la naissance.
Alors apparaît un pouvoir nouveau qui, s’opposant à la multiplication des figures d’Antoine et d’Alfred, lui donne sa valeur par la condensation qu’il en effectue - pouvoir dont Aragon ne veut nous énoncer que l’effet contraignant: “Il est plus facile de distinguer, l’une de l’autre, en nous la marionnette, que d’attribuer à Antoine ou à Moi, ces textes où nous avons tous deux tendance à glisser de la première à la troisième personne, et vice versa: en fait, la coïncidence de nos deux images se fait dans l’auteur, je veux dire (qui, je?) dans ce moment où la pensée peut sembler émaner d’un tiers, dit l’auteur.”
L’écrire d’Antoine et l’écrire d’Alfred se trouvent conjoints dans un écrire tiers, qui supporte leur oscillation et donne son contenu au je brouillé des premières pages, comme s’il fallait comprendre qu’Antoine dépend d’un mouvement, qui ne se dévoile que par son apparition: l’auteur, écrivant, engendre par là même Antoine et Alfred; Antoine comme celui qui écrit, et Alfred comme celui qui le sait, reste de la division imposée par l’écrire, mais tel qu’il ne puisse se reprendre que dans la dualité insistante des termes divisés. Un écrire premier sépare Antoine et Alfred, qui doit être saisi dans la propriété conférée à Antoine d’un écrire - 2 - qui l’autonomise - mais à la lumière d’un écrire - 3 - qui en témoigne et dont Alfred comme tel devrait être marqué. Mais l’écrire primordial, seul Alfred nous le peut donner, dans son témoignage, comme la tierce partie, la loi qui articule les rapports de deux termes qui s’imagent.
Dans cette tierce figure, apparaît enfin la place dernière - qui, se rangeant de droit dans la suite des figures romanesques, s’oppose pourtant à toutes: place d’un je de l’auteur auquel ne peut répondre aucune physionomie, sinon le passage des yeux bleus aux yeux noirs, aucun nom sinon la superposition d’Antoine à Alfred, soit cet A qui en est le produit, aucun pronom, sinon le je brouillé d’une parole sans émetteur individué - figure pure d’une individuation sans insignes, qui n’a besoin d’aucun insigné pour s’assurer, d’aucun trait pour exercer sa maîtrise.
[53]Figure de la non-figure, ce point de rassemblement révèle que le tournoiement de je dans le roman classique, ne se soutient que de l’unicité de la figure qui le rapporte, tandis que le clivage du support appelle la massivité d’un je qui n’ait plus à désigner que sa propre unicité.
Par un nouveau reploiement, l’insigne s’autonomise et le je qui ailleurs devait reprendre le masque comme masque et s’y reconnaissant, méconnaître les fonctions, ici, dans l’éclatement de tout masque, devient support sans méconnaissance de la fonction qui s’avance à visage découvert. Mais ce visage est l’absence d’un visage: derrière le masque, il n’était rien que la pure individuation, rien que le poids de l’écrire, une règle de l’écriture.
C’est ici en effet que doit être fondée la singularité d’une écriture qui, dans le brouillage concerté des référents, tout au long du roman, maintient une massivité identique: comme dans la théorie jakobsonienne de la poésie, où l’opposition paradigmatique est projetée dans l’équivalence séquentielle, le je, repère d’opposition dans le dialogue, projeté dans la séquence écrite, est toujours synonyme. Le pronom acquiert la propriété d’être la place d’une unité suffisante à unifier les traits et les noms les plus divers: Struensce, Antoine, Aragon Pierre, du seul fait que le je les désigne, s’équivalent. “Je suis à la fois Iago, Vivien, W. Meister, Tchitchikov, Lancelot, moi-même ...”, et s’il faut dire en épigraphe que “Je est un autre”, c’est pour faire entendre que d’être par l’écriture altéré, il est dès lors toujours un.
Dans le déroulement de l’écriture, une accentuation isotone se fait ainsi entendre pour la régler. La phrase, s’enroulant volontiers d’une inversion qui la reploie, semble toujours se nourrir d’un retour à un centre, à la source de l’énoncé que signalent les marques de l’oral au sein de l’écriture - interjections, vulgarisme, appels -, marques répétées jusqu’à devenir scansions d’une respiration - ces “ô Fougère”, “dis ....” - où le flux d’une parole s’étale sans profondeur, alors même que le feuilletage d’une écriture singulière reprend pour les mieux conjoindre, les niveaux qu’un langage littéraire dissocierait en catégories stylistiques.
Réglant la suite des énoncés, le je, qui les fait ressassement, est aussi le lieu de la règle qui les ordonne: les propriétés de ce je singulier, qui tout à la fois lui assurent une place dans le rang des figures et le font régulateur d’une écriture, il faut, par un nouveau retournement, trouver ce qui les fonde: c’est d’être arraché à la fonction de dialogue, pour devenir shifter de l’écrit comme tel, que le je peut se retourner sur soi et, désignant sa propre unicité, tout à la fois figurer l’auteur comme tierce source de jeux d’occultation et de mirage, et transformer l’écriture en une isotonie où il ne s’agit plus [54] de ceci que le je désigne toujours celui qui parle, mais de ceci que d’écrire, il est toujours le même.
Le je est bien massivité, absorption, mais sa compacité n’est que celle de l’écrit: figure parmi les figures, il désigne la loi de leur constitution, l’espace où elles se meuvent, puisqu’en tant qu’il est autonome, il devient figure de l’écrire désindividuant - figure s’oppossant à la pluralité des figures, il manifeste que les retraits et décrochages dont se compose le jeu optique d’Antoine et d’Alfred ne sauraient apparaître que projetés sur une surface place, comme condensés dans un milieu qui les absorbe: l’écrit.
Le roman dès lors ouvre en lui-même l’espace où il s’institue. La loi qui règle la suite de son cours en resserrant l’écriture autour d’un centre toujours massif, renvoie elle-même aux lois rigoureuses de l’écrit: le roman, s’écrivant, se désigne lui-même comme oeuvre de l’écrit.
Sans avoir édicté la rigueur qui lui impose le brouillage du je, et qui provient de l’écrit comme tel, il lui a donné prise de lui-même en décalant les pièces dont se composait le support d’une première personne. C’est dire assez que ce je, trait le plus intime d’une écriture, dont il caractérise la frappante isotonie, ne joue que par les lois d’inertie imposées universellement par l’écrit - point de fuite où le roman est aspiré de l’intérieur vers l’extérieur, et quand il est ressassement confidentiel se retourne et se découvre littérature.
Cet espace extérieur où le roman s’institue, qui ne se révèle que dans le plus intérieur, il faut en effet dire que c’est celui de la littérature, en tant que l’écrit y exerce sa loi - rigoureuse, puisqu’elle est dépossession, mais à s’y plier, le roman acquiert le pouvoir qu’elle seule confère: se reprendre et se désigner en soi-même.
Par son autonymie, le roman cependant se divise: au cours des dernières pages, dans le silence d’Alfred et de sa folie, la voix se fait entendre d’un narrateur devenu impersonnel, toute semblable à la voix du je sans visage, mais la recouvrant par son identité même. Par l’absence du je, sans que rien change apparemment, l’oeuvre s’inverse et se transmue en ‘roman réaliste’. Les personnages se recomposent au travers d’une écriture qui se dissocie en genres stylistiques (portrait, dialogue, description, narration) et se fait littéraire. Rien ne rassemble plus les niveaux, sinon le centre du je qui à l’instant encore était saisissable, et qui, s’évanouissant dans l’amour fou, laisse sa place vide.
Là viennent à se loger les fonctions classiques de l’unification romanesque: le faux centre de l’intrigue, ici donnée comme dénouement, peut recouvrir l’absence du centre véritable. L’achèvement [55] se fait sous nos yeux, en sorte que le roman classique prend forme devant nous; alors que le tenant-lieu en apparaît déjà, le centre rejeté est encore à s’évanouir, présent seulement dans les italiques, dont la séquence étalée signifie l’insistance d’une exclusion.
Ce moment final où commence une littérature, c’est de lui que doit nous être donnée la Mise à mort, suscitée rétroactivement comme le récit des effets de la littérature même. Mais le rassemblement efface le récit et l’abolit en ressassement d’un je affolé: se désignant, le roman n’est plus ce qu’il désigne, et par ce dédoublement, découvre le principe de la machine romanesque et de l’indéfinité de ses états.
Le débordement constant des termes sur eux-mêmes, il nous faut à présent le rapporter à l’autonymie paradoxale du “je mens”; l’indéfinité des cycles de transformations n’est ici que la reprise d’une structure logique - dilemme du miroir dont on ne sait s’il est miroir par la perfection du mirage qu’il renvoie, ou par la tache légère qui le signale comme surface réfléchissante, dilemme de la fiction réaliste, ignorant si elle est réaliste à s’effacer comme fiction au point de tromper les yeux, ou à s’effacer comme tromperie en se donnant pour fiction.
De ce paradoxe, Aragon fait le principe d’une machine propre à fonctionner d’elle-même dans une indéfinité: des figures aux fonctions, des traits aux marques, de l’individuation à l’écrit, des insignes au je, tout se reploie dans une autonymie répétée et contradictoire, telle qu’on n’en peut saisir un terme sans être contraint de parcourir la structure qui de ce point est le passé et l’avenir, et la multiplication incessamment reprise.
A suivre pourtant la machine, l’analyse découvre un point de fuite. Si dans “ce qui s’écrit depuis toujours”, le point conventionnel vers quoi les lignes convergent demeure un “infini bien sage, qui ne sort pas des limites du papier”, n’est-ce pas qu’excluant de soi le pouvoir littéraire qui est à leur principe et qu’elles refusent de désigner, les oeuvres peuvent toujours construire la première personne comme lieu d’une connaissance adéquate, fût-ce de son ignorance même, règne serein de l’absolu savoir de soi où les mensonges viennent prendre leur source et tout à la fois se dénoncer, point de transparence du narrateur-témoin qui réfléchit sans diffraction les rapports.
Désignant désormais, par l’assomption des lois de l’écrit, à la fois l’acteur et le témoin, la première personne perd la connaissance avec l’unicité: il ne s’agit plus, comme dans tel artifice policier, de la constituer comme lieu de mensonge, mais de la représenter comme instrument de leurre.
[56]Mais à l’instant où la grammaire de la première personne voudrait achever sa clôture, surgit l’extérieur qui lui donne son lieu, et qu’elle a recouvert en s’instituant: un autre langage ici s’appelle, qui fonderait le jeu dont nous nous sommes accordé l’hypothèse, et de ses embranchements donnerait l’algorithme, en énonçant la vérité dont la composition du je doit nous être l’indice.
Peut-être suffira-t-il d’avoir, de ce langage, délimité le lieu - peut-être suffira-t-il que, dans la Mise à mort, il apparaisse que ce qui doit mourir est le je leurrant de ne pas se savoir leurré par le contenu qu’il croit sien, que dans le point de fuite qui règle le roman, se dessine, dans un évanouissement, la place d’une vérité, allusion à une littérature devenue véridique.
Notes
1. Comment ne pas voir qu’à ce moment où nous voulons engager l’investigation d’une grammaire, nous ne pouvons l’introduire que par un registre que rien ne peut fonder de ce qu’il permet de découvrir: de la fonction du miroir, qu’il nous faut prendre comme donnée primitive, rien de ce qu’elle permet de situer comme ‘grammaire d’Aragon’ , ne peut rendre raison. Cohérente, sans doute, la grammaire ne pourra se reclore: elle appelle un autre discours qui, circonscrivant le lieu rigoureux de leur cause, ferait apparaître les termes qu’elle manie, comme des effets. Ce discours seul pourra montrer qu’assigner aux figures les repères d’un alphabet – A A′ B C – n’est pas un jeu, ou que ce jeu est une ‘algèbre’ , seul il pourra montrer que le miroir n’est pas ‘objet de métaphore’ ou que s’il l’est, c’est de devoir être resitué dans la structure générative de sujet agent. ↵
2. Personnage partenaire des non-personnages, Christian apparaît comme un miroir convexe qui rassemble en soi tous les éléments de la scène représentée. Il n’est pas jusqu’à sa propre figure qu’il ne doive reprendre en situant parmi les composantes qui le définissent comme pièce d’un jeu explicite, celle qui le désigne comme personnage romanes¬que d’un jeu dissimulé: et c’est l’Indifférent, constitué du recouvrement de ses reflets diversifiés, figure privilégiée du personnage auquel le romancier classique réfère un caractère, des paroles, des propriétés, celui qui porte le masque de la personne, le support neutre des insignes. ↵
3. De là vient que, paradoxalement, Alfred puisse se donner pour un écrivain, “lui aussi”, réaliste à la façon du chroniqueur, du “scribe” méticuleux, “tenu à dire les choses telles qu’elles sont.” ↵