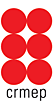Fondements d’une théorie générale des ensembles
[84]La logique mathématique1, qui n’est rien d’autre qu’une formulation à la fois rigoureuse et exhaustive de la logique formelle, a deux aspects tout à fait différents.2 D’un côté, c’est une partie des mathématiques qui traite de classes, de relations, de combinaisons de symboles, etc., au lieu de traiter de nombres, de fonctions, de figures géométriques, etc. De l’autre, c’est une science qui précède toutes les autres, et renferme les idées et les principes qui les sous-tendent toutes. C’est dans cette seconde acception que la logique mathématique fut conçue pour la première fois par Leibniz, dans sa Characteristica universalis, dont elle devait constituer une partie essentielle. Mais il fallut attendre près de deux siècles après sa mort pour que l’idée qu’il avait d’un calcul logique assez puissant pour convenir à la manière de raisonner qui se rencontre dans les sciences exactes, fût par Frege et Peano3, mise en pratique (en un certain sens au moins, si ce n’est pas celui que Leibniz avait en tête). Frege porta principalement son intérêt sur l’analyse de la pensée, et il employa surtout son calcul à dériver l’arithmétique à partir de la logique pure. Peano, en revanche, porta davantage intérêt aux applications du calcul à l’intérieur des mathématiques, créant un symbolisme élégant et souple, qui permet d’exprimer jusqu aux théorèmes mathématiques les plus difficiles avec une parfaite [85] rigueur et, souvent, une grande concision par des formules uniques.
C’est dans la ligne de la pensée de Frege et de Peano que le travail de Russell s’entama. En raison de sa laborieuse analyse des démonstrations, Frege n’avait pas dépassé les propriétés les plus élémentaires de la série des entiers, tandis que Peano avait réussi à réunir un grand nombre de théorèmes mathématiques exprimés dans le nouveau symbolisme, mais sans leurs démonstrations. C’est seulement dans les Principia Mathematica qu’une utilisation pleine et entière fut faite du nouveau symbolisme pour dériver effectivement d’un très petit nombre de concepts et d’axiomes logiques, des parties étendues des mathématiques. De surcroît, la jeune science se trouva ainsi dotée d’un nouvel instrument, la théorie abstraite des relations. Peirce et Schröder avaient déjà auparavant développé le calcul des relations, mais en lui imposant certaines restrictions, et en serrant de trop près, de manière analogique, l’algèbre des nombres. Dans les Principia au contraire, non seulement la théorie des ensembles de Cantor, mais aussi l’arithmétique ordinaire et la théorie de la mesure étaient traitées du point de vue abstrait des relations.
On doit regretter que cette première exposition complète et détaillée d’une logique mathématique et de la dérivation des mathématiques à partir d’elle, manque à ce point de rigueur formelle quant à ses fondements (présentés dans les Principia de #1 à #21) qu’elle constitue à cet égard un pas en arrière d’importance par rapport à Frege. Ce qui fait défaut par-dessus tout, c’est un énoncé rigoureux de la syntaxe du formalisme. La syntaxe n’est pas prise en considération là même où ce serait nécessaire pour donner valeur aux démonstrations, en particulier lorsqu’il s’agit des ‘symboles incomplets’ . Ceux-ci ne sont pas introduits par des définitions explicites, mais par des règles qui indiquent comment traduire les énoncés qui les contiennent en énoncés qui ne les contiennent plus. Afin d’être sûr, néanmoins, qu’une telle traduction est possible et déterminée univoquement (ou pour quelles expressions elle l’est), et que les règles d’inférence s’appliquent bien au nouveau type d’expressions également (ou jusqu’à quel point elles s’y appliquent), il est nécessaire d’avoir un aperçu général de toutes les expressions possibles, ce que seule l’étude de la syntaxe peut donner. L’incertitude est particulièrement aigus touchant la règle permettant d’opérer les substitutions, et de remplacer des symboles définis par leur definiens. Si cette dernière est appliquée aux expressions qui contiennent d’autres symboles définis, elle demande que l’ordre dans lequel ceux-ci sont éliminés soit indifférent. Ce n’est pourtant pas toujours le cas, loin de là (on peut prendre φ!û = û [φ!û] comme contre-exemple). Dans les Principia, de telles éliminations sont toujours effectuées par des substitutions dans les théorèmes correspondant aux définitions, si bien que c’est au premier chef la règle de substitution qui aurait à être démontrée.
Néanmoins je n’entends pas entrer dans plus de détails pour ce qui touche aussi bien au formalisme qu’au contenu mathématique des [86] Principia4, et je consacrerai la partie ultérieure de cet article au travail de Russell sur l’analyse des concepts et des axiomes qui soutiennent la logique mathématique. Dans ce champ, Russell a produit un grand nombre d’idées intéressantes dont on trouve certaines exposées avec le plus de clarté dans ses écrits antérieurs (ou même qu’on ne trouve que là). C’est pourquoi souvent je me référerai aussi à ces écrits antérieurs, bien que leur contenu puisse différer en partie de la position présente de Russell.
Ce qui surprend d’abord dans ce champ, c’est le réalisme prononcé de l’attitude qu’y prend Russell, dont témoignent de nombreux passages de ses écrits. “La logique a affaire au monde réel, exactement comme la zoologie, bien que ce soit aux caractéristiques les plus abstraites et les plus générales de celui-ci”, dit-il par exemple, dans son Introduction to Mathematical Philosophy (édition de 1920, p. 169). Il est vrai néanmoins que ce réalisme est allé s’atténuant au cours des années5, et qu’il a toujours été aussi plus marqué en théorie qu’en pratique. Quand il s’attaquait à un problème concret, les objets à analyser (par exemple, les classes ou les propositions) se transformaient le plus souvent en ‘fictions logiques’ . Encore que, peut-être, cela ne signifie pas nécessairement [au sens où Russell emploie cette locution] que ces choses n’existent pas, mais seulement que nous n’en avons pas de perception directe.
Russell développe l’analogie entre les mathématiques et une science naturelle à un autre point de vue encore (dans un de ses écrits antérieurs). Il compare les axiomes de la logique et des mathématiques aux lois de la nature, et l’évidence logique à la perception sensible; par suite, il n’est plus nécessaire que les axiomes soient évidents en eux-mêmes: leur justification repose plutôt (tout comme en physique) sur le fait qu’ils permettent à ces ‘perceptions sensibles’ d’être déduites; ce qui, bien entendu, n’exclut pas qu’ils aient aussi une sorte de vraisemblance intrinsèque, semblable à celle qui existe en physique. Je pense que cette conception (à condition de donner un sens suffisamment strict à ‘évidence’ ) a été justifiée dans une large mesure par les développements ultérieurs de la science, et qu’on peut s’attendre à ce que cela aille s’accentuant dans l’avenir. Il est apparu que (en assumant que la mathématique moderne est consistante) la solution de certains problèmes arithmétiques demande qu’on fasse usage d’assomptions qui fondamentalement transcendent l’arithmétique, c’est-à-dire le domaine de cette sorte d’évidence élémentaire et incontestable qui se laisse parfaitement comparer à la perception sensible. De plus, il semble vraisemblable que, pour trancher certaines questions de la théorie abstraite des ensembles et même certaines questions connexes de la théorie des nombres réels, de nouveaux axiomes fondés sur quelque idée jusqu’alors inconnue seront nécessaires. Il est possible également que les difficultés, apparemment insurmontables, que quelques autres [87] problèmes mathématiques ont présentées pendant de nombreuses années, sont dues au fait que les axiomes nécessaires n’ont pas encore été trouvés. Bien sûr, puisqu’il en est ainsi, il peut se faire que la mathématique perde une bonne part de sa ‘certitude absolue’ , mais sous l’influence de la critique moderne des fondements, cela s’est déjà en grande partie accompli. Il y a quelque ressemblance entre la conception de Russell et celle de Hilbert, lequel voulait “compléter les données de l’intuition mathématique” par des axiomes, par exemple la loi du tiers exclu, qui, à son opinion, ne sont pas donnés par l’intuition; néanmoins la frontière entre données et assomptions ne parait pas passer au même endroit selon qu’on suit Hilbert ou Russell.
Un exemple intéressant de l’analyse russellienne des concepts logiques fondamentaux est fourni par la manière dont il traite l’article défini ‘le’ . Le problème est le suivant: qu’est-ce que dénotent ou signifient6 les locutions dites descriptives (c’est-à-dire, par exemple, ‘l’auteur de Waverley’ ou ‘le roi d’Angleterre’ ), et quel est le sens des énoncés dans lesquelles elles figurent?
La réponse apparemment évidente, que ‘l’auteur de Waverley’ signifie Walter Scott, conduit à des difficultés inattendues. En effet, si nous admettons un autre axiome apparemment évident, que la signification d’une expression composée, dont les constituants ont eux-mêmes une signification, ne dépend que de la signification de ces constituants (et non de la manière dont cette signification est exprimée), il s’ensuit alors que l’énoncé ‘Scott est l’auteur de Waverley’ signifie la même chose que ‘Scott est Scott’ ; ce qui, à son tour, conduit à peu près inévitablement à la conclusion que tous les énoncés vrais ont la même signification (aussi bien que les faux).7 Frege avait effectivement tiré cette conclusion; et il l’entendait dans un sens presque métaphysique, qui rappelle quelque peu la doctrine éléatique de l’ ‘Un’ . ‘Le Vrai’ - selon Frege - est analysé par nous de différentes façons, en différentes propositions; ‘Le Vrai’ est le nom dont il se sert pour désigner la signification commune de toutes les propositions vraies.8
Or, selon Russell, ce qui dans le monde extérieur correspond aux énoncés, ce sont les faits. Il évite pourtant le terme ‘signifier’ (signify) ou ‘dénoter’ (denote), et emploie à la place ‘faire référence à’ (indicate) - dans ses articles antérieurs, il emploie ‘exprimer’ (express) ou ‘être un symbole de’ (to be a symbol for) - parce qu’il tient que la relation entre un énoncé et un fait est tout à fait différente de la relation d’un nom à ce qu’il nomme. De plus, il [88] emploie ‘dénoter’ (au lieu de ‘signifier’ ) pour la relation entre les choses et les noms, de telle sorte que ‘dénoter’ et ‘faire référence à’ correspondraient ensemble au bedeuten de Frege. Ainsi, dans la terminologie et la conception de Russell, les énoncés vrais ‘ont pour référence’ les faits et de même, les fausses ont pour référence rien.9 Par là, la théorie de Frege s’appliquerait en un sens aux propositions fausses, puisqu’elles indiquent toutes la même chose, nommément rien. Mais différents énoncés vrais peuvent avoir pour référence de nombreuses choses différentes. Cette conception des énoncés impose donc ou bien d’abandonner le principe mentionné plus haut au sujet de la signification des expressions composées (c’est-à-dire, dans la terminologie de Russell, au sujet de leur dénotation et de leur référence), ou bien de nier qu’une locution descriptive dénote l’objet décrit. Russell choisit la seconde voie10, en soutenant qu’une locution descriptive ne dénote rien du tout, et n’a de sens que par son contexte; par exemple, l’énoncé ‘l’auteur de Waverley est Scott’ est défini de telle sorte qu’il signifie: ‘Il existe exactement une seule entité qui a écrit Waverley; et quiconque a écrit Waverley est Scott.’ Cela veut dire qu’un énoncé comportant la locution ‘l’auteur de Waverley’ ne fait (à strictement parler) aucune assertion sur Scott, mais qu’il est seulement une manière contournée de faire une assertion quelconque sur les concepts qui apparaissent dans la locution descriptive. Russell allègue principalement deux arguments en faveur de cette conception, nommément, 1) qu’une locution descriptive peut être employée sans être dénuée de sens (meaningfully) même si l’objet décrit n’existe pas (par exemple dans l’énoncé: ‘le présent roi de France n’existe pas’ ); 2) qu’on peut très bien comprendre un énoncé contenant une locution descriptive sans avoir connaissance de l’objet décrit; tandis qu’il parait impossible de comprendre un énoncé sans avoir connaissance des objets sur lesquels l’assertion est prononcée. Le fait que Russell ne considère pas toute la question de l’interprétation des descriptions comme une affaire de simples conventions linguistiques, mais plutôt comme une question où il y va du vrai et du faux, est un autre exemple de son attitude réaliste, à moins peut-être qu’il n’ait eu en vue un examen seulement psychologique des processus effectifs de la pensée. Quant à l’aspect logique de la question, je ne peux me défaire de l’impression que la théorie russellienne des descriptions n’a fait qu’éluder la conclusion déconcertante (puzzling) de Frege, et qu’il y a derrière celle-ci quelque chose qui n’a pas encore été parfaitement compris.
[89]Il y a, semble-t-il, un point de vue purement formel sous lequel on pourrait donner la préférence à la théorie Russellienne des descriptions. En définissant de la manière précédente le sens des énoncés comportant des descriptions, Russell évite d’inscrire dans son système logique aucun axiome au sujet de la particule ‘le’ , c’est-à-dire que le caractère analytique des théorèmes portant sur ‘le’ est explicité; on peut montrer qu’ils suivent de la définition explicite du sens des énoncés comportant ‘le’ . Frege, au contraire, est obligé d’assumer un axiome sur ‘le’ , qui, bien sûr, est aussi analytique, mais d’une manière implicite seulement, pour autant qu’il suit du sens des termes non définis. Un examen plus approfondi montre pourtant que cet avantage de la théorie de Russell sur celle de Frege ne subsiste que si l’on interprète les définitions comme de simples abréviations typographiques, et qu’on ne considère pas qu’elles introduisent des noms pour les objets qu’elles décrivent, trait commun à Frege et Russell.
J’en viens maintenant aux plus importantes parmi les recherches de Russell dans le champ de l’analyse des concepts de la logique formelle, à savoir celles qui concernent les paradoxes logiques et leurs solutions. En analysant les paradoxes auxquels la théorie cantorienne des ensembles avait conduit, il les libéra de toute technicité mathématique, mettant ainsi en lumière que nos intuitions logiques (c’est-à-dire nos intuitions des notions telles que: vérité, concept, être, classe, etc.) sont contradictoires avec elles-mêmes. Il chercha ensuite où et comment ces assomptions du bon sens en logique doivent être corrigées, et arriva à la conclusion que l’axiome erroné consiste à assumer que pour toute fonction propositionnelle il existe la classe des objets qui la satisfait, ou que toute fonction propositionnelle existe ‘en tant qu’entité distincte’ 11; par quoi on entend à la fois quelque chose de séparable de l’argument (l’idée étant que les fonctions propositionnelles sont abstraites de propositions qui sont données à l’origine), et de distinct de la combinaison des symboles qui expriment la fonction propositionnelle; c’est alors ce qu’on peut appeler la notion ou le concept défini par elle.12 L’existence de ce concept suffit déjà à expliquer les paradoxes dans leur forme ‘intensionnelle’ , où le concept ‘ne pas s’appliquer à soi-même’ prend la place de la classe paradoxale de Russell.
Une fois rejetée l’existence d’une classe ou d’un concept en général, il reste à déterminer à quelles conditions (portant sur la fonction propositionnelle) ces entités existent bien. Russell a indiqué (loc. cit.) deux directions [90] dans lesquelles on peut chercher un tel critère, et qu’il a nommées respectivement la théorie zig-zag et la théorie de la limitation de taille; on pourrait peut-être les appeler d’une façon plus parlante la théorie en compréhension et la théorie en extension. La seconde ferait dépendre l’existence d’une classe ou d’un concept de l’extension de la fonction propositionnelle (exigeant qu’elle ne soit pas trop grande), la première de son contenu ou sens (exigeant une certaine sorte de ‘simplicité’ , dont la formulation précise serait le problème à résoudre).
Le trait le plus caractéristique de la seconde théorie (dans son opposition à la première) serait constitué par la non-existence de la classe universelle, ou (selon l’interprétation en compréhension) de la notion de ‘quelque chose’ sans restriction de sens. La théorie axiomatique des ensembles, telle qu’elle fut par la suite développée par Zermelo et d’autres, peut être considérée comme une élaboration de cette idée en ce qui concerne les classes seulement.13 En particulier, la locution ‘pas trop grand’ peut être spécifiée (comme l’a montré J. v. Neumann)14 de façon à signifier: non-équivalent à l’univers de toutes choses, ou, pour être plus précis, on peut considérer qu’une fonction propositionnelle détermine une classe quand et seulement quand il n’existe pas de relation (en compréhension, c’est-à-dire une fonction propositionnelle avec deux variables) qui associe bi-univoquement à chaque objet un objet satisfaisant la fonction propositionnelle, et vice versa. Ce critère, pourtant, n’apparaît pas comme la base de la théorie, mais comme une conséquence des axiomes, et, inversement, peut remplacer deux des axiomes (l’axiome du remplacement et celui du choix).
Quant à la seconde des suggestions de Russell, c’est-à-dire la théorie zigzag, pour elle aussi un système logique a été récemment édifié qui partage quelques traits essentiels avec ce schéma, nommément le système de Quine.15 Il se pourrait bien, en outre, qu’il y ait d’autres possibilités intéressantes dans cette voie.
Le travail ultérieur de Russell lui-même pour résoudre les paradoxes n’emprunta aucune des deux directions mentionnées ci-dessus, qu’il avait lui-même indiquées, mais s’appuya pour une large mesure sur une idée plus radicale, la théorie ‘pas-de-classe’ : les classes ou les concepts n’existent jamais comme des objets réels, et les énoncés qui contiennent ces termes n’ont de sens que dans la mesure où ils peuvent être interprétés comme une façon de parler16 des autres choses (Cf. p. 97). Étant donné pourtant que dans les Principia et ailleurs, Russell formula comme des principes logiques généraux certains principes découverts dans le développement de cette théorie, sans [91] indiquer plus longtemps qu’ils dépendaient de la théorie ‘pas-de-classe’ , je vais traiter d’abord de ces principes.
J’entends en particulier le principe du cercle vicieux, qui interdit une certaine sorte de ‘circularité’ , rendue responsable des paradoxes. L’illusion qu’ils présentent se produit, est-il affirmé, parce qu’on définit (ou qu’on accepte sans le dire) des totalités dont l’existence impliquerait l’existence de nouveaux éléments de la même totalité, nommément des éléments définissables seulement dans les termes de la totalité dans son ensemble. On est conduit par là à formuler un principe disant que “aucune totalité ne peut contenir des membres définissables seulement dans les termes de cette totalité, ou des membres mettant en jeu (involving) ou présupposant cette totalité” [principe du cercle vicieux]. Afin de rendre ce principe applicable aux paradoxes de la compréhension, un autre principe encore dut être assumé, nommément que ‘toute fonction propositionnelle présuppose la totalité de ses valeurs’ , et évidemment aussi, par conséquent, la totalité de ses arguments possibles.17 [Sans quoi le concept de ‘ne pas s’appliquer à soi-même’ ne présupposerait aucune totalité (puisqu’il ne met en jeu aucun quantificateur)18 et le principe du cercle vicieux n’empêcherait pas son application à lui-même.] Ce principe du cercle vicieux a donc pour conséquence un principe correspondant pour les fonctions propositionnelles, qui énonce que rien de ce qui est défini dans les termes d une fonction propositionnelle ne peut être un argument possible de cette fonction.19 Le système logique auquel on est conduit sur la base de ces principes est la théorie des ordres dans la forme adoptée, par exemple, dans la première édition des Principia, selon laquelle une fonction propositionnelle qui ou bien contient des quantificateurs se référant aux fonctions propositionnelles d’ordre n, ou bien peut être affirmée sans non-sens de fonctions propositionnelles d’ordre n, est au moins d’ordre n + 1, et que le domaine de signifiance [range of significance] d’une fonction propositionnelle aussi bien que le domaine d’un quantificateur doivent toujours être confinés à un ordre défini.
Dans la seconde édition des Principia, pourtant, il est déclaré dans l’introduction (p. XI et XII) que, ‘dans un sens limité’, des fonctions d’un ordre supérieur au prédicat lui-même (et par conséquent des fonctions définies dans les termes du prédicat comme, par exemple, dans p’κεκ) peuvent également apparaître comme arguments d’un prédicat de fonctions, et dans l’appendice B, de telles choses se produisent constamment. Cela veut dire que le principe du cercle vicieux pour les fonctions propositionnelles est virtuellement abandonné. Ce changement est en rapport avec le nouvel axiome selon lequel des fonctions ne peuvent figurer dans des propositions que ‘par le biais de leurs valeurs’ , c’est-à-dire en extension, ce qui a cette [92] conséquence que n’importe quelle fonction propositionnelle peut prendre pour argument n’importe quelle fonction d’un type approprié, dont l’extension est définie (quel que soit l’ordre de quantificateurs utilisé dans la définition de cette extension). Il ne fait pas de doute qu’il n’y a rien à redire à tout cela, même du point de vue constructif (voir p. 15), à condition que les quantificateurs soient toujours restreints à des ordres définis. Les paradoxes sont évités par la théorie des types simples20, qui dans les Principia est associée à la théorie des ordres (ce qui a pour résultat la ‘hiérarchie ramifiée’ ), mais qui en est entièrement indépendante, et n’a rien à faire avec le principe du cercle vicieux (cf. p. 102).
Si on en vient maintenant au principe du cercle vicieux proprement dit, tel qu’il est formulé p. 91, on doit premièrement remarquer que, à partir des expressions ‘définissables seulement dans les termes de’ , ‘mettant en jeu’ , et ‘présupposant’ , nous avons en fait trois principes différents, parmi lesquels le second et le troisième sont beaucoup plus vraisemblables que le premier. C’est la première forme qui est d’un intérêt particulier, parce qu’elle est la seule à rendre impossibles les définitions imprédicatives21, et qu’elle détruit par là la dérivation des mathématiques à partir de la logique, effectuée par Dedekind et Frege, et une bonne partie des mathématiques modernes elles-mêmes. On peut démontrer que le formalisme des mathématiques classiques ne satisfait pas au principe du cercle vicieux dans sa première forme, puisque les axiomes impliquent l’existence de nombres réels qui ne sont définissables dans ce formalisme que par référence à tous les nombres réels. Puisque les mathématiques classiques peuvent être construites sur la base des Principia (y compris l’axiome de réductibilité), il s’ensuit que même les Principia (dans la première édition) ne satisfont pas au principe du cercle vicieux dans la première forme, si ‘définissable’ signifie ‘définissable à l’intérieur du système’ , et si aucune méthode de définition à l’extérieur du système (ou à l’extérieur d’autres systèmes des mathématiques classiques) n’est connue, à part celles qui mettent en jeu des totalités encore plus étendues que les totalités figurant dans les systèmes.
[93]A mes yeux, ce qui précède démontre plutôt la fausseté du principe du cercle vicieux que celles de mathématiques classiques, et, de fait, la fausseté du principe est également vraisemblable par elle-même. Car, tout d’abord, on peut à bon droit nier que faire référence à une totalité implique nécessairement de faire référence à tous les éléments particuliers de celle-ci, ou, en d’autres termes, que ‘tous’ signifie la même chose qu’une conjonction logique infinie. On peut, par exemple, en suivant la suggestion de Langford et de Carnap22 donner à ‘tous’ le sens de l’analytique ou du nécessaire ou du démontrable. Cette conception comporte certes des difficultés; mais il ne fait pas de doute que de cette façon la circularité des définitions imprédicatives disparaît.
Deuxièmement, même si ‘tous’ si le une conjonction infinie, il semble pourtant que le principe du cerce vicieux dans sa première forme s’applique seulement si les totalités en jeu ont été construites par nous-mêmes. Dans ce cas, il doit de toute évidence exister une définition (nommément la description de la construction) qui ne se réfère pas à une totalité à laquelle l’objet défini appartienne, parce que la construction d’une chose ne peut certainement pas être fondée sur une totalité de choses à laquelle la chose à construire appartient. S’il s’agit néanmoins d’objets qui existent indépendamment de nos constructions, il n’est pas absurde le moins du monde qu’existent des totalités contenant des membres qui ne peuvent être décrits (c’est-à-dire caractérisés de manière univoque)23 que par référence à la totalité qui les contient.24 Une telle situation ne contredirait même pas la seconde forme du principe du cercle vicieux, puisqu’on ne peut pas dire qu’un objet décrit par référence ‘mette en jeu’ cette totalité, bien que la description elle-même le fasse; il ne contredirait pas non plus la troisième forme, si ‘présupposer’ signifie ‘présupposer quant à son existence’ , et non ‘quant à sa connaissance’ .
Il semble ainsi que le principe du cercle vicieux, dans sa première forme, ne s’applique que si l’on prend le point de vue constructiviste (ou nominaliste25) à l’égard des objets de la logique et des mathématiques, en particulier à l’égard des propositions, des classes et des notions, - si par exemple on entend par notion un symbole joint à une règle permettant de traduire les énoncés qui contiennent le symbole en d’autres qui ne le contiennent pas, de telle sorte que l’existence séparée d’un objet dénoté par le symbole apparaît comme une simple fiction.26
[94]Pourtant, on peut aussi concevoir les classes et les objets comme des objets réels, c’est-à-dire tenir les classes pour des ‘pluralités de choses’ ou pour des structures consistant dans une pluralité de choses, et les concepts pour les propriétés et les relations des choses existant indépendamment de nos définitions et de nos constructions.
Il me semble quant à moi qu’assumer l’existence de tels objets est aussi légitime que d’assumer celle des corps physiques, et qu’il est tout à fait aussi raisonnable d’y croire. Ils sont nécessaires pour obtenir un système satisfaisant des mathématiques, dans le même sens où les corps physiques sont nécessaires à une théorie satisfaisante de nos perceptions sensibles, et dans les deux cas il est impossible d’interpréter les propositions qu’on veut énoncer sur ces entités comme des propositions sur les ‘données’ c’est-à-dire, dans le dernier cas, sur les perceptions sensibles qui se présentent effectivement. Russell lui-même conclut dans le dernier chapitre de son livre Meaning and Truth, bien qu’ ‘avec hésitation’ , qu’il existe des ‘universaux’ , mais il désire apparemment restreindre la portée de cette déclaration aux concepts des perceptions sensibles, ce qui n’est d’aucune aide au logicien. Dans ce qui suit, j’emploierai le terme de ‘concept’ dans ce sens objectif exclusivement. On pourrait dire qu’il y a une différence formelle entre les deux conceptions des notions, qui tient à ce qu’on peut considérer que deux définitions différentes quelconques de la forme α(x) = φ(x) définissent deux notions ci différentes, au sens constructiviste. (Ce serait en particulier le cas pour l’interprétation nominaliste du terme de ‘notion’ suggérée ci-dessus, étant donné que deux définitions semblables donnent des règles de traduction différentes pour les propositions qui contiennent α.) Pour les concepts, au contraire, ce n’est pas du tout le cas puisque la même chose peut être décrite de différentes façons. Il se peut même que l’axiome d’extensionalité27, ou au moins quelque chose d’approchant, soit valable pour les concepts. La définition suivante du nombre deux peut illustrer la différence: ‘Deux est la notion sous laquelle tombent toutes les paires et rien d’autre’ . Il y a certainement plus d une notion au sens constructiviste qui satisfait cette condition, mais il se peut qu’il y ait une ‘forme’ , ou une ‘nature’ , commune à toutes les paires.
Étant donné que le principe du cercle vicieux dans sa première forme s’applique bien aux entités construites, les définitions imprédicatives et la totalité de toutes les notions, ou de toutes les classes, ou de toutes les propositions, ne peuvent pas être reçues dans la logique constructiviste. Donner une définition imprédicative, exigerait de construire une notion en combinant un ensemble de notions auquel la notion à former appartient [95] elle-même. De ce fait, si on tente de retraduire un énoncé contenant le symbole d’une notion ainsi définie d’une manière imprédicative, il se trouve que ce qu’on obtient contiendra de nouveau un symbole de la notion en question.28 Il en est ainsi du moins si a ‘tous’ signifie une conjonction infinie; mais l’idée de Carnap et de Langford (mentionnée p. 93) ne serait d’aucun secours en l’occurrence, parce que la ‘démontrabilité’ , si elle était introduite d’une façon compatible avec la conception constructiviste des notions, aurait à se diviser (split) en une hiérarchie d’ordres, qui empêcherait d’obtenir les résultats désirés.29 Comme Chwistek l’a montré,30 il est même possible, à condition de faire certaines assomptions recevables à l’intérieur de la logique constructiviste, de dériver une contradiction effective de l’utilisation sans restriction de définitions imprédicatives. Pour être plus précis, il a montré que le système des types simples devient contradictoire si on y ajoute ‘l’axiome de compréhension’ qui énonce (en gros) qu’à des définitions différentes appartiennent des notions différentes. Cet axiome, pourtant, comme on vient de l’indiquer, peut être considéré comme valable pour les notions au sens constructiviste.
S’agissant de concepts, l’aspect de la question change du tout au tout. Puisque les concepts sont supposés exister objectivement, il semble qu’il n’y ait d’objection ni à parler d’eux tous (cf. p. 99), ni à décrire certains d’entre eux par référence à tous (ou au moins à tous ceux d’un type donné). Mais, peut-on demander, cette conception n’est-elle pas également réfutable pour les concepts, puisqu’elle conduit à cette ‘absurdité’ qu’il devra exister des propriétés φ telles que φ(a) consiste en un certain état de choses mettant en jeu toutes les propriétés (y compris φ elle-même et les propriétés définies dans les termes de φ) ce qui voudrait dire que le principe du cercle vicieux n’est pas valable, même dans sa seconde forme, pour les concepts ou les propositions? Il ne fait pas de doute que la totalité de toutes les propriétés (ou de toutes celles d’un type donné) conduit bien à des situations de cette sorte, mais je ne pense pas qu’elles contiennent une absurdité quelconque.31 Il est vrai que de telles propriétés φ [ou de telles propositions φ(a)] auront à se contenir elles-mêmes à titre de constituants de leur contenu [ou de leur sens], et, en fait, à bien des titres, à cause des propriétés définies dans les termes de φ; mais cela rend seulement impossible de construire [96] leur sens (c’est-à-dire, le considérer comme une assertion sur les perceptions sensibles ou toute autre entité non-conceptuelle), ce qui n’est pas une objection pour qui prend le point de vue réaliste. De même il n’est pas contradictoire qu’une vraie partie soit identique (non pas simplement égale) au tout, comme on le voit dans le cas des structures au sens abstrait. La structure de la série des entiers, par exemple, se contient elle-même comme vraie partie, et on voit aisément qu’il existe aussi des structures contenant un nombre infini de parties différentes, dont chacune contient l’ensemble de la structure comme une partie. Au surplus, il existe, même à l’intérieur du domaine de la logique constructiviste, des éléments qui sont proches de l’autoréflexivité des propriétés imprédicatives, à savoir des propositions qui contiennent, comme parties de leur sens, non pas elles-mêmes, mais leur propre démontrabilité formelle.32 Or la démontrabilité formelle d’une proposition (lorsque les axiomes et les règles d’inférence sont corrects) implique cette proposition, et, dans beaucoup de cas, lui est équivalente. En outre, il existe sans aucun doute des énoncés qui se réfèrent à une totalité d’énoncés dont ils font eux-mêmes partie, comme, par exemple, l’énoncé: ‘Tout énoncé (d’un langage donné) contient au moins un mot exprimant une relation.’
Il va de soi que cette conception des propriétés imprédicatives impose de chercher une autre solution des paradoxes : l’illusion (c’est-à-dire l’axiome erroné sous-jacent) ne résiderait pas alors dans l’assomption de certaines autoréflexivités des termes primitifs, mais dans d’autres assomptions à leur sujet. Une telle solution peut être trouvée pour l’heure dans la théorie simple des types, et pour l’avenir, peut-être dans le développement des idées esquissées p. 90 et p. 104. Tout cela ne se réfère bien sûr qu’aux concepts. Pour ce qui est des notions au sens constructiviste, il ne fait pas de doute que les paradoxes sont dus à un cercle vicieux. Il n’est pas surprenant que les paradoxes aient des solutions différentes selon les différentes interprétations des termes en jeu.
Pour ce qui est des classes entendues comme pluralités ou totalités, il semblerait qu’elles sont également non pas créées, mais simplement décrites par leurs définitions, et que par conséquent le principe du cercle vicieux sous sa première forme ne s’y applique pas. Je pense même qu’il existe des interprétations du terme de ‘classe’ (nommément celles qui en font une certaine sorte de structures) où il ne s’applique pas non plus sous sa seconde forme.33 Mais pour le développement de toutes les mathématiques contemporaines, on peut même assumer qu’il s’applique bien sous [97] sa seconde forme, ce qui est en vérité, pour les classes conçues comme simples totalités, très vraisemblable. On est alors conduit à quelque chose comme l’axiome de Zermelo pour la théorie des ensembles, c’est-à-dire que les ensembles sont divisés en ‘niveaux’ de telle façon que seuls les ensembles des niveaux inférieurs peuvent être éléments des ensembles de niveaux supérieurs (c’est-à-dire x ∊ y est toujours faux si x appartient à un niveau supérieur à y). Il n’y a aucune raison pour que des classes en ce sens-là excluent les mélanges de niveaux dans un ensemble, et les niveaux transfinis. La place de l’axiome de réductibilité est maintenant prise par l’axiome des classes [l’Aussonderungsaxiom de Zermelo] qui énonce que, à chaque niveau, il existe pour une fonction propositionnelle arbitraire φ(x), l’ensemble des x du niveau pour lesquels φ(x) est vrai, et cela semble être impliqué par le concept des classes comme pluralité.
Russell allègue deux raisons contre la conception extensionnelle des classes, à savoir l’existence 1) de la classe nulle, qu’on ne voit pas très bien être une collection, et 2) des classes-unités, qui devraient être identiques à leur élément unique. Mais il me semble que ces arguments, s’ils prouvent quelque chose, prouvent tout au plus que la classe nulle et les classes-unités (en tant que distinctes de leur seul élément) sont des fictions (introduites pour simplifier le calcul comme les points à l’infini en géométrie), et non pas que toutes les classes sont des fictions.
Mais chez Russell, les paradoxes ont induit une tendance prononcée à pousser la construction de la logique aussi loin que possible sans assumer l’existence objective d’entités telles que les classes et les concepts. Cela l’a conduit à formuler la théorie ‘pas-de-classe’ déjà mentionnée, selon laquelle les classes et les concepts devaient être introduits comme une façon de parler.34 Mais les propositions, à leur tour, (en particulier celles qui mettent en jeu des quantificateurs)35, furent par la suite incluses pour une large mesure dans ce schéma, qui n’est qu’une conséquence logique de la position adoptée, puisque, par exemple, les propositions universelles, en tant qu’entités existant objectivement, appartiennent de toute évidence à la même catégorie d’objets idéaux que les classes et les concepts, et conduisent à des paradoxes de la même sorte, si on les admet sans restrictions. En ce qui touche aux classes, ce programme a été effectivement rempli; c’est-à-dire que les règles pour traduire les énoncés contenant des noms de classe ou le terme ‘classe’ en des énoncés qui ne les contiennent pas furent formulées explicitement; et la base de la théorie, c’est-à-dire le domaine des énoncés qu’on a à obtenir par traduction, est si bien assurée qu’on peut (à l’intérieur du système Principia) se dispenser des classes, mais seulement à la condition d’assumer l’existence d’un concept chaque fois qu’on veut construire une classe. Quand on en vient aux concepts et à l’interprétation des énoncés qui contiennent ce terme, ou quelque synonyme, [98] les choses ne sont en rien aussi bien assurées. En premier lieu, quelques-uns d’entre eux (les prédicats primitifs et les relations primitives, comme, par exemple, ‘rouge’ ou ‘plus froid’ ) doivent apparemment être considérés comme des objets réels36; le reste (et en particulier, selon la seconde édition des Principia, toutes les notions d’un type supérieur au premier, et par conséquent toutes celles qui intéressent la logique), apparaît comme quelque chose de construit (c’est-à-dire comme quelque chose qui n’appartient pas à ‘l’inventaire’ du monde); mais ni le domaine fondamental des propositions dans les termes desquelles tout, en définitive, est à interpréter, ni la méthode d’interprétation, ne sont aussi assurées que dans le cas des classes (voir ci-dessous).
Le schéma complet de la théorie ‘pas-de-classe’ est d’un grand intérêt, parce que c’est un des rares exemples, exécuté en détail, de la tendance à éliminer les assomptions sur l’existence d’objets en dehors des ‘données’ , et à les remplacer par des constructions effectuées sur la base de ces données.37 Dans le cas présent, le résultat a été, pour l’essentiel, négatif, c’est-à-dire que les classes et les concepts introduits de cette façon n’ont pas toutes les propriétés que requiert leur emploi dans les mathématiques, à moins d’introduire des axiomes spéciaux au sujet des données (par exemple, l’axiome de réductibilité) - axiomes dont le sens profond est de poser d’emblée l’existence dans les données des objets à construire, - ou bien encore de forger la fiction qu’on peut former des propositions de longueur infinie (ou même non-dénombrable)38, c’est-à-dire opérer avec des fonctions de vérité dont les arguments sont en nombre infini, sans s’occuper de savoir si on peut les construire ou non. Mais qu’est-ce qu’une telle fonction de vérité infinie, sinon une espèce particulière d’extension (ou de structure) infinie, et même une extension plus compliquée qu’une classe, dotée en plus d’un sens hypothétique, qui ne peut être compris que par un esprit infini? Tout cela ne sert qu’à vérifier la conception défendue plus haut, comme quoi la logique et les mathématiques (tout comme la physique) sont édifiées sur des axiomes dont le contenu est réel et ne peut pas être ‘supprimé par élucidation’ (explained away).
Ce qu on peut obtenir à partir de l’attitude constructiviste, c’est la théorie des ordres (cf. p. 92); c’est à présent seulement (et c’est le point fort de la théorie) que les restrictions en cause n’apparaissent pas comme des hypothèses ad hoc pour éviter les paradoxes, mais comme des conséquences inévitables de la thèse selon laquelle les classes, les concepts, et les propositions quantifiées n’existent pas en tant qu’objets réels. Ce n’est pas comme si l’univers des choses était divisé en ordres, et puis qu’on interdise de parler de tous [99] les ordres; mais, au contraire, il est possible de parler de toutes les choses existantes; seulement, classes et concepts ne sont pas dans leur nombre; et si on les introduit comme des façons de parler39, il advient que cette extension même du symbolisme ouvre la possibilité de les introduire d’une façon plus étendue, et ainsi de suite indéfiniment. Afin d’exécuter ce schéma, on doit, pourtant, présupposer l’arithmétique (ou quelque chose d’équivalent), ce qui prouve seulement que même cette logique restreinte ne peut être édifiée sur rien.
Dans la première édition des Principia, où il s’agissait d’édifier effectivement la logique et les mathématiques, l’attitude constructiviste fut, pour la majeure partie, abandonnée, étant donné que l’axiome de réductibilité pour les types supérieurs au premier, joint à l’axiome d’infinité, rend absolument nécessaire qu’il existe des prédicats primitifs pour des types arbitrairement élevés. Ce qui reste de l’attitude constructiviste, c’est seulement: 1) l’introduction des classes comme une façon de parler; 2) la définition de ~, ∨,., etc., en tant qu’appliqués à des propositions contenant des quantificateurs (ce qui incidemment a montré sa fécondité dans une démonstrations de consistance pour l’arithmétique); 3) la construction pas à pas des fonctions d’ordre supérieur à 1, ce qui, pourtant, est rendu superflu en raison de l’axiome de réductibilité; 4) l’interprétation des définitions comme de simples abréviations typographiques, ce qui fait de chaque symbole introduit par définition un symbole incomplet (et non pas un symbole nommant un objet décrit par la définition). Mais le dernier point est, dans une large mesure, une illusion, parce que, en raison de l’axiome de réductibilité, il existe toujours des objets réels, sous la forme de prédicats primitifs, ou de leurs combinaisons, correspondant à chaque symbole défini. En définitive la théorie des descriptions de Russell est quelque chose qui appartient aussi à l’ordre d’idées constructiviste.
Dans la seconde édition des Principia (ou pour être plus précis, dans l’introduction de celle-ci) l’attitude constructiviste est de nouveau adoptée. L’axiome de réductibilité est abandonné, et il est explicitement déclaré que tous les prédicats primitifs appartiennent au type le plus bas, et que les variables (et, de toute évidence, les constantes également) des ordres et des types plus élevés ont pour seul but de permettre de poser des fonctions de vérité plus compliquées pour les propositions atomiques40, ce qui n’est qu’une autre manière de dire que les types et les ordres plus élevés ne sont qu’une façon de parler. Cette déclaration nous apprend en même temps de quelle sorte de propositions la base de la théorie doit être faite, à savoir des fonctions de vérité de propositions atomiques.
Pourtant, cela ne va sans difficulté que si le nombre des individus et des prédicats primitifs est fini. Pour le cas contraire, qui est surtout intéressant si on veut dériver les mathématiques, Ramsey (loc. cit.) a pris le parti de [100] considérer notre incapacité à former des propositions de longueur infinie comme un ‘simple accident’ , à négliger par le logicien. Il va de soi que cela résout (ou plutôt tranche) les difficultés; on doit noter que si on laisse de côté à cet égard la différence entre fini et infini, il existe une interprétation plus simple, et qui va en même temps bien plus loin, de la théorie des ensembles (et, par-dessus le marché, des mathématiques). Plus précisément, dans le cas d’un nombre fini d’individus, l’aperçu41 de Russell, qui dit que des propositions portant sur des classes peuvent être interprétées comme des propositions portant sur leurs éléments, devient littéralement vrai, puisque, par exemple, ‘x∈m’ est équivalent à ‘x = a1 ∨x = a2 ∨... ∨x = ak’ où les ai sont les éléments de m; et ‘il existe une classe telle que...’ est équivalent à: ‘il existe des individus x1, x2, ..., xn tels que ...’ 42, pourvu que n soit le nombre des individus existant dans le monde, et pourvu que nous négligions pour l’instant la classe nulle, dont il faudrait prendre soin par une clause supplémentaire. Il va de soi que, par une répétition de cette procédure, on peut obtenir des classes de classes, etc., si bien que le système logique obtenu ressemblerait à la théorie des types simples, à ceci près que des mélanges de types seraient possibles. La théorie axiomatique des ensembles apparaît alors comme une extrapolation de ce schéma pour le cas où il y a un nombre infini d’individus ou une répétition infinie du procès de formation des ensembles.
Il va de soi que le point de vue de Ramsey n’est rien moins que constructiviste, à moins qu’on n’accepte des constructions d’un esprit infini. Russell, dans la seconde édition des Principia, a pris le parti moins métaphysique de se restreindre aux fonctions de vérité qui peuvent être effectivement construites. De cette façon, on est de nouveau conduit à la théorie des ordres, qui apparaît pourtant maintenant sous un jour nouveau, à savoir comme une méthode pour construire des fonctions de vérité de propositions atomiques de plus en plus compliquées. Mais cette procédure semble présupposer l’arithmétique sous une forme ou une autre (voir le paragraphe suivant).
Quant à la question de savoir jusqu’à quel point les mathématiques peuvent être édifiées sur cette base (sans rien assumer des données - c’est-à-dire des prédicats primitifs et des individus - sinon, autant qu’il est nécessaire, l’axiome d’infinité), il est clair qu’on ne peut obtenir la théorie des nombres réels dans sa forme actuelle.43 Pour ce, qui est de la théorie des entiers, la seconde édition des Principia soutient qu’il est possible de l’obtenir. La difficulté à surmonter est que dans la définition des entiers comme ‘les cardinaux qui appartiennent à toute classe contenant 0, et contenant x + 1 si elle contient x’ , l’expression ‘toute classe’ doit se référer à un ordre donné. Ainsi on obtient des entiers d’ordres différents, et l’induction complète ne peut être [101] appliquée aux entiers d’ordre n que pour les propriétés d’ordre n + 1; alors qu’il arrive fréquemment que la notion d’entier elle-même figure dans la propriété à laquelle l’induction est appliquée. Pourtant, cette notion est d’ordre n + 1 pour les entiers d’ordre n. Or, dans l’appendice B de la seconde édition des Principia, une démonstration est offerte que les entiers de n’importe quel ordre supérieur à 5 sont les mêmes que ceux d’ordre 5, ce qui réglerait bien entendu toutes les difficultés. La démonstration pourtant, telle qu’elle se présente, n’est certainement pas concluante. Dans la démonstration du lemme principal #89. 16, qui énonce que tout sous-ensemble α (d’ordre arbitrairement élevé)44 d’une classe inductive β d’ordre 3 est lui-même une classe inductive d’ordre 3, l’induction est appliquée à une propriété de β mettant en jeu α [à savoir α - β ≠ Λ, ce qui pourtant devrait s’écrire α - β ~ ∈ Induct2 parce que (3) est de toute évidence faux]. Cette propriété est pourtant d’un ordre > 3 si a est d’un ordre > 3. Aussi la question de savoir si (ou jusqu’à quel point) la théorie des entiers peut être obtenue sur la base de la hiérarchie ramifiée doit être considérée comme non-résolue pour l’heure. Il est à noter, pourtant, que, même au cas où la question aurait une réponse positive, le problème de savoir si l’arithmétique procède de la logique, n’en serait pas plus avancé, si on définit (comme dans la seconde édition des Principia) les fonctions propositionnelles comme des combinaisons (de quantificateurs, de connecteurs propositionnels, etc.) finies (bien que d’une complexité arbitraire), parce que la notion de finitude est dès lors à présupposer - fait qui n’est dissimulé qu’en prenant comme termes primitifs du formalisme des notions aussi compliquées que ‘fonctions propositionnelles d’ordre n’ sous une forme non analysée, et en ne donnant leur définition qu’en langage commun. Peut-être peut-on répliquer que dans les Principia la notion de fonction propositionnelle d’ordre n n’est ni considérée comme primitive, ni définie dans les termes d’une combinaison finie, mais que les quantificateurs se référant aux fonctions propositionnelles d’ordre n (ce qui est tout ce dont on a besoin) sont plutôt définis comme certaines conjonctions et disjonctions infinies. Mais on peut alors demander: pourquoi ne définit-on pas les entiers par la disjonction infinie: x = 0∨x = 0 + 1∨x = 0 + 1 + 1∨ ... ad infinitum, s’épargnant de cette manière tous les ennuis liés à la notion d’inductivité. Toute cette objection n’aurait pas de raison d’être si on entendait par fonction propositionnelle d’ordre n une fonction propositionnelle “qui peut être obtenue à partir des fonctions de vérité de propositions atomiques ne présupposant pour leur définition aucune totalité sinon celles des fonctions propositionnelles d’ordre < n et d’individus”; cette notion, pourtant, manque quelque peu de rigueur.
La théorie des ordres se montre plus fructueuse si on la considère d’un point de vue purement mathématique, indépendamment de la question philosophique de savoir si les définitions imprédicatives sont recevables. Si on la [102] conçoit de cette façon, c’est-à-dire comme une théorie édifiée à l’intérieur du cadre des mathématiques ordinaires, où les définitions imprédicatives sont reçues, il n’y a aucune objection à l’étendre à des ordres transfinis arbitrairement élevés. Même si on rejette les définitions imprédicatives, il n’y aurait à mon avis aucune objection à l’étendre aux ordinaux transfinis qui peuvent être construits à l’intérieur du cadre des ordres finis. La théorie en elle-même semble demander une telle extension puisque elle conduit automatiquement à considérer des fonctions dans la définition desquelles on se réfère à toutes les fonctions d’ordres finis, et qui seraient des fonctions d’ordre ω. Si on admet les ordres transfinis, on peut démontrer un axiome de réductibilité. Cela n’est pourtant d’aucun secours au dessein premier de la théorie, parce que l’ordinal α - tel que toute fonction propositionnelle est équivalente en extension à une fonction d’ordre α - est si élevé qu’il présuppose des totalités imprédicatives. Néanmoins, on peut mener à bien tant de choses de cette façon-là que toutes les imprédicativités sont réduites à une seule espèce particulière, à savoir l’existence de certains grands nombres ordinaux (ou ensembles bien ordonnés) et la validité du raisonnement récursif pour eux. En particulier, l’existence d’un ensemble bien-ordonné, d’ordre ω1 est déjà suffisante pour la théorie des nombres réels. De plus, ce théorème transfini de réductibilité permet de démontrer la consistance de l’axiome de choix, de l’hypothèse du continu de Cantor (qui énonce qu’il n’existe aucun nombre cardinal entre la puissance d’un ensemble arbitraire quelconque et la puissance de l’ensemble de ses sous-ensembles) avec les axiomes de la théorie des ensembles aussi bien qu’avec ceux des Principia.
J’en viens maintenant d’une façon un peu plus détaillée à la théorie des types simples qui figure dans les Principia combinée avec la théorie des ordres; cette dernière est pourtant (comme on en a fait ci-dessus la remarque) tout à fait indépendante de la première, étant donné que les types mélangés ne contredisent évidemment en aucune sorte le principe du cercle vicieux. En conséquence, Russell fonde aussi la théorie des types simples sur des raisons entièrement différentes. La raison alléguée (en plus de son ‘accord avec le sens commun’ ) ressemble beaucoup à celle de Frege, qui, dans son système, avait déjà assumé la théorie des types simples pour les fonctions, mais n’avait pas réussi à éviter les paradoxes, parce qu’il opérait avec des classes (ou plutôt des fonctions en extension) sans aucune restriction. Cette raison est que (en raison des variables qu’elle contient) une fonction propositionnelle est quelque chose d’ambigu (ou, comme le dit Frege, de non-saturé, réclamant un supplément) et ne peut par conséquent figurer dans une proposition douée de sens que d’une façon telle que cette ambiguïté soit éliminée (par exemple, en substituant une constante pour la variable, ou en lui appliquant une quantification). Les conséquences en sont qu’une fonction ne peut remplacer un individu dans une proposition, parce que celui-ci n’a pas d’ambiguïté qui doive être levée, et que les fonctions dont les arguments (c’est-à-dire les ambiguïtés) sont de différentes sortes ne peuvent pas se remplacer l’une l’autre; ce qui est l’essence même de la théorie des types simples. Si on prend [103] un point de vue plus nominaliste (tel celui que suggèrent la seconde édition des Principia et Meaning and Truth), on devra, dans les considérations précédentes, remplacer ‘proposition’ par ‘énoncé’ (sentence). Mais dans les deux cas, cet argument appartient de toute évidence au même ordre d’idées que la théorie ‘pas-de-classe’ , puisqu’il voit dans les notions (ou fonctions propositionnelles) quelque chose que l’on construit à partir de propositions ou d’énoncés, en laissant indéterminé un ou plusieurs de leurs constituants. Les fonctions propositionnelles, en ce sens, sont, pour ainsi dire, des ‘fragments’ de propositions, qui n’ont aucun sens en eux-mêmes, et n’en acquièrent un que dans la mesure où on peut les utiliser pour former des propositions en en combinant plusieurs, ce qui n’est possible que s’ils ‘s’ajustent’ (fit together), c’est-à-dire, s’ils sont de type approprié. Mais on devait remarquer que la théorie des types simples (au contraire du principe du cercle vicieux), ne peut pas découler au sens strict du point de vue constructiviste, parce qu’on pouvait construire notions et classes d’une autre façon, et par exemple, de la manière indiquée p. 100, où les mélanges de types sont possibles. Si, d’un autre côté, on considère les concepts comme des objets réels, la théorie des types simples n’est pas très vraisemblable, étant donné que ce qu’on pourrait supposer être un concept, (comme, par exemple, la ‘transitivité’ ou le nombre deux), paraît bien être quelque chose, derrière toutes ses diverses ‘réalisations’ aux différents niveaux, et par conséquent ne pas se conformer dans son existence à la théorie des types. Néanmoins, il semble qu’il y ait quelque vérité derrière cette idée que le même concept se réalise à des niveaux divers, et on pourrait, par conséquent, attendre de la théorie des types simples qu’elle se montre au moins utile ou indispensable comme marchepied vers un système plus satisfaisant, et c’est ainsi que Quine l’a déjà utilisées.45 ‘L’ambiguïté de type’ (typical ambiguity) de Russell est également un pas dans cette direction. Étant donné pourtant que cela ne fait qu’ajouter à la théorie des types quelques conventions symboliques simplificatrices, cela ne va pas de facto au-delà de cette théorie.
On doit remarquer que la théorie des types apporte pour résoudre les paradoxes une nouvelle idée, particulièrement appropriée à leur forme en compréhension. Elle consiste à attribuer les paradoxes non pas à l’axiome que toute fonction propositionnelle définit un concept ou une classe, mais à l’assomption que tout concept donne une proposition douée de sens s’il est appliqué à tout objet ou pluralité d’objets arbitraires comme à ses arguments. L’objection évidente, que tout concept peut être étendu à tous les arguments en en définissant un autre qui donne une proposition fausse chaque fois que le premier est vide de sens, peut être aisément repoussée en montrant que le concept ‘applicable sans non-sens’ (meaningfully applicable) n’a pas besoin d’être toujours lui-même ‘applicable sans non-sens’ .
La théorie des types simples (dans son interprétation réaliste) peut être considérée comme la mise en oeuvre de ce schéma, fondé, pourtant, sur [104] l’assomption supplémentaire que voici, concernant le ‘doué de sens’ (meaningfulness): “Chaque fois qu’un objet x peut remplacer un autre objet y dans une proposition douée de sens, il peut faire de même dans toute proposition douée de sens”.46 Il s’ensuit bien sûr que les objets sont répartis dans des domaines de signifiance qui s’excluent mutuellement et sont composés chacun des objets capables de se remplacer les uns les autres; et que chaque concept n’a par conséquent de signification que pour les arguments appartenant à un de ces domaines, c’est-à-dire pour une part infiniment petite de tous les objets. Ce qui rend pourtant particulièrement suspect le principe précédent est que le seul fait de l’assumer rend impossible de le formuler comme une proposition douée de sens47 parce que x et y doivent être alors cantonnés dans des domaines définis de signifiance qui sont ou bien identiques ou bien différents: dans les deux cas, l’assertion n’exprime pas le principe, pas même en partie. Il s’ensuit également que le fait qu’un objet x est (ou n’est pas) d’un type donné ne peut pas être exprimé par une proposition douée de sens.
Il n’est pas impossible qu’on puisse mettre en oeuvre l’idée de domaines limités de signifiance en se passant du principe restrictif mentionné ci-dessus. Il pourrait même advenir qu’il soit possible d’assumer que tout concept a partout une signification, sinon en certains ‘points singuliers’ (singular points) ou ‘points limites’ (limiting points), de telle sorte que les paradoxes apparaîtraient comme quelque chose d’analogue à la division par zéro. Un tel système serait satisfaisant au plus haut point sous le rapport suivant: nos intuitions logiques demeureraient correctes, à quelques corrections mineures près, c’est-à-dire qu’elles seraient alors considérées comme donnant un tableau correct pour l’essentiel, quelque peu ‘flou’ (blurred), seulement, de l’état de choses réel. Malheureusement, les tentatives faites dans cette direction ont échoué jusqu’à maintenant48; d’un autre côté, l’impossibilité de ce système n’a pas été démontrée non plus, malgré les théorèmes d’inconsistance forte de Kleene et Rosser.49
En conclusion, je veux dire quelques mots sur la question de savoir si (et en quel sens) on peut considérer les axiomes des Principia comme analytiques. En ce qui concerne ce problème, on doit remarquer que l’analytique peut être pris en deux sens. Premièrement, cela peut vouloir dire, c’est le sens purement formel, que les termes occurrents peuvent être définis (ou d’une manière explicite, ou par des règles permettant de les éliminer des énoncés qui les contiennent) de telle sorte que les axiomes et les théorèmes [105] deviennent des cas particuliers de la loi d’identité, et les propositions réfutables des négations de cette loi. En ce sens, on peut démontrer que même la théorie des entiers est non analytique, à condition qu’on exige des règles d’élimination, qu’elles permettent effectivement dans chaque cas de mener l’élimination à son terme en un nombre fini d’étapes.50 Si on laisse cette condition de côté en admettant, par exemple, des énoncés de longueur infinie (et non-dénombrable) comme étapes intermédiaires du procès de réduction, tous les axiomes des Principia (y compris les axiomes de choix, d’infinité et de réductibilité) peuvent être démontrés analytiques pour certaines interprétations (en raisonnant d’une manière analogue à celle qui est mentionnée p. 100).51 Mais cette remarque est d’une valeur discutable, parce que l’ensemble des mathématiques en tant qu’appliquées à des énoncés de longueur infinie doit être présupposé pour arriver à démontrer ce caractère analytique; par exemple, l’axiome de choix ne peut être démontré analytique que si on assume qu’il est vrai.
En un second sens, une proposition est nommée analytique si elle reste valide ‘en raison du sens des concepts qui apparaissent en elle’ , là où ce sens est peut-être indéfinissable (c’est-à-dire irréductible à rien de plus fondamental).52 Il pourrait sembler que tous les axiomes des Principia dans la première édition, (à l’exception de l’axiome d’infinité) sont, en ce sens, analytiques pour certaines interprétations des termes primitifs, c’est-à-dire si le terme de ‘fonction prédicative’ est remplacé par ‘classe’ (au sens extensionnel) ou (en laissant de côté l’axiome de choix) par ‘concept’ , étant donné que rien ne peut mieux exprimer le sens du terme de ‘classe’ que l’axiome des classes (cf. p. 96) et l’axiome de choix, et que, d’un autre côté, le sens du terme de ‘concept’ semble impliquer que toute fonction propositionnelle définit un concept.53 La difficulté est seulement que nous n’avons pas une perception assez claire des concepts de ‘concept’ et de ‘classe’ , ainsi que le montrent les paradoxes. Devant cette situation, Russell prit le parti de considérer comme non-existants aussi bien les classes que les [106] concepts, et de les remplacer par des constructions qui sont notre fait. On ne peut nier que cette manière de procéder n’ait conduit à des idées intéressantes et à des résultats précieux, même pour qui prend le point de vue opposé. Dans l’ensemble, pourtant, cela a seulement abouti à ne laisser subsister que des fragments de la logique mathématique, à moins de réintroduire ce qu’on condamnait, sous la forme de propositions infinies, ou encore d’axiomes comme l’axiome de réductibilité, qui (lorsqu’est donnée une infinité d’individus) peut être démontré faux, à moins qu’on n’assume ou bien l’existence des classes ou bien une infinité de ‘ qualitates occultae ’ . Cela semble indiquer qu’il vaut mieux prendre un autre parti plus conservateur, celui par exemple de clarifier le sens des termes de ‘classe’ et de ‘concept’ , et d’édifier une théorie consistante des classes et des concepts, considérés comme des entités objectivement existantes. C’est là le parti qu’a pris la logique mathématique dans son développement actuel; et que Russell lui-même a été forcé d’adopter dans les parties les plus constructives de son travail. Au premier rang des tentatives faites dans cette direction (dont certaines ont été citées dans ce texte), il faut compter la théorie simple des types (qui est le système de la première édition des Principia dans une interprétation appropriée) et la théorie axiomatique des ensembles, qui toutes les deux ont réussi au moins jusqu’au point de nous permettre de dériver les mathématiques modernes en évitant tous les paradoxes connus. De nombreux symptômes, pourtant, ne montrent que, trop clairement que les concepts primitifs ont besoin d’être élucidés plus avant.
Il paraît raisonnable de penser que c’est en raison de cette compréhension incomplète des fondements que la logique mathématique est jusqu’à présent restée si en deçà des hautes espérances de Peano et d’autres qui (conformément aux assurances de Leibniz) avaient attendu d’elle qu’elle facilite autant les mathématiques théoriques que le système décimal des nombres a facilité les calculs numériques. En effet, comment peut-on espérer résoudre d’une manière systématique les problèmes mathématiques par une simple analyse des concepts qui y apparaissent, si notre analyse jusqu’à maintenant ne suffit pas même à établir les axiomes? Mais il n’est pas besoin d’abandonner tout espoir. Leibniz, dans ses écrits sur la Characteristica universalis, n’avait pas parlé d’un projet utopique; si nous devons le croire, il avait donné un développement étendu à ce calcul du raisonnement, mais remettait sa publication au jour où la graine pourrait tomber sur un sol fertile.54 Il n’hésita pas55 à donner une estimation du temps qui serait nécessaire à un petit nombre choisi de savants pour développer son calcul jusqu’au point où “l’humanité aurait en sa possession une nouvelle sorte d’instrument augmentant les pouvoirs de la raison au-delà de ce qu’aucun instrument optique [107] n’avait jamais ajouté au pouvoir de la vue.” Le temps qu’il indique est de cinq ans, et il prétend que sa méthode n’est pas plus difficile à apprendre que les mathématiques ou la philosophie de son temps. De plus, il affirma à plusieurs reprises que sa théorie, en dépit de l’état encore rudimentaire où il l’avait lui-même conduite, était responsable de toutes ses découvertes mathématiques; ce que Poincaré lui-même, on est en droit de l’espérer, accepterait pour une preuve suffisante de sa fécondité.56
The School of Mathematics
The Institute for Advanced Study
Princeton, New Jersey.
Notes
1. ‘Russell’s Mathematical Logic’, in The Philosophy of Bertrand Russell edited by P. A. Schilpp, The Library of Living Philosophers, Tudor Publishing Company, New York, 1944, 125-153. Texte traduit par J.A. Miller et J.C. Milner avec l’autorisation des éditeurs et de M. K. Gödel, extrait d’un recueil à paraître. ↵
2. L’auteur désire signaler que (1) depuis la première publication de cet article, des progrès ont été faits dans la solution de certains problèmes débattus, et que les formulations présentées pourraient être améliorées en plusieurs endroits, et que (2) le terme de ‘constructiviste’ est employé dans ce texte pour désigner un constructivisme d’un genre strictement antiréaliste. Son sens, par conséquent, n’est pas identique à celui qui a cours dans les débats actuels sur les fondements des mathématiques. Si on le réfère au développement présent de la logique et des mathématiques, il est équivalent à un certain genre de ‘prédicativité’ , et par là il diffère à la fois de ‘admissible par l’intuitionnisme’ , et de ‘constructif’ au sens de l’école de Hilbert. [Note ajoutée en 1964, pour la réédition du texte dans le recueil de Paul Benacerraf et Hilary Putnam, Philosophy of Mathematics, Prentice-Hall, Philosophy Series (New Jersey, Prentice-Hall) p. 211.] ↵
3. Frege a sans aucun doute la priorité, étant donné que sa première publication sur le sujet, qui contient déjà tout l’essentiel, précède de dix ans celle de Peano. ↵
4. Cf. sur ce point l’article de W. V. Quine dans le volume Whitehead de cette série (The Library of Living Philosophers). ↵
5. Le passage cité ci-dessus a été coupé dans les éditions suivantes de l’Introduction. ↵
6. J’emploie le terme ‘signifier’ dans la suite, parce qu’il correspond au mot allemand bedeuten que Frege, le premier à traiter du problème en question, employa à ce propos. ↵
7. Les seules assomptions supplémentaires dont on aurait besoin pour obtenir une démonstration rigoureuse sont les suivantes: 1) que ‘φ(a)’ et la proposition ‘a est l’objet qui a la propriété φ et est identique à a’ veulent dire la même chose, et 2) que toute proposition ‘parle de quelque chose’ , c’est-à-dire peut être mise sous la forme φ(a). De plus, on aurait à utiliser le fait que pour n’importe quels objets a.b. il existe une proposition vraie de la forme φ(a, b), telle que par exemple, a ≠ b ou a = a. b = b. ↵
8. Cf. ‘Sinn und Bedeutung’, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, vol. 100 (1892), p. 35. ↵
9. De la référence (Bedeutung) d’un énoncé, on doit distinguer ce que Frege appelle son sens (Sinn), qui est le corrélat conceptuel du fait objectivement existant (ou ‘le Vrai’ ). On pourrait s’attendre à ce que ce soit dans la théorie de Russell un fait possible (ou plutôt la possibilité d’un fait), qui existerait aussi dans le cas d’une proposition fausse. Mais Russell, comme il le dit lui-même, n’a jamais pu croire que de telles choses ‘étranges et fantomatiques’ (curious [and] shadowy) existaient réellement. Troisièmement, il y a aussi le corrélat psychologique du fait, qui est nommés ‘signification’ , et qui s’avère correspondre à la croyance (belief) dans le dernier livre de Russell. ‘Énoncé’ (sentence) par opposition à ‘proposition’ (proposition) est employé pour dénoter la simple combinaison de symboles. ↵
10. Il n’a rien dit explicitement de la première; mais il semble qu’elle serait valide pour le système logique des Principia, bien que peut-être d’une façon plus ou moins vide. ↵
11. Dans le premier article de Russell sur le sujet: ‘On Some Difficulties in the Theory of Transfinite Numbers and Order Types’, Proc. London Math. Soc., Second series, vol. 4, 1906, p. 29. Si l’on veut examiner des paradoxes comme ‘le menteur’ sous cet angle, on doit considérer que les propositions universelles (et existentielles) mettent en jeu la classe des objets auxquels elles se réfèrent. ↵
12. Une ‘fonction propositionnelle’ (sans la clause ‘en tant qu’entité distincte’ ) peut être entendue comme une proposition dans laquelle un ou plusieurs constituants sont désignés comme arguments. On pourrait penser que la paire formée de la proposition et de l’argument serait alors susceptible de jouer le rôle de la ‘fonction propositionnelle’ en tant qu’entité distincte mais on doit remarquer que cette paire (en tant qu’une seule entité) est à son tour un ensemble ou un concept, et donc n’existe pas nécessairement. ↵
13. On peut venir à bout des paradoxes de la compréhension avec, par exemple, la théorie des types simples, ou la hiérarchie ramifiée, qui ne font intervenir aucune restriction indésirable si on les applique aux concepts seulement et non aux ensembles. ↵
14. Cf. ‘Über eine Widerspruchfreiheitsfrage in der axiomatischen Mengenlehre’, Journal für reine und angewandte Mathematik, Vol. 160, 1929, p. 227. ↵
15. Cf. ‘New Foundations for Mathematical Logic’, Amer. Math. Monthly, Vol. 44, p. 70. ↵
16. En français dans le texte. ↵
17. Cf. Principia Mathematica, vol. I, p. 39. ↵
18. Les quantificateurs sont les deux symboles (∃x) et (x), signifiant respectivement ‘il existe un objet x’ , et ‘pour tous les objets x’ . La totalité des objets x à laquelle ils se réfèrent est appelée leur domaine (range). ↵
19. Cf. Principia Mathematica, vol. I, p. 47, section IV. ↵
20. Par théorie des types simples, j’entends la doctrine qui soutient que les objets de pensée (ou, dans une autre interprétation, les expressions symboliques) sont divisés en types, à savoir: les individus, les propriétés des individus, les relations entre individus, les propriétés de telles relations, etc. (avec une hiérarchie similaire pour les extensions), et que les énoncés de la former ‘a a la propriété φ’ , ‘b entretient la relation R avec c’ , etc. n’ont pas de sens, si a, b, c, R, φ) ne sont pas de types qui s’accordent. Les types mêlés (tels que les classes contenant comme éléments des individus et des classes) et par voie de conséquence les types transfinis (tels que la classe de toutes les classes de types finis) sont exclus. Que la théorie des types simples suffise à éviter également les paradoxes épistémologiques est mis en évidence par une analyse plus poussée de ceux-ci (Cf. l’article de F. P. Ramsey, cité dans la note 21, et A. Tarski, ‘Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen’, Stud. phil., Vol. 1, Lemberg, 1935, p. 399). ↵
21. Ce sont là des définitions d’un objet α par référence à une totalité à laquelle appartient a lui-même (et peut-être aussi des choses qui ne sont définissables qu’en termes de α). Ainsi, par exemple, si on définit une classe a comme l’intersection de toutes les classes satisfaisant une certaine condition φ, pour conclure ensuite que α est aussi un sous-ensemble de classes u telles qu’elles sont définies en termes de α (sous la condition qu’elles satisfassent φ). ↵
22. Voir Rudolf Carnap dans Erkenntnis, vol. 2, p. 103, et Logical Syntax of Language, p. 162, et C. H. Langford, Bulletin American Mathematical Society, vol. 33 (1927), p. 599. ↵
23. On dit qu’un objet a est décrit par une fonction propositionnelle φ(x) si φ(x) est vrai pour x = a, et pour aucun autre objet. ↵
24. Cf. F. P. Ramsey, The Foundations of Mathematics, in Proc. London Math. Soc., Séries 2, vol. 25 (1926), p. 338 (Réédité dans The Foundations of Mathematics, New York and London, 1931, p. 41). ↵
25. J’emploierai par la suites ‘constructivisme’ comme un terme général désignant à la fois ces points de vue et des tendances comme celles auxquelles donne corps la théorie ‘pas-de-classe’ de Russell. ↵
26. On pourrait penser que cette conception des notions est impossible parce que les énoncés dans lesquels on traduit doivent aussi contenir des notions, si bien qu’on entrerait dans une régression infinie. Néanmoins cela ne ferme pas la possibilité de conserver le point de vue ci-dessus pour toutes les notions plus abstraites, comme celles du second type et des types supérieurs, ou, en fait, pour toutes les notions à l’exception des termes primitifs qui pourraient n’être qu’un très petit nombre. ↵
27. C’est-à-dire: qu’il n’y a pas deux propriétés différentes qui appartiennent exactement aux mêmes choses, ce qui, en un sens, est la contrepartie du Principium identitatis indiscemibilium de Leibniz, selon lequel il n’y a pas deux choses différentes qui aient exactement les mêmes propriétés. ↵
28. Cf. Carnap, loc. cit., note 19. ↵
29. Néanmoins le schéma est intéressant parce qu’il montre encore une fois le caractère constructif de notions qui ne perdent pas leur sens lorsqu’elles sont appliquées à des notions d’ordre arbitrairement élevé. ↵
30. Voir Erkenntnis, vol. 3, p. 367. ↵
31. Le système formel correspondant à cette conception comporterait, à la place de l’axiome de réductibilité, la règle de substitution pour les fonctions, décrite par exemple dans Hilbert-Bernays, Grundlagen der Mathematik, vol. 1 (1934), p. 90, appliquée aux variables de n’importe quel type, et accompagnée de certains axiomes de compréhension exigés par le concept de propriété qui, pourtant, seraient plus faibles que celui de Chwistek. On doit remarquer que cette conception n’implique pas nécessairement l’existence de concepts qui ne peuvent être exprimés dans le système, si on l’associe à une solution des paradoxes sur le modèle indiqué p. 503. ↵
32. Cf. mon article dans Monatshefte für Mathematik und Physik, vol. 38, (1931), p. 573, ou R. Carnap, Logical Syntax of Language, § 35. ↵
33. Des idées qui vont dans ce sens sont exposées dans les articles suivants de D. Mirimanoff: ‘Les antinomies de Russell et de Burali-Ford et le problème fondamental de la théorie des ensembles’, l’Enseignement mathématique, vol. 19 (1917), p. 37-52, et ‘Remarques sur la théorie des ensembles et les antinomies cantoriennes’, l’Enseignement mathématique, vol. 19 (1917), p. 209-217 et vol. 21 (1920), p. 29-52. Cf. en particulier vol. 59, p. 212. ↵
34. En français dans le texte ↵
35. ‘Les paradoxes de la logique’. Revue de Métaphysique et de Morale, vol. 14 (1906), p. 627. ↵
36. Dans l’appendice C des Principia, est esquissée une manière de construire ceux-ci par le moyen de certaines relations de similarité entre les propositions atomiques, de telle sorte que celles-ci seraient les seules à rester des objets réels. ↵
37. On doit comprendre ici ‘données’ en un sens relatif c’est-à-dire, dans notre cas, comme la logique sans l’assomption de l’existence des classes et des concepts. ↵
38. Cf. Ramsey, loc. cit. note 21. ↵
39. En français dans le texte. ↵
40. C’est-à-dire des propositions de la forme S(a), R (a, b), etc., où S, R, sont des prédicats primitifs, et a, b, des individus. ↵
41. En français dans le texte ↵
42. Il est bien entendu permis, comme toujours, que les xi soient identiques les uns aux autres, en partie ou totalement. ↵
43. Quant à la question de savoir jusqu’où il est possible d’édifier la théorie des nombres réels en présupposant les entiers, cf. Hermann Weyl, Das Kontinuum, réimpression, 1932. ↵
44. Que la variable a soit destinée à être d’ordre indéterminé est montré par les applications ultérieures de #89. 17, et par la note à #89. 17. L’application principale se trouve à la ligne (2) de la démonstration de #89 24, où on a besoin du lemme examiné pour des α d’ordre arbitrairement élevé. ↵
45. Loc. cit., cf. note 13. ↵
46. Russell formule dans les Principia, vol. 1, p. 95, un principe quelque peu différent, qui a le même résultat. ↵
47. Cette objection ne vaut pas pour l’interprétation symbolique de la théorie des types, dont on a parlé p. 103, parce qu’on n’a pas d’objets, mais seulement des symboles, de type différent. ↵
48. Un système formel de ce modèle est celui de Church (cf. ‘A Set of Postulates for the Foundations of Logic’, Annals of Mathematics, vol. 33 (1932), p. 346, et vol. 34 (1933), p. 839), où, néanmoins, l’idée de base est exprimée par l’assertion quelque peu trompeuse que la loi du tiers exclu est abandonnée. Néanmoins, on a démontré que ce système était inconsistant. Voir note 43. ↵
49. Cf. S.C. Kleene et J. B. Rosser, ‘The Inconsistency of Certain Formal Logics’, Annals of Math., vol. 36 (1935), p. 630. ↵
50. Parce que cela impliquerait l’existence d’une procédure de décision pour toutes les propositions arithmétiques. Cf. A.M. Turing, Proc. Lond. Math. Soc. vol. 42 (1936), p. 230. ↵
51. Cf. également F. P. Ramsey, loc. cit. (note 21) où, néanmoins, on ne peut obtenir l’axiome d’in¬finité, parce qu’on l’interprète comme faisant référence aux individus du monde. ↵
52. On pourrait peut-être distinguer les deux significations du terme analytique, en tautologique et analytique. ↵
53. Cette conception ne contredit pas l’opinion défendue plus haut, selon laquelle la mathématique est fondée sur des axiomes au contenu réel, parce que l’existence même du concept, par exemple de ‘classe’ , constitue déjà un tel axiome; en effet, si on définissait par exemples ‘classe’ et ‘∈’ comme ‘les concepts satisfaisant les axiomes’ , on se trouverait incapable de démontrer leur existence. ‘Concept’ pourrait être défini peut-être en termes des ‘proposition’ (Cf. p. 103 bien que je ne pense pas que ce serait une procédure naturelle); mais il faudra alors assumer certains axiomes sur les propositions que seule légitimera une référence au sens non-défini de ce terme. On doit remarquer que cette conception de l’analytique rend de nouveau possible de réduire peut-être toute proposition mathématique à un cas particulier de a = a, à la condition que la réduction ne soit pas effectuée en vertu de la définition des termes occurrents, mais en vertu de leur sens, ce qui ne peut jamais être complètement exprimé dans un ensemble de règles formelles. ↵
54. Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, herausgegeben von C. J. Gerhardt, vol. 7 (1890) p. 12. Cf. également G. Vacca, ‘La Logica di Leibniz’ (section VII) Riv. di Mat. vol. 8 (1902-06), p. 72, et la préface dans le premier volume de la première série de Leibniz’s Sämmtliche Briefe und Schriften, herausgegeben von der Preussischen Akademie der Wissenchaften (depuis 1923). ↵
55. Leibniz, Philosophische Schriften (ed. Gerhardt), vol. 7, p. 187. ↵
56. Je désire exprimer mes remerciements au professeur Alonzo Church, de l’Université de Princeton, pour m’avoir aidé à trouver, en nombre d’endroits, les expressions anglaises correctes. ↵