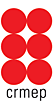Fondements d’une théorie générale des ensembles
[35]§ 1
Telle1 que je l’ai menée jusqu’à maintenant, la présentation de mes recherches touchant la théorie des ensembles2 en est venue à un point où je ne peux la poursuivre qu’en étendant au-delà de ses limites antérieures le concept de nombre entier réel. En vérité cette extension s’oriente dans une direction où, à ma connaissance, nul ne l’avait jusqu’à présent cherchée.
Si grande est la dépendance où je me vois placé à l’égard de cet élargissement du concept de nombre qu’il me serait difficilement possible sans cela, de continuer à progresser librement dans la théorie des systèmes; puisse-t-on dans cette circonstance trouver de quoi me justifier ou, s’il en est besoin, m’excuser d’introduire dans mes réflexions des notions apparemment insolites. C’est qu’il s’agit d’étendre ou de continuer par-delà l’infini la série des nombres entiers réels; pour hardie que cette tentative puisse paraître, je puis néanmoins exprimer non seulement l’espoir, mais bien la ferme conviction qu’avec le temps, cette extension ne pourra plus être regardée que comme parfaitement simple, appropriée et naturelle. Ce disant, je ne me dissimule en aucune façon que par cette entreprise, j’entre en opposition, dans une certaine mesure, avec des conceptions largement répandues concernant l’infini mathématique et avec des points de vue que l’on a fréquemment adoptés sur l’essence de la grandeur numérique.
En ce qui concerne l’infini mathématique, dans la mesure où celui-ci a trouvé jusqu’à présent un emploi justifié dans la science et a contribué utilement à ses progrès, il me paraît avoir au premier chef la signification d’une grandeur variable, croissant au-delà de toute limite ou bien décroissant autant que l’on voudra, mais demeurant toujours finie. Je nomme cet infini, infini improprement dit.
[36]A côté de celui-ci, cependant, s’est constitué ces derniers temps, soit dans la géométrie, soit particulièrement dans la théorie des fonctions, un nouveau type de concepts de l’infinité, tout aussi légitime; par exemple, d’après ces notions nouvelles, dans l’examen d’une fonction analytique d’une grandeur variable complexe, l’usage s’est imposé généralement de poser dans le plan qui représente la variable complexe, un point unique, situé dans l’infini, (c’est-à-dire infiniment éloigné, mais déterminé), et de vérifier la manière dont se comporte la fonction au voisinage de ce point, comme on le fait de tout autre point; on voit alors qu’au voisinage du point infiniment éloigné, la fonction se comporte exactement de la même façon que s’il s’agissait de tout autre point situé dans le fini; on déduit de là qu’il est parfaitement légitime de se représenter l’infini dans ce cas comme transporté sur un point tout à fait déterminé.
Lorsque l’infini se présente ainsi sous une forme déterminée, je le nomme infini proprement dit.
Pour faire comprendre ce qui va suivre, nous distinguerons bien ces deux aspects sous lesquels s’est présenté l’infini mathématique, qui, sous les deux formes, a amené les plus grands progrès dans la géométrie, l’analyse et la physique mathématique.
Sous la première forme, en tant qu’infini improprement dit, il se propose comme un fini variable; sous l’autre forme, je le nomme alors infini proprement dit, il se présente comme un infini parfaitement déterminé. N’ont absolument rien de commun avec la première de ces deux formes (l’infini improprement dit) les nombres entiers réels infinis que j’entends définir dans ce qui va suivre et auxquels j’ai été conduit, il y a déjà de longues années, sans avoir été clairement conscient que je détenais là des nombres concrets à sens réel; au contraire, ils ont le même caractère de détermination que nous rencontrons dans le point infiniment éloigné de la théorie des fonctions analytiques; ils appartiennent dès lors aux formes et spécifications de l’infini proprement dit.
Cependant le point reste isolé dans l’infini du plan de nombres complexes, en face de tous les points qui sont dans le fini: au contraire, nous n’obtenons pas uniquement un seul nombre entier infini, mais une suite infinie de tels nombres, bien distincts les uns des autres et soutenant soit entre eux soit avec les nombres entiers finis des relations arithmétiques. Ces relations ne sont pas de celles que l’on peut ramener fondamentalement à des relations entre nombres finis; ce dernier phénomène a lieu fréquemment, il est vrai, mais seulement pour les degrés et les formes diverses de l’infini improprement dit, par exemple les fonctions d’une variable x qui deviennent infiniment petites ou infiniment grandes, dans le cas où, en tendant à l’infini, elles ont des numéros d’ordre finis déterminés. De telles relations peuvent de fait être considérées simplement comme des rapports dissimulés du fini ou comme immédiatement réductibles à ces derniers; les lois relatives aux nombres entiers infinis proprement dits que nous avons à définir sont au contraire fondamentalement différentes des dépendances régnant dans le fini, ce qui n’exclut pas cependant que les nombres réels finis ne puissent recevoir à leur tour certaines déterminations nouvelles à l’aide des nombres déterminés infinis.
Les deux principes d’engendrement à l’aide desquels, comme on le montrera, se trouvent définis les nouveaux nombres déterminés infinis, sont de telle nature que par leur action combinée, toute limite (Schranke) dans la formation abstraite de nombres entiers réels peut être dépassée; heureusement, comme nous le verrons, un troisième principe s’oppose à ceux-ci, que je nomme principe d’arrêt ou de [37] limitation, grâce auquel certaines limites (Schranke) sont successivement imposées au procès de formation qui ne connaît absolument aucune fin; nous obtenons de la sorte dans la suite absolument infinie des nombres entiers réels, des divisions naturelles, que je nomme classes de nombres.
La première classe de nombre (I) est le système des nombres entiers 1, 2, 3, ..., vient ensuite la seconde classe (II), composée de certains nombres entiers infinis se suivant dans une succession déterminée; une fois la seconde classe définie, et alors seulement, l’on en vient à la troisième, puis à la quatrième etc.
L’introduction des nouveaux nombres entiers me semble de la plus grande importance, surtout pour le développement et le perfectionnement du concept de puissance que j’ai introduit clans mes travaux (Journal de Crelle, vol. 77, p. 257; vol. 84, p. 242) et que j’ai plusieurs fois employé dans les premières sections de cet essai. D’après ce concept, à tout système bien défini convient une puissance déterminée, et la même puissance est attribuée à deux systèmes quand on peut établir entre eux, d’élément à élément, une correspondance biunivoque.
Dans le cas des systèmes finis, la puissance coïncide avec le numéral des éléments, parce que de tels systèmes ont, comme on sait, le même numéral d’éléments pour tout arrangement.
Dans le cas des systèmes infinis, au contraire, il n’était nullement question jusqu’à présent, ni dans mes travaux, ni ailleurs, d’un numéral précisément déterminé de leurs éléments, mais on pouvait leur attribuer à eux aussi une puissance déterminée, totalement indépendante de leur arrangement.
La plus petite puissance revenant à des systèmes infinis devait nécessairement, comme il était aisé de le justifier, être attribuée aux systèmes pouvant être mis en correspondance biunivoque avec la première classe de nombres, et dès lors ayant même puissance qu’elle. Manquait en revanche jusqu’à présent une définition également simple et naturelle des puissances plus élevées.
Il se révèle maintenant que les classes de nombres que nous avons mentionnées plus haut, rassemblant les nombres entiers réels déterminés infinis, représentent naturellement, sous une forme homogène, les puissances croissant en suite régulière des systèmes bien définis. Je montre de la façon la plus déterminée que la puissance de la deuxième classe (II) est non seulement distincte de celle de la première, mais qu’elle est de plus en fait la puissance immédiatement supérieure; nous pouvons ainsi la nommer deuxième puissance ou puissance de deuxième classe. De même, la troisième classe fournit la définition de la troisième puissance ou puissance de troisième classe.
§ 2
Une autre acquisition importante dont il convient d’attribuer le bénéfice aux nouveaux nombres consiste à mes yeux dans un concept nouveau, qui ne s’était pas encore présenté jusqu’ici: le concept de numéral des éléments d’un ensemble infini bien ordonné. Étant donné que ce concept est toujours exprimé par un nombre entièrement déterminé de notre domaine de nombres élargi (pourvu seulement que soit déterminé l’ordre des éléments du système, tel que nous le définirons à l’instant); étant donné d’autre part que le concept de numéral reçoit dans notre intuition interne une représentation objective immédiate, cette solidarité entre numéral et nombre démontre pour ce dernier, même dans le cas où il est déterminé-infini, la réalité sur laquelle j’ai insisté.
[38] Par un système bien ordonné, il faut entendre tout système bien défini dont les éléments sont coordonnés par une succession donnée de manière déterminée, d’après laquelle il existe un premier élément du système et d’après laquelle non seulement tout élément particulier (pourvu qu’il ne soit pas le dernier dans la succession) se trouve suivi d’un élément déterminé, mais encore à tout système arbitraire fini ou infini, appartient un élément déterminé qui dans la succession est l’élément qui les suit tous immédiatement (pourvu qu’il existe bien un élément qui les suive tous dans la succession).3 Deux systèmes bien ordonnés sont dits avoir même numéral (par rapport aux successions auxquelles ils ont donné lieu), lorsque leur mise en correspondance biunivoque est possible, d’une manière telle que, E et F étant deux éléments quelconques de l’un, E1 et F1, les éléments correspondants de l’autre, la position de E et F dans la succession du premier système s’accorde toujours avec la position de E1 et F1 dans la succession du deuxième système, en sorte que, si E précède F dans la succession du premier système, alors E1 précède aussi F1, dans la succession du second système. Lorsqu’elle est possible, cette mise en correspondance, est, comme on peut le voir aisément, toujours parfaitement déterminée, et puisque dans la série élargie des nombres il se trouve toujours un nombre α et un seul, tel que les nombres qui le précèdent (à partir de 1) aient le même numéral dans leur succession naturelle, l’on se trouve contraint d’égaler directement à α le numéral de ces deux systèmes ‘bien ordonnés’ , lorsque a est un nombre infiniment grand, et à α - 1, prédécesseur immédiat de α, quand α est un nombre entier fini.4
La différence essentielle entre les systèmes finis et infinis se révèle dès lors en ceci: un système fini présente le même numéral d’éléments dans toute succession où l’on peut en ranger les éléments; au contraire à un système composé d’éléments infiniment nombreux, reviendront en général des numéraux différents suivant la succession où l’on en rangera les éléments. La puissance d’un système, comme nous l’avons vu, est un attribut indépendant de son arrangement, mais le numéral de ce système se révèle un facteur dépendant de manière générale d’une succession donnée de ses éléments, dès que l’on a affaire à des systèmes infinis. Une certaine solidarité n’en subsiste pas moins, même pour les systèmes infinis, entre la puissance du système et le numéral de ses éléments, déterminé par une succession donnée.
[39]Prenons d’abord un système ayant la puissance de la première classe et rangeons-en les éléments en une succession déterminée quelconque, de façon à obtenir un système ‘bien ordonné’ : son numéral est toujours un nombre déterminé de la deuxième classe et ne peut jamais être déterminé par un nombre d’une autre classe que la deuxième. D’autre part tout système de la première puissance peut être rangé en un ordre de succession tel que son numéral, par rapport à cette succession, soit égal à un nombre de la deuxième classe, arbitrairement désigné d’avance. Nous pouvons ainsi formuler ces propositions de la manière suivante: tout système de la puissance de première classe est dénombrable par des nombres de la deuxième classe et par eux seulement; de fait les éléments du système peuvent toujours être rangés en une succession telle qu’il soit dénombré par un nombre de la deuxième classe, arbitrairement désigné d’avance, ce nombre exprimant le numéral des éléments du système par rapport à cette succession.
Des lois analogues s’appliquent aux systèmes de puissance plus élevée. Ainsi tout système bien défini de la puissance de deuxième classe est dénombrable par des nombres de la troisième classe et par eux seulement; de fait les éléments de système peuvent toujours être rangés en une succession telle qu’il soit dénombré5 dans cette succession par un nombre de la troisième classe, arbitrairement désigné d’avance, ce nombre exprimant le numéral des éléments du système par rapport à cette succession.
§ 3 omis
§ 4
La série élargie des nombres entiers peut, si nos buts l’exigent, être directement complétée en un système continu par l’adjonction à tout nombre entier α de tous les nombres réels x supérieurs à zéro et inférieurs à 1.
Peut-être, en liaison avec ce point, posera-t-on la question suivante: étant donné que de cette manière, l’on obtient pour le domaine des nombres réels une extension déterminée vers l’infiniment grand, ne pourrait-on pas définir avec le même succès des nombres déterminés infiniment petits, ou, ce qui reviendrait au même, des nombres finis qui ne se confondraient pas avec les nombres rationnels ou irrationnels, (ceux-ci se posant comme limites de séries de nombres rationnels), mais pourraient s’introduire parmi les nombres réels à d’hypothétiques places intermédiaires, tout de même que les nombres irrationnels s’insèrent dans la chaîne des nombres rationnels, ou les nombres transcendants dans l’appareil des nombres algébriques?
La question de l’établissement de telles interpolations, à laquelle certains auteurs ont donné beaucoup de peine, ne peut, à mon avis et comme je le montrerai, recevoir de réponse claire que grâce à nos nouveaux nombres, et plus précisément sur la base du concept général de numéral d’ensembles bien ordonnés; en revanche les tentatives antérieures, à ce qu’il me semble, pour une part reposent [40] sur une confusion erronée entre l’infini improprement dit et l’infini proprement dit, et pour une part ont été menées sur une base tout à fait incertaine et chancelante.
L’infini improprement dit a souvent été nommé ‘mauvais infini’ par les philosophes modernes, ce qui est fort injuste à mon avis, puisque celui-ci s’est affirmé un instrument excellent et très utile dans la mathématique et les sciences de la nature. Les grandeurs infiniment petites, à ma connaissance, n’ont été utilement développées, jusqu’à présent, que sous la forme de l’infini improprement dit; c’est sous cette forme qu’elles sont susceptibles de toutes les diversités, modifications et relations qui sont requises dans l’analyse infinitésimale et la théorie des fonctions, et si elles reçoivent une expression propre, c’est afin de fonder dans ce domaine la pleine richesse des vérités analytiques. Au contraire, toutes les tentatives visant à transformer par un coup de force ces infiniment petits en infiniment petits proprement dit, devraient être enfin abandonnées et leur vanité reconnue. A supposer que des grandeurs infiniment petites proprement dites existent en quelque façon, c’est-à-dire puissent être définies, il est certain qu’elles sont sans rapport immédiat avec les habituelles grandeurs devenant infiniment petites.
S’opposant aux tentatives mentionnées ci-dessus concernant l’infiniment petit et à la confusion entre les deux aspects de l’infini, un point de vue se trouve fréquemment soutenu, concernant l’essence et la signification des grandeurs numériques, suivant lequel on n’accorde d’existence effective qu’aux nombres entiers réels finis de notre classe I.
Tout au plus accorde-t-on une certaine réalité aux nombres rationnels qui en procèdent immédiatement. Mais en ce qui concerne les irrationnels, il leur reviendrait dans la mathématique une signification purement formelle, pour autant que, se réduisant dans une certaine mesure à de simples marques de compte, ils servent à fixer les propriétés de groupes de nombres entiers et à les décrire d’une manière simple et homogène. Le matériel propre de l’analyse, suivant ce point de vue, sera exclusivement formé des nombres entiers réels finis et toutes les vérités de l’arithmétique et de l’analyse, qu’elles aient été mises au jour ou résistent encore à la découverte, seraient à concevoir comme des relations entre nombres entiers finis; l’analyse infinitésimale et, avec elle, la théorie des fonctions ne seront tenues pour légitimes que dans la mesure où leurs théorèmes pourront s’interpréter de manière démontrable comme des lois valant parmi les nombres entiers finis. A cette conception de la mathématique pure, encore que je ne puisse me trouver en accord avec elle, sont incontestablement attachés certains mérites que je voudrais ici souligner; son importance se trouve encore confirmée par le fait que parmi ses défenseurs, l’on trouve une partie des mathématiciens les plus éminents de notre temps.
Si seuls les nombres entiers finis ont une réalité, comme on le suppose ici, et si tous les autres ne sont que des formes de relation, il est alors possible d’exiger que les démonstrations des théorèmes de l’analyse soient mises à l’épreuve du point de vue de leur ‘contenu arithmétique’ , et que l’on comble conformément aux principes fondamentaux de l’arithmétique, toute lacune qui s’y révélerait; la possibilité de mener à bien cette opération est regardée comme la véritable pierre de touche de l’authenticité et de la rigueur accomplie des démonstrations. Il est indéniable que par cette méthode, il est possible de parfaire la fondation de nombreux théorèmes et d’effectuer par surcroît d’autres améliorations méthodologiques dans diverses parties de l’analyse; l’observation des principes fondamentaux [41] qui dérivent de cette conception est de plus considérée comme une garantie contre toute espèce d’irrégularité ou de faute.
Un principe se trouve ainsi posé, assez ordinaire et trivial, mais précis et l’on recommande à tous de s’aligner sur lui: il est censé servir à maintenir l’envol de la passion spéculative et conceptuelle des mathématiques dans ses véritables limites, où elle ne court pas le danger de sombrer dans le gouffre du ‘transcendantal’ , où, comme on le dit pour éveiller une crainte et une terreur salutaires, ‘tout est possible’ . Sans prendre parti là-dessus, l’on peut se demander si ce n’est pas précisément le souci de l’utilité qui a déterminé les premiers tenants de cette opinion à la recommander comme un principe régulateur efficace aux aspirations du talent, si aisément mises en danger par l’exubérance et la démesure, afin de les protéger contre toute erreur, et cela bien que l’on ne puisse y trouver un principe fécond. Car quant à supposer qu’ils soient eux-mêmes partis de ces principes fondamentaux pour mettre au jour de nouvelles vérités, cela me paraît exclu, pour la simple raison qu’à prendre ces maximes à la rigueur, je suis obligé de les considérer comme erronées, malgré les nombreuses qualités que je dois d’autre part leur concéder; nous ne leur devons aucun véritable progrès, et si on les avait effectivement prises pour règles, la science se serait trouvée retardée ou confinée dans les limites les plus étroites. Heureusement la situation n’est pas si grave en fait et la recommandation et l’observation de ces règles, qui sont utiles dans certains cas et sous certaines conditions, n’ont jamais été prises tellement à la lettre; il est remarquable de plus que jusqu’à maintenant, nul ne s’est présenté, à ma connaissance, pour entreprendre de les formuler de façon plus complète et plus satisfaisante que je ne l’ai tenté ici.
Si nous examinons les données historiques, nous voyons que de semblables vues ont été fréquemment soutenues et se trouvent déjà chez Aristote. Il est notoire que durant tout le Moyen Age, chez tous les scolastiques, l’énoncé ‘infinitum actu non datur’ est présenté comme une proposition irréfutable, héritée d’Aristote. Mais si l’on considère les raisons qu’avance Aristote6 contre l’existence [42] réelle de l’infini (cf. e.g. sa Métaphysique, XI, 10), elles peuvent se ramener pour l’essentiel à une présupposition impliquant une pétition de principe: il n’y a de nombres que finis, ce qu’il déduit du fait qu’il ne connaît de dénombrement que pour les systèmes finis. Je crois cependant avoir démontré précédemment - et on le verra de façon plus claire encore dans la suite de ce travail - que l’on peut pratiquer des dénombrements déterminés pour tous les systèmes, tant finis qu’infinis, à condition que l’on impose aux systèmes une loi déterminée, qui en fait des systèmes bien ordonnés. Que sans une telle succession, réglée par une loi, des éléments d’un système, aucun dénombrement ne puisse en être pratiqué, cela tient à la nature du concept de dénombrement; il en va de même pour les systèmes finis: un dénombrement ne peut en être accompli que si les éléments dénombrés se suivent en une séquence déterminée; mais il apparaît ici, comme une propriété particulière des systèmes finis, que le résultat du dénombrement - le numéral - est indépendant de la mise en ordre effectuée en l’occurrence, alors que pour les systèmes infinis, ainsi que nous l’avons vu, une telle indépendance ne se présente pas en général; au contraire le numéral d’un système infini est un nombre entier infini co-déterminé par la loi du dénombrement; c’est précisément là et là seulement que réside la différence essentielle entre le fini et l’infini, différence fondée en nature, qui de ce fait ne devrait jamais être effacée; en aucune façon cependant l’on ne pourra, au nom de cette différence, nier l’existence de l’infini et maintenir celle du fini; si l’on fait tomber l’une, l’on doit nécessairement se débarrasser aussi de l’autre; mais par cette méthode, où irions-nous?
Un autre argument employé par Aristote contre l’actualité de l’infini, consiste à affirmer que, si l’infini existait, le fini se trouverait absorbé et détruit par celui-ci parce que, prétend-il, le nombre fini se trouve anéanti par un nombre infini; en fait, comme on le verra clairement dans la suite, les choses se présentent ainsi: pourvu que l’on pense un nombre infini comme déterminé et achevé, un nombre fini peut fort bien lui être adjoint et être réuni avec lui, sans que par là soit effectuée une absorption de ce dernier (c’est plutôt le nombre infini qui se trouve modifié par une telle adjonction d’un nombre fini); seul le processus inverse, l’adjonction d’un nombre infini à un nombre fini (posé le premier), effectue l’absorption de celui-ci, sans qu’apparaisse aucune modification de celui-là. - C’est là, concernant le fini et l’infini, l’état de choses véritable, qui a été entièrement méconnu par Aristote: il devrait donner une nouvelle impulsion non seulement à l’analyse, mais aussi à d’autres sciences, particulièrement les sciences de la nature.
Ne pas simplement considérer l’infiniment grand sous la forme de ce qui croît sans limites et sous la forme qui en dépend étroitement des séries infinies convergentes, introduites pour la première fois au XVIIe siècle, mais également le fixer de façon mathématique par des nombres, cette pensée s’est imposée à moi logiquement [43], presque contre ma volonté (elle était en effet contraire à des traditions qui m’étaient devenues chères) au cours d’efforts et de tentatives scientifiques s étendant sur plusieurs années; de ce fait même, je ne crois pas qu’on puisse y opposer de raisons auxquelles je n’aie de quoi faire face.
§ 5
Par ces traditions dont j’ai parlé à l’instant, je n’entendais pas simplement au sens étroit mon expérience personnelle, mais j’y incluais les fondateurs de la philosophie et des sciences modernes. Pour trancher le débat, je citerai seulement quelques-unes des sources les plus importantes:
Locke, Essay on human understanding, II, chap. xvi et xvii.
Descartes, Lettres et éclaircissements aux Méditations; Principia, I, 26. Spinoza, ‘Lettre XXIX’ Pensées métaphysiques, I et II.
Leibniz, éd. Erdmann, p. 148, 244, 436, 744; éd. Pertzsche, II, 1, p. 209; III, 4, p. 218; III, 5, p. 307, 322, 389; III, 7, p. 273.7
On ne pourrait, même aujourd’hui, formuler contre l’introduction des nombres entiers infinis des arguments plus solides que ceux que l’on trouve là rassemblés; on devra les examiner en conséquence, et les comparer à ceux que j’avance en faveur de ces nombres. Je réserve pour une autre occasion un traitement exhaustif et détaillé de ces textes et particulièrement de la lettre de Spinoza à Meyer, si importante et si riche - et me limite pour le moment à ce qui suit.
Si différentes que soient les doctrines de ces auteurs, leurs textes cependant, dans le jugement qu’ils portent sur le fini et l’infini, s’accordent en ceci que la finité est censée faire partie du concept de nombre, et que d’autre part, le véritable infini ou absolu, qui est en Dieu, ne souffre aucune espèce de détermination. En ce qui concerne ce dernier point, mon accord avec eux est complet, et il ne saurait en être autrement, car le principe “omnis determinatio est negatio” me paraît ne pas pouvoir être mis en question; pour le premier point au contraire, comme je l’ai déjà dit en discutant les arguments d’Aristote contre l’infini en acte, j’y aperçois une pétition de principe, qui permet d’expliquer bien des contradictions que l’on rencontre chez tous ces auteurs et particulièrement Spinoza et Leibniz. L’assomption qu’en dehors de l’absolu, de ce qui ne peut être atteint par aucune détermination, et du fini, il ne devrait pas exister de modifications qui soient déterminables par des nombres, encore que non-finies, et soient par conséquent ce que j’appelle infini proprement dit - cette assomption ne me paraît justifiée par rien et à mes yeux se trouve même contredire certaines propositions avancées par ces deux derniers philosophes. Ce que j’affirme et crois avoir démontré par le présent travail ainsi que par mes tentatives antérieures, c’est qu’après le fini, il existe un transfinitum (que l’on pourrait aussi nommer suprafinitum), c’est-à-dire une échelle illimitée de modes déterminés qui par nature ne sont pas finis, mais infinis, et qui cependant peuvent être précisés, tout comme le fini, par des nombres déterminés, bien définis et distinguables. Ma conviction est dès lors que le domaine des grandeurs définissables n’est pas clos avec des grandeurs finies et que les limites de notre connaissance peuvent être étendues en conséquence, sans qu’il soit nécessaire pour autant de faire violence à notre nature. A la place du principe [44] aristotélicien et scolastique que j’ai discuté au paragraphe 4, je mets dès lors celui-ci: Omnia seu finita seu infinita definita sunt et excepto Deo ab intellectu determinari possunt.8
Bien souvent, l’on met en avant la finité de l’entendement humain pour expliquer que seuls des nombres finis soient pensables; dans cette affirmation cependant, je décèle à nouveau le cercle vicieux que j’ai mentionné. C’est que par ‘finité de l’entendement’ , l’on veut dire implicitement que son pouvoir, touchant la formation des nombres, se limite aux nombres finis. Mais s’il se révèle que l’entendement peut également définir et distinguer entre eux, des nombres qui soient infinis au sens déterminé, c’est-à-dire transfinis, il faut alors ou bien donner aux mots ‘entendement fini’ une signification plus large, et l’on n’en peut plus tirer la conclusion qui précède, ou bien il faut concéder à l’entendement humain aussi, d’un certain point de vue, le prédicat ‘infini’ , ce qui, à mes yeux, est la seule solution correcte. Les mots d’ ‘entendement fini’ que l’on rencontre si fréquemment, ne sont, je crois, nullement appropriés: si bornée que soit en fait la nature humaine, il y a cependant en elle une très grande part d’infini, et je vais jusqu’à soutenir que si elle n’était pas elle-même infinie sous bien des rapports, on ne saurait expliquer la conviction et la certitude assurées où nous nous savons tous unis, touchant l’être de l’absolu. En particulier, je tiens que l’entendement humain est doué d’une aptitude illimitée à former par progression des classes de nombres entiers, qui soutiennent une relation déterminée avec les modes infinis et en constituent les puissances de degré croissant.
Quant aux systèmes, extérieurement différents sans doute, mais intérieurement tout à fait parents, des deux penseurs cités en dernier lieu, la méthode que j’ai adoptée en peut, je crois, approcher de leur solution les difficultés principales, ou même, pour certaines d’entre elles, dès à présent les résoudre et les expliquer de manière satisfaisante. Ces difficultés sont ce qui a donné ultérieurement son départ au criticisme, qui, malgré tous ses mérites, ne me paraît pas remplacer de manière suffisante les doctrines de Spinoza et de Leibniz dont il a entravé le développement. Car à côté ou à la place de l’explication mécanique de la nature, qui à l’intérieur de sa sphère peut disposer de tous les appuis et avantages de l’analyse mathématique, mais dont l’unilatéralité et l’insuffisance ont été mises en lumière par Kant de manière si frappante, il n’est pas apparu jusqu’à présent, fût-ce même un commencement d’explication organique qui surpasse la précédente ou soit douée de la même rigueur mathématique; on ne peut, je crois, préparer la voie pour cette nouvelle explication qu’en reprenant et en poursuivant les travaux et les aspirations de l’autre.
Un point particulièrement difficile dans le système de Spinoza est le rapport des modes finis aux infinis; comment et sous quelles conditions le fini peut s’affirmer clans son autonomie en face de l’infini, ou l’infini en face de l’infini de degré plus élevé, c’est ce qui demeure chez lui sans explication. L’exemple que j’ai déjà effleuré au paragraphe 4 semble désigner dans son symbolisme aisé [45] la voie par où l’on peut se rapprocher peut-être d’une solution de cette question. Soit ω le premier nombre de la deuxième classe, on a 1 + ω = ω; au contraire ω + 1 = (ω + 1), où (ω + 1) est un nombre parfaitement distinct d’ω. Tout dépend donc, comme on l’aperçoit clairement ici, de la position du fini par rapport à l’infini; si le fini précède, il passe dans l’infini et y disparaît; s’il cède le pas cependant et prend place après l’infini, il subsiste et se combine avec celui-ci en un infini nouveau, parce que modifié.
§ 6 omis
§ 7
J’ai cité au paragraphe 5 de nombreux passages des oeuvres de Leibniz, où celui-ci se prononce contre les nombres infinis, y déclarant entre autres: “Il n’y a point de nombre infini ni de ligne ou autre quantité infinie, si on les prend pour des Touts véritables”, “l’infini véritable n’est pas une modification, c’est l’absolu; au contraire dès qu’on modifie on se borne ou forme un fini’ (je suis d’accord avec lui sur la première proposition de ce texte, mais non sur la deuxième). Malgré cela, je suis d’autre part en mesure d’indiquer des déclarations de ce même penseur où, se contredisant lui-même jusqu’à un certain point, il se prononce de la façon la moins équivoque en faveur de l’infini proprement dit (distingué de l’absolu)”. Il déclare ainsi (Erdmann, p. 118: “Je suis tellement pour l’infini actuel, qu’au lieu d’admettre que la nature l’abhorre, comme l’on dit vulgairement, je tiens qu’elle l’affecte partout, pour mieux marquer les perfections de son Auteur. Ainsi je crois qu’il n’y a aucune partie de la matière qui ne soit, je ne dis pas divisible, mais actuellement divisée; et par conséquent la moindre particelle doit être considérée comme un monde plein d’une infinité de créatures différentes.”
Tel cependant qu’il s’est présenté à nous par exemple dans les systèmes bien définis de points ou dans la constitution des corps en atomes ponctuels (je n’entends pas par là les atomes chimico-physiques - ceux de Démocrite -, je ne puis en effet leur reconnaître d’existence ni dans le concept ni en réalité, malgré toutes les découvertes utiles que, jusqu’à un certain point, cette fiction a permises), l’infini proprement dit a trouvé son défenseur le plus décidé dans un philosophe et mathématicien fort subtil de notre siècle, Bernard Bolzano; celui-ci a développé son point de vue sur cette question dans son ouvrage excellent et substantiel: les Paradoxes de l’Infini, Leipzig, 1851. Le but en est de démontrer que les contradictions recherchées dans l’infini par les sceptiques et péripatéticiens de tous les temps n’existent pas dès que l’on prend la peine (ce qui sans doute n’est pas toujours aisé) d’employer les concepts de l’infinité avec sérieux et conformément à leur contenu véritable. Dans cet ouvrage, l’on trouve aussi une discussion très pertinente à bien des égards de l’infini mathématique improprement dit, tel qu’il se présente dans la forme des différentielles de premier ordre et d’ordre plus élevé, dans les sommes de séries infinies ou dans les autres phénomènes de limite. Cet infini - nommé par certains scolastiques ‘infini syncatégorématique’ - est un simple concept de relation, destiné à offrir un soutien à notre pensée, qui implique la variabilité dans sa définition et dont on ne peut jamais prédiquer au sens propre un ‘datur’ .
[46]Il est très remarquable que concernant ce type d’infini, il ne règne aucune différence essentielle d’opinion même parmi les philosophes modernes, si je puis en excepter certaines écoles modernes de positivistes, réalistes9 ou matérialistes qui croient tenir le plus haut des concepts dans cet infini syncatégorématique, dont ils doivent assurer eux-mêmes qu’il n’a pas d’être proprement dit.
Pourtant le véritable état de choses se trouve pour l’essentiel déjà décrit en plusieurs endroits chez Leibniz; car c’est à cet infini improprement dit que se rapporte par exemple le passage suivant (Erdmann, p. 436): “Ego philosophice loquendo non magis statuo magnitudines infinite parvas quam infinite magnas, seu non magis infinitesimas quam infinituplas. Utrasque enim per modum loquendi compendiosum pro mentis fictionibus habeo, ad calculum aptis, quales etiam sunt radices imaginariae in Algebra. Interim demonstravi, magnum has expressiones usum habere ad compendium cogitandi adeolue ad inventionem; et in errorem ducere non posse, cum pro infinite parvo substituere sufficiat tam parvum quam quis volet, ut error sit minor dato, unde consequitur errorem dari non posse.”
Bolzano est peut-être le seul auteur chez qui les nombres proprement infinis obtiennent quelque légitimité; du moins en est-il plusieurs fois question; cependant je ne m accorde pas du tout avec lui sur la façon dont il en parle, sans pouvoir en construire de définition correcte et je regarde par exemple les paragraphes 29 à 33 de son livre comme incertains et erronés. Il manque à cet auteur d’avoir effectivement formé un concept général des nombres infinis déterminés; lui font aussi défaut le concept général de puissance et le concept spécifique de numéral. Tous deux apparaissent sans doute en germe chez lui dans des passages isolés, [47] comme des cas particuliers, mais il ne parvient pas à une clarté et une précision entières, me semble-t-il, et par là s’expliquent de nombreuses inconséquences et même plusieurs erreurs dans cet ouvrage de haute valeur.
Sans les deux concepts que j’ai mentionnés, je suis convaincu qu’on ne peut faire progresser la théorie des ensembles, et cela vaut aussi, je crois, pour les domaines qui en dépendent ou sont avec elle en très étroite connexion, telles par exemple la moderne théorie des fonctions, d’une part, la logique et la théorie de la connaissance, de l’autre. A concevoir l’infini comme je l’ai fait ici et dans mes tentatives antérieures, j’éprouve un véritable plaisir (et je m’y abandonne avec reconnaissance) en voyant que le concept de nombre entier, qui, dans le fini, recouvre seulement le numéral, se divise pour ainsi dire lorsque nous montons vers l’infini, en deux concepts: la puissance, indépendante de l’ordre conféré à un système, et le numéral, nécessairement lié à un ordre imposé à l’ensemble d’après une loi, qui fait de ce dernier un système bien ordonné. Et si je redescends de l’infini vers le fini, je vois avec une clarté et une beauté égales les deux concepts ne faire à nouveau qu’un et converger dans le concept de nombre entier fini.
§ 8
Nous pouvons prendre la réalité ou existence des nombres entiers, tant finie qu’infinis, en deux sens, qui, à les prendre exactement, sont deux aspects sous lesquels on peut considérer la réalité de n’importe quel concept ou notion. Nous pouvons pour attribuer une réalité aux nombres entiers, retenir le fait que sur la base de définitions, ils occupent dans notre entendement une place tout à fait déterminée, se distinguent parfaitement de toutes les autres parties constitutives de notre pensée, entrent avec elles en des relations déterminées et ainsi modifient la substance de notre esprit d’une façon déterminée; qu’il me soit permis de nommer ce type de réalité de nos nombres, leur réalité intrasubjective ou immanente.10 Mais l’on peut aussi, pour attribuer une réalité à ces nombres, retenir le fait qu’ils doivent être considérés comme l’expression ou la reproduction de processus et de relations existant clans le monde extérieur opposé à l’intellect, et que de plus ifs diverses classes de nombres I, II, III etc., représentent des puissances qui existent en fait dans la nature physique et spirituelle. J’appelle ce deuxième type de réalité, la réalité transsubjective ou transcendante des nombres entiers.
Le fondement de mes réflexions étant entièrement réaliste, mais non pas moins idéaliste, il ne fait pour moi aucun doute que ces deux types de réalité se trouvent toujours conjoints, en ce sens qu’un concept à caractériser comme existant sous le premier rapport, détient toujours aussi sous certains aspects, qui peuvent même être infiniment nombreux, une réalité transcendante11 dont l’établissement, il [48] est vrai, est l’une des tâches les plus ardues et les plus difficiles de la métaphysique; il faut bien souvent le remettre à des temps où le développement naturel d’une autre science dévoile la signification transcendante du concept en question.
Cette solidarité entre les deux réalités a son fondement propre dans l’unité du tout dont nous faisons partie nous-mêmes. Si je me réfère ici à cette solidarité, c’est en vue d’en tirer une conséquence qui me paraît très importante pour la mathématique, à savoir que cette dernière doit prendre en considération pour constituer son matériel notionnel uniquement et seulement la réalité immanente de ses concepts, et n’est par conséquent aucunement obligée de les éprouver du point de vue de leur réalité transcendante. En raison de cette position éminente, qui la distingue de toutes les autres sciences et peut expliquer la manière relativement aisée et sans contrainte dont on peut la pratiquer, elle mérite tout particulièrement le nom de mathématique libre; et si je pouvais choisir, je donnerais la préférence à cette désignation sur celle devenue usuelle de mathématique ‘pure’ .
La mathématique est pleinement libre clans son développement, et ne connaît qu’une seule obligation (et sur un point qui va de soi): ses concepts doivent être non contradictoires en eux-mêmes et soutenir d’autre part avec les concepts formés antérieurement, déjà présents et assurés, des relations fixes, réglées par des définitions.12 En particulier, pour pouvoir introduire de nouveaux nombres, elle est seulement requise d’en donner des définitions leur conférant une précision et le cas échéant une relation aux anciens nombres telles que l’on puisse dans des cas donnés les distinguer les uns des autres de manière déterminée. Dès qu’un nombre satisfait à toutes ces conditions, il peut et doit être considéré comme existant et réel dans la mathématique. Je vois clans ce fait la raison, indiquée par allusion au paragraphe 4, pour laquelle on doit accorder aux nombres rationnels, irrationnels et complexes tout autant d’existence qu’aux nombres entiers positifs finis.
Il n’est pas nécessaire, je crois, de redouter de ces principes aucun danger pour la science, comme le font bien des gens; d’une part les conditions que j’ai dites [49] et sans l’observation desquelles la liberté de former des nombres ne peut être mise en exercice, sont telles qu’elles ne laissent à l’arbitraire qu’une place extrêmement réduite; ensuite tout concept mathématique porte en lui-même son correctif nécessaire; s’il est stérile ou inadéquat, il le manifeste très vite par son peu d’usage, et il est alors abandonné pour manque d’efficacité. En revanche toute restriction superflue imposée à l’appétit de recherche mathématique me paraît comporter un danger bien plus grave, d’autant plus grave que l’on ne peut de l’essence de la science rien tirer qui la justifie. Car l’essence de la mathématique réside précisément dans sa liberté.
Si même cette constitution de la mathématique ne résultait pas pour moi des raisons que j’ai dites, tout le développement de la science elle-même, tel qu’il s’est offert à nos regards durant notre siècle, devrait me conduire exactement au même point de vue.
Si Gauss, Cauchy, Abel, Jacobi, Dirichlet, Weierstrass, Hermite et Riemann s’étaient trouvés contraints de toujours soumettre leurs idées nouvelles à un contrôle métaphysique, en vérité le plaisir que nous procure le superbe édifice de la moderne théorie des fonctions nous serait refusé; celui-ci pourtant, bien que projeté et exécuté de manière totalement libre et dépourvue de tout but transcendant, a déjà manifesté sa signification transcendante par des applications à la mécanique, l’astronomie et la physique mathématique - et il ne fallait pas s’attendre à autre chose. Il ne nous serait pas donné d’observer le grand essor de la théorie des équations différentielles, amené par Fuchs, Poincaré et bien d’autres, si ces talents exceptionnels avaient été arrêtés et ligotés par des influences étrangères; et si Kummer n’avait pas pris la liberté si riche de conséquences d’introduire les nombres ‘idéaux’ dans la théorie des nombres, nous ne serions pas en mesure aujourd’hui d’admirer les travaux algébriques et arithmétiques de Kronecker et Dedekind, si importants et remarquables.
Encore que la mathématique obtienne ainsi le droit à une entière liberté de mouvements, hors de tout lien métaphysique, je ne puis d’autre part reconnaître le même droit à la mathématique ‘appliquée’ , par exemple la mécanique analytique ou la physique mathématique; ces disciplines sont à mes yeux métaphysiques, dans leurs fondements aussi bien que dans leurs buts; si elles cherchent à se libérer de ce caractère, comme la chose a été récemment proposée par un physicien célèbre, elles dégénèrent alors en une ‘description de la nature’ , à qui nécessairement font défaut tout à la fois le souffle vif de la libre pensée mathématique et le pouvoir d’expliquer et d’établir les phénomènes naturels.
§ 9-10 omis
§ 11
Il convient de montrer à présent comment l’on se trouve conduit à la définition des nouveaux nombres, et de quelle manière on obtient dans la suite des nombres réels entiers absolument infinis les divisions naturelles que j’appelle classes de nombres. A cette analyse, je ne compte ajouter que les principaux théorèmes concernant la deuxième classe et son rapport à la première. La série (I) des nombres entiers réels positifs 1, 2, 3, ..., ν, ... provient en son principe de la position et de la réunion répétées d’unités qu’on a prises pour point de départ et [50] considérées comme égales; le nombre ν exprime un nombre (Anzahl) fini déterminé de telles positions successives aussi bien que la réunion en un tout des unités posées. La formation des nombres entiers réels finis repose ainsi sur le principe de l’addition d’une unité à un nombre donné déjà formé; j’appelle premier principe d’engendrement ce facteur déterminant qui, nous le verrons bientôt, joue également un rôle essentiel dans l’engendrement des nombres entiers supérieurs. Le numéral des nombres ν de la classe I à former de cette façon est infini et parmi ces nombres, il n’en existe aucun qui soit plus grand que tous les autres. Malgré la contradiction qu’il y aurait dès lors à parler d’un nombre maximum de la classe I, il n’y a toutefois rien de choquant à imaginer un nouveau nombre, nous le nommerons ω13, qui servira à exprimer le fait que la collection (I) tout entière est donnée conformément à sa loi, dans sa succession naturelle. (De même que y sert à exprimer le fait qu’un certain nombre (Anzahl) fini d’unités est réuni en un tout.) Il est même permis d’imaginer le nombre ω que nous venons de créer comme une limite vers laquelle tendent les nombres ν, à condition d’entendre seulement par là que ω doit être le premier nombre entier à suivre tous les nombres ν, c’est-à-dire doit être déclaré supérieur à chacun de ces nombres. En faisant suivre la position du nombre ω par des positions ultérieures de l’unité, l’on obtient à l’aide du premier principe d’engendrement les nombres ultérieurs: ω + 1, ω + 2, …, ω + ν, … Étant donné que par ce processus, l’on ne parvient, une fois encore, à aucun nombre maximum, on imagine un nouveau nombre, que l’on peut appeler 2ω et qui sera le premier nombre suivant tous les nombres obtenus jusqu’à présent: ν et ω + ν; si l’on applique à nouveau au nombre 2ω le premier principe d’engendrement, on parvient à continuer comme suit les nombres obtenus jusqu’à présent:
2ω + 1, 2ω + 2, …, 2ω + ν, …
La fonction logique qui nous a donné les deux nombres ω et 2ω est manifestement distincte du premier principe d’engendrement: je l’appelle deuxième principe d’engendrement des nombres réels entiers et je définis plus précisément ce dernier en disant: étant donné une succession quelconque déterminée de nombres entiers réels définis, parmi lesquels il n’y en a pas qui soit plus grand que tous les autres, on crée en s’appuyant sur ce deuxième principe d’engendrement, un nouveau nombre que l’on regarde comme la limite des premiers, c’est-à-dire qui est défini comme immédiatement supérieur à tous ces nombres.
Par l’application combinée des deux principes d’engendrement, les nombres que nous avons obtenus jusqu’ici reçoivent ainsi successivement les continuations suivantes:
3ω, 3ω + 1, …, 3ω + ν, …
…………………………
μω, μω + 1, …, μω + ν, …
…………………………
Toutefois nous n’en sommes pas pour autant parvenus à la fin, parce que parmi les nombres μω + ν, il n’y en a pas non plus qui soit plus grand que tous les autres.
Le deuxième principe nous conduit donc à introduire un nombre qui suive immédiatement tous les nombres μω + ν et que l’on peut appeler ω2, à ce nombre se rattacheront dans un ordre de succession déterminé des nombres λω2 + μω + γ, et l’on parvient évidemment alors, en appliquant les deux principes, à des nombres [51] de la forme ν0ωμ + ν1ωμ-1 … + νμ-1ω + νμ; mais ici le deuxième principe nous amène à poser un nouveau nombre, qui devra être immédiatement supérieur à tous ces nombres et sera commodément désigné par ωω.
La formation de nouveaux nombres, comme on le voit, est sans fin; en appliquant les deux principes, l’on obtient toujours encore de nouveaux nombres et de nouvelles séries de nombres, pourvues d’une succession parfaitement déterminée.
On pourrait dès lors s’imaginer tout d’abord que par ce mode de formation de nouveaux nombres entiers déterminés infinis, nous devons nécessairement nous perdre dans l’illimité, et que nous ne sommes pas en mesure d’imposer à ce processus sans fui un terme provisoire, nous fournissant une limitation analogue à celle qui en un certain sens nous était objectivement donnée pour l’ancienne classe (I); il n’y était fait usage que du premier principe d’engendrement, et il était ainsi impossible de sortir de la série (I). En revanche, non seulement le deuxième principe nous conduit, comme il était nécessaire, au-delà du domaine de nombres donné jusque-là, mais il se révèle en fait que c’est un moyen permettant avec le premier principe de franchir toute borne (Schranke) dans la formation conceptuelle des nombres entiers réels.
Il suffit cependant de remarquer que tous les nombres obtenus jusqu’ici et ceux qui les suivent immédiatement satisfont une certaine condition: cette dernière, alors, pourvu qu’on l’exige de tous les nombres à former immédiatement, se révèle un nouveau principe, qui prend place aux côtés des deux autres, et que j’appelle principe d’arrêt ou de limitation: il a pour effet, comme je le montrerai, que la deuxième classe de nombres (II) (définie par l’adjonction de ce principe) n’acquiert pas seulement une puissance supérieure à celle de la classe (I), mais précisément la puissance immédiatement supérieure, soit la deuxième puissance.
La condition susdite, qui, comme on peut s’en convaincre immédiatement, se trouve satisfaite par chacun des nombres infinis a définis jusqu’ici est la suivante: le système des nombres qui dans la suite précèdent celui que l’on considère a la puissance de la première classe (I). Prenons par exemple le nombre ωω, les nombres qui le précèdent sont contenus dans la formule ν0ωμ + ν1ωμ-1 … + νμ-1ω + νμ, où μ, ν0, ν1 … νμ doivent prendre toutes les valeurs numériques entières positives finies, y compris zéro et à 1 exclusion de la combinaison: ν0 = ν1 = … = νμ = 0. Comme on sait, ce système peut être mis sous la forme d’une série simplement infinie: il a donc la puissance de (I).
Étant donné de plus que toute suite de systèmes, ayant chacun la première puissance, donne toujours lieu, si cette suite est elle-même de la première puissance, à un nouveau système ayant la première puissance, il est clair qu’en continuant notre suite de nombres, on n’obtient toujours effectivement dans l’immédiat que des nombres satisfaisant bien en fait la condition requise.
Nous définissons donc la deuxième classe de nombres comme la collection de tous les nombres qui pouvant être formés à l’aide des deux principes d’engendrement, et progressant suivant une succession déterminée
ω, ω + 1, …, ν0ωμ + ν1ωμ-1 + … + νμ-1ω + νμ, …, ωω, …, α …
sont soumis à la condition que tous les nombres précédant α, à partir de I forment un système ayant la puissance de la classe (I). [Omis: démonstration du théorème énonçant que la nouvelle classe de nombres (II) a une puissance distincte de la classe (I).]
Si cependant nous jetons auparavant un regard en arrière et nous rappelons les moyens qui nous ont permis aussi bien d’élargir le concept de nombre entier réel que de découvrir une nouvelle puissance de systèmes bien définis, trois facteurs [52] logiques saillants ont agi, qu’il faut bien distinguer entre eux: à savoir les deux principes d’engendrement définis plus haut et un principe qui s’adjoint à eux: le principe d’arrêt ou de limitation, qui consiste à imposer la condition qu’on n’entreprenne de créer un nouveau nombre entier à l’aide de l’un des deux autres principes que si le rassemblement de tous les nombres précédents a la puissance d’une classe de nombres définie, déjà donnée dans toute son extension. De cette manière, en observant ces trois principes, l’on peut parvenir avec l’évidence la plus certaine à des classes de nombres toujours nouvelles, et grâce à elles, à toutes les puissances successivement croissantes et distinctes qui se présentent dans la nature physique et spirituelle, et les nouveaux nombres ainsi obtenus ont alors exactement la même précision concrète et la même réalité objective que les anciens; je ne vois donc pas, en vérité, ce qui devrait nous empêcher de travailler de cette façon à former de nouveaux nombres, dès que pour le progrès des sciences, l’introduction dans leurs développements d’une nouvelle classe parmi ces innombrables classes de nombres se révèle souhaitable ou même indispensable.
[§ 13 et 14 omis]
Note sur la traduction
La seule traduction française existant jusqu’à présent du texte qui précède est à notre connaissance la version parue en 1882 dans la première livraison des Acta Mathematica (p. 380-408) et rédigée par un groupe de mathématiciens (parmi lesquels, semble-t-il, Henri Poincaré), avec l’accord de Cantor qui la révisa.
En fait, il s’agit moins là d’une traduction que d’un remaniement de l’original (dont la publication dans les Mathematische Annalen est, il faut le remarquer, postérieure); seuls certains paragraphes ont été retenus et la disposition en a été bouleversée.14 De plus le détail du texte est modifié; certains éclaircissements nouveaux y sont incorporés, tandis que sont supprimées la plupart des incursions hors du domaine proprement mathématique.
Notre propos était différent; si donc, ne pouvant traduire l’ensemble du texte, nous avons da en sacrifier certaines parties, notre choix n’a pas été celui des A.M.15 Néanmoins, il va sans dire que, surtout tins les passages techniques, une traduction revue par l’auteur devait nous guider et nous en avons repris des passages.
En particulier, systématisant une tendance des A.M., nous avons adopté les équivalences suivantes: Mannigfaltigkeit = ensemble; Menge = système.
Nous avons de plus choisi pour Inbegriff la traduction ‘collection’ .
La traduction du mot Anzahl présente une difficulté: ce n’est pas à l’origine un mot technique puisqu’il désigne couramment le nombre des éléments d une collection donnée, tandis que Zahl est le nombre comme entité abstraite, sans application objective (cf. l’ancienne opposition entre ‘nombre concret’ et ‘nombre abstrait’ ). Cependant, à moins de perdre la distinction en employant nombre dans les deux cas, il faut forger un néologisme (nous avons choisi ‘numéral’ ), ce qui est gênant lorsqu’ Anzahl n’a pas son sens technique. Le cas se présente une fois dans notre texte (§11): le mot est alors traduit par ‘nombre’ et précisé par Anzahl.
Les appels de note marqués par des lettres renvoient aux notes du traducteur.
Les notes de Cantor lui-même sont indiquées, suivant l’usage de l’original, tantôt par un astérisque, tantôt par un chiffre.
Notes
1. Paru en 1883, Mathematische Annalen, XXI, 545-586. Traduction de J.C. Milner. ↵
2. Théorie des ensembles. Par ces mots, je désigne un concept théorique très large, que jusqu’à présent, je n’ai tenté de développer que sous la forme spécialisée d’une théorie des systèmes arithmétiques ou géométriques. Par un ‘ensemble’ ou ‘système’ , j’entends en effet de façon générale toute multiplicité qui peut être pensée comme une unité, c’est-à-dire toute collection d’éléments déterminés qui peut être par une loi combinée en un tout: je crois définir ainsi quelque chose d’apparenté à l’εϊδος ou ίδέα platonicienne, ou aussi à ce que dans son dialogue Philèbe ou le Souverain Bien, Platon nomme μιχτόν. Il oppose ce terme tout à la fois à l’άπειρον, c’est-à-dire l’illimité, l’indéterminé, ce que je nomme infini improprement dit, et au πέρας, c’est-à-dire la limite; il l’explique comme un ‘mélange’ ordonné de ces deux derniers termes. Platon donne lui-même à entendre que ces concepts sont d’origine pythagoricienne; cf. A. Boeck, Philolaos des Pythagoreers Lehren, Berlin, 1819. ↵
3. Exemple ajouté par les Acta Mathematica, 1. 393:
Pour éclaircir: soit donné un ensemble {αv} de la première puissance; on peut en former de différentes manières des ensembles bien ordonnés, par exemple les suivants:
{α1, α2, …, αν, αν+1, …}
{α2, α3, …, αν, αν+1, …, α1}
{α3, α4, …, αν, αν+1, …, α1, α2}
{α1, α3, …, α2ν–1, α2ν+1, …, α2, αν, …, α2ν–2, α2v …} ↵
4. Exemple ajouté par les Acta Mathematica, I, 394:
Par exemple les trois ensembles bien ordonnés:
{α1, α2, α3, α4, …, αν, αν+1, …}
{α2, α1, α4, α3, …, α2ν, α2ν-1, …}
{1, 2, 3, …, ν, …}
ayant le même nombre [c’est-à-dire Anzahl ou numéral. Trad.], celui-ci se trouve d’après nous définition, égal à ω.
De même les nombres des ensembles bien ordonnés.
{α2, α3, …, αν, αν+1, …, α1}
{α3, α4, …, αν, αν+1, …, α1, α2}
{α1, α3, …, α2ν–1, α2ν+1, …, α2, α4, α2ν–2, α2ν, …}
se trouvent d’après notre définition égaux à ω + 1, ω + 2, 2ω. ↵
5. D’après la définition que je viens d’introduire et en même temps de préciser et généraliser, ce que j’ai appelé jusqu’à présent ‘dénombrable’ dans les premières sections de mon essai, n’est que la capacité d’être dénombré par des nombres de la première classe (systèmes finis) ou par des nombres de la deuxième classe (systèmes de la première puissance). ↵
6. Aristote. Cf. la présentation de Zeller dans son grand ouvrage Die Philosophie der Griechen, 3e éd., II, 2, 393-403. La conception platonicienne de l’infini est toute différente de celle d’Aristote; cf. Zeller, II, 1, 628-646. Je découvre de même dans la philosophie de Nicolas de Cuse des points communs avec mes conceptions. Cf. R. Zimmermann, Der Cardinal Nicolaus von Cusa als Vorgänger Leibnizens (Sitzungsberichte d. Wiener Akademie der Wiss., Jahrig. 1852). Je fais la même remarque en ce qui concerne Giordano Bruno, qui s’inspire de N. de Cuse. Cf. Brunnhofer, Giordano Brunos Weltanschauung und Verhängnis, Leipzig, 1882.
II est cependant une différence essentielle: je fixe conceptuellement une fois pour toutes au moyen des classes de nombres (I), (II), (III) etc. les divers degrés de l’infini proprement dit et c’est seulement après cela que je me donne pour tâche, non content d’approfondir mathématiquement les relations des nombres transfinis, de les reconnaître et les poursuivre également partout où ils se présentent dans la nature. Que de cette manière, nous devions aller toujours plus loin, sans jamais parvenir à une limite infranchissable, mais sans parvenir non plus à une conception même approchée de l’absolu, cela ne fait pour moi aucun doute. L’absolu peut seulement être reconnu, mais non pas connu, fut-ce de façon approchée. Car de même qu’à l’intérieur de la première classe (I), pour tout nombre fini, si grand soit-il, on a toujours devant soi la même puissance des nombres finis qui lui sont supérieurs, de même tout nombre transfini, si grand soit-il, appartenant à l’une quelconque des classes plus élevées (II) ou (III) etc., se trouve suivi d’une collection de nombres et de classes de nombres qui n’a rien perdu en puissance par rapport à la totalité de la collection absolument infinie des nombres pris à partir de 1. La situation dès lors est analogue à ce qu’A. von Haller dit de l’éternité: “Je le soustrais (le nombre démesuré) et tu (l’éternité) t’étends devant moi tout entière”. La suite absolument infinie des nombres me parait être de ce fait, en un certain sens, un symbole adéquat de l’absolu, alors qu’au contraire, l’infinité de la première classe qui seule jusqu’à présent a été employée à cet effet, me semble (précisément parce que j’y vois une idée – non pas une représentation – concevable) un néant qui s’évanouit complètement à côté de la précédente. Il me parait également remarquable que chaque classe de nombres, et donc aussi chaque puissance, soit mise en correspondance avec un nombre entièrement déterminé de la collection absolument infinie des nombres, et cela de telle façon que pour tout nombre transfini y est donnée une puissance qui doit être nommée la γ-ème; les diverses puissances forment donc, elles aussi, une suite absolument infinie. Le fait est d’autant plus remarquable que le nombre γ qui donne l’ordre d’une puissance (au cas où le nombre γ a un prédécesseur immédiat) soutient avec les nombres de la classe qui a cette puissance, un rapport de grandeur dont la petitesse défie toute description, et cela d’autant plus que γ sera pris plus grand. ↵
7. Sont également dignes d’attention: Hobbes, De corpore, chap. VII, 11; Berkeley, Treatise on the principles of human knowledge, 128-131 ↵
8. Determinari possunt. Je ne puis concéder aucun être à l’indéterminé, au variable, à l’infini improprement dit, sous quelque forme qu’ils apparaissent, car ils ne peuvent être que ceci: soit des concepts de relation, soit des représentations ou intuitions (imaginationes) purement subjectives, en aucun cas des idées adéquates. Si donc l’on ne visait que l’infini improprement dit dans la proposition ‘infinitum actu non datur’ , je pourrais y souscrire, mais ce serait alors une pure tautologie. Dans les sources que j’ai mentionnées, toutefois, cette proposition me paraît plutôt signifier l’impossibilité de poser conceptuellement une infinité déterminée, et dans ce sens, je la tiens pour fausse. ↵
9. Réalistes. Le point de vue positiviste et réaliste sur l’infini se trouve exposé par exemple dans Dühring, Natürliche Dialektik, Berlin, 1865, 109-135 et von Kirchmann, Katechismus der Philosophie, 124-130. Cf. aussi les annotations d’Ueberweg au Traité sur les principes de la connaissance humaine de Berkeley (Bibliothèque philosophique de von Kirchmann). Je peux seulement répéter que pour l’essentiel, je m’accorde avec tous ces auteurs sur l’appréciation de l’infini improprement dit, la seule différence est qu’ils regardent cet infini syncatégorématique comme le seul à pouvoir être appréhendé par des ‘formules’ ou des concepts (et même dans le cas présent par de simples concepts de relation). Les démonstrations de Dühring contre l’infini proprement dit pourraient être considérablement abrégées et peuvent se réduire, il me semble, à l’une de ces deux assertions: ou bien que le nombre fini déterminé, si grand qu’on l’imagine, ne peut jamais être infini, ce qui suit immédiatement de son concept, ou bien que le nombre fini variable, grand au-delà de toute borne, ne peut jamais être pensé avec le prédicat de la détermination, ni dès lors celui de l’être, ce qui à nouveau résulte immédiatement de l’essence de la variabilité. Que rien par là ne se trouve obtenu qui réfute de quelque façon la possibilité de penser des nombres transfinis déterminés, cela ne fait pour moi aucun doute; et pourtant ces démonstrations sont censées réfuter la réalité des nombres transfinis. Cette argumentation me paraît analogue à celle qui voudrait conclure du fait qu’il existe d’innombrables nuances de vert, que le rouge n’existe pas. Mais il est en vérité remarquable que Dühring avoue lui-même à la page 126 de son ouvrage, que pour expliquer la “possibilité de la synthèse illimitée”, un fondement est nécessaire, qu’il caractérise comme étant “naturellement tout à fait inconnu”. Ici réside, me semble-t-il, une contradiction.
Mais nous voyons également que des penseurs proches de l’idéalisme ou même y adhérant entièrement, refusent toute justification aux nombres déterminés infinis.
Dans son excellent ouvrage, Logik, vol. II, ‘Die Methodenlehre’, Tübingen, 1878, Chr. Sigwart raisonne exactement comme Dühring et déclare à la page 47: “Un nombre infini est une contradiction in adjecto”.
Même chose chez Kant et J. F. Fries; cf. de ce dernier System der Metaphysik, Heidelberg, 1824, aux paragraphes 51 et 52. Les philosophes de l’école hégelienne refusent également toute validité aux nombres infinis proprement dits; il suffit de citer l’ouvrage plein de mérites de K. Fischer: System der Logik und Metaphysik oder Wissenschaftslehre, éd., Heidelberg, 1865, p. 275. ↵
10. Ce que j’appelle ici réalité ‘intrasubjective’ ou ‘immanente’ des concepts ou des notions pourrait légitimement coïncider avec la détermination ‘adéquate’ au sens où ce mot est employé par Spinoza, Éthique, II, def. IV: “Per ideam adaequatam intelligo ideam quae quatenus in se sine relations ad objectum consideratur, omises verae ideae proprietates sive denominationes intrinsecas habet.” ↵
11. Cette conviction coïncide pour l’essentiel aussi bien avec les principes fondamentaux du système platonicien qu’avec un trait essentiel du système spinoziste; sur le premier point, je renvoie à Zeller, Philosophie der Griechen, 3e éd., II, 1, 541-602. Il y est dit tout au début du chapitre: “Seul le savoir conceptuel peut (selon Platon) garantir une véritable connaissance. Mais au degré de vérité que détiennent nos représentations – Platon partage ce présupposé avec Parménide – doit répondre un degré égal de réalité pour leur objet, et réciproquement. Ce qui peut être connu, est; ce qui ne peut être connu, n’est pas, et c’est dans l’exacte mesure où elle est, qu’une chose est connaissable.”
En ce qui concerne Spinoza, je n’ai qu’à rappeler sa proposition (Éthique, II, prop. VII): Ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum.
Dans la philosophie de Leibniz également, l’on peut retrouver le même principe de théorie de la connaissance. Ce n’est que depuis l’empirisme, le sensualisme et le scepticisme modernes et depuis le criticisme kantien qui en est issu, que l’on croit devoir situer la source du savoir et de la certitude dans les sens ou les dites “formes pures de l’intuition du monde représentatif”, en la confinant dans ces bornes; je suis convaincu que ces éléments ne fournissent aucune connaissance assurée, parce que cette dernière ne saurait être atteinte que par des concepts et des notions qui tout au plus sont suscités par l’expérience extérieure, mais sont pour l’essentiel formés par une induction et une déduction internes, comme une chose qui dans une certaine mesure était déjà en nous, et se trouve seulement éveillée et portée à la conscience. ↵
12. Pour correctement former un concept, le processus est toujours le même: on pose un objet (Ding) dépourvu de propriétés, qui tout d’abord n’est rien qu’un nom ou un signe A, et l’on confère à celui-ci de manière ordonnée des prédicats intelligibles divers ou même infiniment nombreux, dont on peut connaître la signification par l’examen de notions déjà données, et qui ne doivent pas se contredire entre eux; ainsi se trouvent déterminées les relations de A aux concepts déjà donnés et spécialement aux concepts apparentés; quand on a mené ce procès jusqu’à son terme, toutes les conditions sont données pour éveiller le concept A qui sommeillait en nous et il parvient à l’existence tout achevé, revêtu de la réalité intrasubjective qui seule peut être requise des concepts; constater sa signification transcendante est alors la tâche de la métaphysique. ↵
13. A partir de maintenant, je remplace par ω le signe ∞ que j’ai utilisé dans le no 2 de cet essai; en effet le signe ∞ se trouve employé déjà plusieurs fois pour désigner les infinités indéterminées. ↵
14. Sur les quatorze paragraphes de l’original, les Acta Mathematica (que nous désignons en abrégé par A.M.) traduisent, dans l’ordre: 1, 11, 12, 13, 2, 3, 14, 10. ↵
15. Nous traduisons les paragraphes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12. Sauf pour le paragraphe 12, dont nous ne reprenons que le dernier alinéa, le texte des paragraphes retenus est complet. ↵