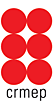D'une Théorie de la structure à une théorie du sujet: un entretien avec Alain Badiou
PH: J’aimerais commencer avec quelques détails anecdotiques. Les Cahiers pour l’Analyse sont lancés en 1966. Qu’est-ce qui se passe à l’Ecole Normale Supérieure à cette époque là, vers 1964-65? Qu’est-ce que c’est le Cercle d’Epistémologie, et comment la revue est-elle lancée?
AB: D’abord je vais t’avouer que je ne sais pas grand-chose là-dessus. Moi, l’Ecole Normale, je n’y étais plus; je suis arrivé en 1956, et je l’ai quittée en 1961. Je suis plus vieux que toute cette chose. D’abord je suis parti en province et ensuite au service militaire. Donc dans l’année 1962-63, dans les années préliminaires de tout cela, je suis vraiment très loin de la scène intellectuelle normalienne. D’autant plus loin qu’à l’époque je m’occupe principalement d’écriture romanesque. C’est l’époque où je suis dans Almagestes et Portulans.1 Donc je ne serai remis dans ce processus qu’avec un net décalage; je te raconterai cela après. En réalité ma reprise de contact avec tout cela c’est en 1966.
PH: C’est-à-dire au commencement même des Cahiers pour l’Analyse.
AB: Oui, juste après le commencement, enfin, en 1966-67. Je ne suis vraiment incorporé à la direction des Cahiers pour l’Analyse qu’en 67. Donc ça va être une expérience également très courte, puisqu’il va s’interrompre en 68, comme tu le sais. C’est le premier point que je veux dire. Moi je suis un élément tardif, appartenant de fait à une autre génération. Parce que même s’il n’y a que quelques années de différence, elles sont idéologiquement et philosophiquement très importantes. En particulier par exemple je suis de formation sartrienne...
PH: Et pour les autres membres du Cercle, Sartre était une référence? Son nom ne paraît que rarement dans les Cahiers.
AB: Non, non, les autres ne sont plus de formation sartrienne. Ils sont même très éloignés de cela, très critiques. Je reviendrai tout à l’heure sur les conditions dans lesquelles je vais me réincorporer dans ce processus. Ceci dit, ce qui se passe à l’Ecole dans cette année là, je peux le reconstituer en partie, parce que ça a commencé avant. En réalité ce qui c’est installé à l’Ecole Normale à partir de la fin des années 50, je le définirai comme une sorte de conflit obscur ou d’articulation difficile entre, d’une part, un héritage philosophique à dominante phénoménologique – même si cela a la forme ‘Sartre et Merleau-Ponty’...
PH: Ceci à travers Jean Hyppolite et compagnie?
AB: A travers Hyppolite en particulier, qui est quand même le régent philosophique de l’Ecole. Et, d’autre part, l’apparition, la constitution de ce qui sera nommé le structuralisme.
PH: Qui veut dire, essentiellement, à l’Ecole, Althusser?
AB: Attend, il y a autre chose. La tension entre ces deux tendances va caractériser cette époque avant les interventions d’Althusser. Parce que moi, quand j’étais à l’Ecole, Althusser n’intervenait pas. Il était d’abord souvent absent, et tout le monde savait qu’il était membre du parti communiste. Tout le monde savait qu’il n’était pas du tout dans l’élément théorique de la phénoménologie de Sartre etc., mais il n’intervenait pas de façon novatrice ou positive. Il était notre maître, mais de façon assez classique.
PH: Il donnait des cours sur l’histoire de la philosophie, n’est-ce pas? Descartes, Malebranche...
AB: Voilà, il faisait la correction des rédactions, la préparation à l’agrégation. Il faisait venir des philosophes sur différents points. La situation commence à changer à partir de 1963-64: les deux évènements qui se sont produits dans ces années là, c’est le transport du séminaire de Lacan à l’Ecole Normale Supérieure et le cycle de séminaires d’Althusser conduisant à Lire le capital. Moi, quand je suis à l’Ecole (1956-1961) il n’y a rien de tout ça. Ce qu’il y a, c’est une montée dispersée, hésitante, une sorte de recherche dans la direction de ce qui se passe, le structuralisme, et dont les appuis fondamentaux sont en réalité dans les lectures que nous faisons à l’époque, dans les discussions que nous avons, la découverte – très rétrospective – de Lévi-Strauss. Une lecture tout à fait importante, pour moi en tous cas, a été Les Structures élémentaires de la parenté.
PH: De 1948-49.
AB: Oui, voilà, mais en réalité le livre est resté, pendant au moins dix ans, sans être vraiment lu par d’autres que par des spécialistes. Là il devient une référence publique. La linguistique, l’apprentissage de la linguistique structurale, de la phonologie, la découverte à la fois de Troubetzkoy et de Jakobson, l’intérêt pour l’épistémologie des mathématiques, pour la logique formelle, très peu enseignée à l’époque, que nous découvrons par nos propres moyens – il n’y avait qu’un seul enseignant qui parlait de ça, c’était Roger Martin, c’était le seul répondant. Donc il y a eu un effort mathématico-logique que nous avons assumé.
PH: Tu étais déjà engagé dans cette voie, à l’époque?
AB: Oui, j’avais, moi, une formation mathématique, mais même ceux qui n’en avaient pas s’y sont intéressés, enfin, le petit groupe qui était pris dans ce mouvement philosophique. On commence à lire la tradition analytique, Carnap et puis Wittgenstein.
PH: Et Frege? Il est un point de référence majeur dans le premier volume des Cahiers.
AB: Et puis, un peu après, Frege. C’est un peu plus tard. Voilà, et donc à travers tout ça on bricole un certain nombre de choses, dans lesquelles va s’insérer la découverte de Lacan. Alors la découverte de Lacan j’y suis personnellement très lié, parce que dès 1959 j’ai commencé à prendre connaissance de la Revue sur la psychanalyse, c’est-à-dire les premiers textes publics de Lacan. Althusser aussi commence à repérer cette affaire-là à cette époque. Je suis d’ailleurs une fois allé suivre le séminaire de Lacan à Sainte-Anne avec Althusser. Ça devait être en 1960. Hyppolite lui-même participe aux séminaires de Lacan, comme on sait. Donc lui-même, Hyppolite, garant de la tradition hégélienne et phénoménologique, se déplace – si je puis dire – du côté de ces éléments novateurs. Il connaît d’ailleurs fort bien Lévi-Strauss aussi. C’est un esprit très curieux, Hyppolite, qui connaissait toutes les figures de la modernité, qui avait une disponibilité très grande à s’emparer de tout ça. Donc, encouragé, finalement, par Hyppolite et Althusser etc., je fais le premier exposé systématique sur Lacan à l’Ecole Normale Supérieure en 1960, ou peut-être en 61.
PH: A cette époque là tu avais 24 ans ou quelque chose comme ça? Tu étais encore élève à l’Ecole Normale?
AB: Oui j’avais 24 ans exactement. J’étais encore inscrit comme élève parce que j’ai fait cinq ans à l’Ecole. J’ai passé l’agrégation en 60 et j’ai eu une année supplémentaire.
PH: Et tu es parti pour le service militaire en...
AB: ... en Novembre 61, voilà. Pendant l’année 60-61 j’ai fait donc ces deux séances de séminaires sur Lacan, qui je crois ont été les premiers séminaires systématiques sur Lacan faits dans l’espace stricte de la philosophie, puisque moi je n’étais pas du tout psychanalyste.
PH: Et à cette époque là des gens comme Milner et Miller étaient là aussi?
AB: Ils venaient d’arriver. Peut-être Miller même pas. Venaient d’arriver des gens comme Balibar ou Regnault. Mais entre quelqu’un comme moi qui était en dernière année, en cinquième année, et eux qui arrivaient en première année, les rapports étaient forcément très limités, puisque le noyau qui se constituait était celui de ceux qui préparaient l’agrégation ou de ceux qui étaient déjà en réalité doctorants, qui avaient déjà passé l’agrégation. Si bien qu’à cette époque je n’ai pas de souvenir d’eux du tout. Je ne les connaissais pas. Et enfin, il y a eu ce séminaire sur le Capital, organisé par Althusser.
Donc voilà, ça c’était l’ambiance de cette époque là: un intérêt pour le structuralisme, un intérêt pour la formalisation, un intérêt pour la linguistique, un intérêt pour le marxisme. Il y avait aussi l’idée qu’à l’enseignement hérité de la philosophie traditionnelle, dans sa modalité phénoménologique dernière, devait se substituer un nouvel ensemble théorique. C’est la référence aux sciences humaines qui est très importante. Il y a un élément quand même un peu scientiste qui s’installe à cette époque: la référence à la scientificité, à la science, qui va être systématisé après par Althusser.
Alors ce qu’il faut comprendre, c’est que nous sommes quand même constitués dans un élément mixte. D’un côté, notre formation est Sartrienne et on continue à porter à Sartre un intérêt considérable. Parce que l’année 60 c’est aussi l’année de la sortie de La Critique de la raison dialectique. Avec Emmanuel Terray et quelques amis on la lit avec passion, on la discute. Lui-même d’ailleurs, Sartre, discute en même temps que nous sur le courant structuraliste et les sciences humaines, et La Critique de la raison dialectique est très marquée par ces discussions. Donc on se reconnaît dans ces discussions, même si les uns ou les autres, on est en tension avec cette dernière tentative de Sartre. Parce que, d’un autre côté, on est déjà peut-être plus installés dans le dispositif alternatif. Il y a là un élément de conviction qui dépasse de beaucoup la philosophie pure, parce que c’est aussi les discussions sur le Nouveau Roman de Robbe-Grillet, et sur la Nouvelle Vague au cinéma. C’est le sentiment d’une espèce de transformation fondamentale de l’ensemble des données de l’intellectualité.
PH: Il y a également Roland Barthes et Michel Foucault qui commencent à s’imposer, la critique anti-humaniste de la tradition classique...
AB: Oui bien sûr, et c’est aussi le moment où on commence à être dans une position de contestation et de critique de l’héritage du parti communiste. Parce qu’il ne faut pas oublier que toute cette période se situe en pleine guerre d’Algérie; ça c’est fondamental. Les autres qui vont venir après, la différence c’est que la guerre d’Algérie est finie. Pour nous c’est quand même un point clef. Il y a les grands combats comme la guerre d’Algérie, les relations avec le réseau de soutien au FLN monté par Francis Jeanson, les manifestations là-dessus, et la menace permanente, qui pèse sur tout le monde, d’être envoyé faire la guerre coloniale ! Tout le monde faisait son service militaire. D’ailleurs il y a un ou deux de mes amis proches qui vont être des déserteurs, qui vont se retrouver en Tunisie.
PH: Et puis il y avait l’OAS [Organisation de l’Armée Secrète] et compagnie qui s’y mêlaient au dénouement...
AB: Dans ce contexte, nous avons le sentiment d’un conflit politique très violent, du fait que les anciens appareils ne fonctionnent pas, ne parviennent pas à traiter la situation. La position du parti communiste reste indécise. Après il va y avoir la venue au pouvoir de de Gaulle, il va avoir un élément de transformation, mais la guerre en Algérie va continuer. Il y a l’héritage sartrien comme référence fondamentale pour toute une partie d’entre nous et il y a cette espèce de transformation, encore un peu obscure, qui amène une nouvelle manière d’appréhender les choses, un nouveau rapport à la question du paradigme scientifique. Et il y a aussi des mutations très importantes dans l’ordre artistique, etc.
PH: A ce moment-là, Mao n’était pas tellement un point de référence, n’est-ce pas?
AB: Non. Je me souviens très bien le premier exposé que j’ai fait sur le conflit sino-soviétique, parce que l’intérêt pour Mao a commencé vers cette époque; j’étais déjà professeur au lycée de Reims, j’avais quitté l’Ecole depuis un bon bout de temps. Ça doit être en 1965 ou 66. Avant 64, avant le conflit sino-soviétique, il n’y a pas de référence chinoise, elle n’est pas singularisée par rapport à l’Union Soviétique.
PH: D’accord. Juste pour établir la chronologie alors: tu pars de l’Ecole Normale en Novembre 61, ensuite tu dois passer deux ans de service militaire, c’est ça?
AB: Je pars en novembre 61. J’étais au lycée de Reims pendant deux mois avant, entre la rentrée et novembre, et je reste au service militaire juste en mai 63. D’abord je fais mes classes normales et ensuite je suis recruté pour être flûtiste dans la musique de la troisième région aérienne à Bordeaux.
PH: Et après d’être libéré de l’armé...
AB: ...je reviens au lycée de Reims où je vais faire les années 63-64 et 64-65. A la rentée de 65 je vais être nommé au Collège Universitaire de Reims, qui est le début de la création d’une nouvelle université à Reims. J’y reste jusqu’en janvier 1969. C’est à l’époque de l’expansion gigantesque des universités. Il y a une pression démographique et sociale considérable, les universités débordent de monde et on crée des universités dans des tas de villes de province. Je participe alors à la création d’une nouvelle université.
PH: C’est d’ailleurs assez difficile à imaginer maintenant: toute ma vie c’est absolument le contraire. On annule des facs, on ferme des départements, on abolit des postes...
AB: Non, là c’est au contraire une expansion. Mais il faut bien voir que nous sommes portés, en réalité, tous, la jeunesse de cette époque là, par le sentiment absolu d’être dans une époque de novation et d’expansion. Alors évidement, après, les matérialistes marxistes-léninistes viendront dire ‘oui, oui, en effet, c’est une période d’expansion tout court!’ [rire]. Ce sera la période des ‘trente glorieuses’ [1945-75], comme ils disent. Mais il y a le sentiment, spécialement dans ces années là, qui est une singularité des années 60, qu’une nouveauté essentielle est possible, même si son contour est obscur. On est portés par ça et effectivement il se crée des universités partout, on vient nous chercher pour remplir les postes. Vraiment, on vient me chercher pour me dire ‘mais il faut absolument que vous veniez à cette université!’...
PH: D’une part donc il y a cette expansion, mais il y a toujours l’Ecole Normale qui reste un peu à l’écart, une exception, et qui je suppose ne change pas tellement.
AB: Ah oui, mais le fait est qu’il s’est créé partout des universités nouvelles, le fait est que les courants intellectuels novateurs dépassent de très loin l’Ecole Normale. Le structuralisme est devenu à un moment donné un phénomène de mode. On en parlait dans les magazines, il y a eu des caricatures montrant Foucault, Deleuze etc. C’est devenu un phénomène de société, comme le Nouveau Roman l’avait été et comme la Nouvelle Vague au cinéma. Tout ça, d’ailleurs, va lancer en plus le mot ‘nouveau’, dont l’achèvement est la corruption définitive avec les ‘Nouveaux Philosophes’. Parce que les nouveaux philosophe, dix ans plus tard, à la fin des années soixante dix, ce sera le moment où ça va se renverser, c’est-à-dire le moment où ‘nouveau’ va prendre le sens de restauration des choses, abandon de l’idée révolutionnaire, conformisme universalisé, etc.
PH: Le moment où le nouveau va devenir le vieux.
AB: Oui, c’est ça.
PH: Mais à l’époque où le nouveau demeure jeune, est-ce que vous aviez, toi et tes contemporains, l’idée que l’Ecole Normale restait quand même toujours une exception spéciale? Ou bien est-ce qu’on commençait à mettre ses privilèges un peu en cause?
AB: On jouait, dans les conditions que je te dis, dans des conditions créatrices et portées, on jouait le rôle qui était le notre, d’une aristocratie intellectuelle parfaitement contente d’elle-même. Aucun problème là-dessus.
PH: Est-ce c’était remis en cause ailleurs, autour des nouvelles facs par exemple?
AB: Non, ça n’a été remis en cause qu’à partir de 68. La critique de l’université antérieure à 68 n’a jamais réellement remis en cause le dispositif des grandes écoles. Ce qu’elle a demandé c’est plutôt que ça se généralise, que le cercle soit étendu. En plus les thématiques fondamentales ont été des thématiques d’auto-organisation interne des apprentissages du savoir. La grande idée, dans les années 67-68, c’était les GTU, les Groupes de Travail Universitaire. On critiquait les ‘bonzes académiques’, les mandarins des Universités traditionnelles. On considérait l’enseignement traditionnel comme vieillot, figé dans des formes dépassées, qu’il fallait que les étudiants, qui devenaient de plus en plus nombreux, s’auto-organisent pour conquérir de nouvelles formes de savoir. Mais il y avait toujours, justement, un immense respect pour le savoir. La critique politique du savoir est postérieure.
PH: Et dans ce milieu là, les Cahiers Marxistes-Léninistes de l’Ecole Normale: comment les situer?
AB: Les Cahiers Marxistes-Léninistes commencent vers 1964-65, puisque c’est chevillé à la scission sino-soviétique et même au développement, à l’ouverture de la Révolution Culturelle. La création des Cahiers Marxistes-Léninistes est liée à une scission de l’union des étudiants communistes. Il y a toujours eu un important groupe de communistes à l’Ecole. Le groupe des étudiants communistes était important et d’autre part il était lié à la cellule communiste de l’Ecole qui comportait un nombre significatif d’enseignants communistes, dont Althusser. Cet appareil communiste à l’Ecole entre en crise – assez fondamentalement me semble-t-il – à propos d’une part des idées nouvelles, de la reformulation du marxisme, mais surtout de la guerre de Vietnam et plus généralement de la position du parti communiste sur la question coloniale et la question des luttes des libérations nationales. Les jeunes, qui sont très marqués par les luttes anti-impérialistes, considèrent la position officielle du Parti comme timorée et incertaine. Les autres critiques viendront après. Mais ce qui a été le vecteur c’était le conflit entre ‘tiers-mondisme’ et le parti communiste en tant que tel, c’est-à-dire entre l’idée que la scène fondamentale de l’histoire contemporaine c’étaient les guerres de libération nationale et puis le coté quand même syndicaliste et nationaliste que conservait l’appareil du Parti.
PH: Le PCF était même hostile à l’eurocommunisme du parti italien...
AB: Oui, et car il manifestait une véritable servilité à l’égard de la politique internationale de l’Union Soviétique. Une des raisons pour laquelle le parti communiste a été très réticent à s’engager dans la guerre d’Algérie, c’était la conviction que si l’Algérie devenait indépendante alors les américains allaient s’installer, et qu’on préférait que ce soit les français. Ce n’était pas plus compliqué que ça.
PH: D’accord, et donc dans ce contexte-là, Mao fournissait une autre manière de voir les choses?
AB: Dans cette histoire de l’union des étudiants communistes il va y avoir deux scissions successives, qui définissent une configuration qui aura la vie dure. Grosso modo, il y aura une scission Trotskiste et une scission Maoïste.
La scission Trotskiste va donner lieu à la création de l’appareil qui a le mieux résisté à l’épreuve du temps, ce sera la Ligue Communiste Révolutionnaire, animée donc par Alain Krivine, Daniel Bensaïd etc. C’est une première scission qui s’est faite à propos d’un combat mené à l’intérieur de l’union des étudiants communistes à propos des orientations italiennes. Ils se sont appelés d’ailleurs la scission ‘italienne’. Ils revendiquaient comme modèle le parti communiste italien, plus ouvert par rapport au parti français, plus dynamique, admettant dans une certaine mesure les factions et les divergences internes, moins chevillé à l’URSS etc. Donc il y a eu cette scission des ’italiens’ qui dans le devenir a fini par donner la Ligue Communiste Révolutionnaire, et aujourd’hui le Nouveau Parti Anticapitaliste.
Et puis il y a eu la scission ‘chinoise’, c’est-à-dire celle qui a donné l’UJC-ML, l’Union des Jeunesses Communistes – Marxistes-Léninistes.2 Voilà et ces deux scissions ont eu leurs représentants à l’Ecole Normale Supérieure.
PH: Quel est le rapport entre cette UJC-ML et l’UCF-ML (Union des Communistes de France – Marxistes-Léninistes)3, dont tu étais un des membres fondateurs?
AB: Ne confond pas les deux choses! Il y a trois ans d’écart entre les deux, et dans ces trois ans, il y a Mai 68. Nous sommes encore dans L’Ecole Normale Supérieure, avant Mai 68, et nous parlons du groupe des étudiants communistes qui est traversée par deux scissions fondamentales, liées surtout aux mobilisations concernant la guerre du Vietnam, la situation internationale et les guerres de libération nationales. A mon avis le parti communiste paye chez les jeunes le prix de sa modération et de ses incertitudes sur la guerre d’Algérie. La scission chinoise a constitué un noyau fondamental du maoïsme français, parce qu’elle a été en réalité la première figure constituée du maoïsme français, qui a été réellement dynamique. Par ailleurs il y a eu une autre scission, une troisième, celle-là tout à fait bureaucratique et prochinoise, encouragée par l’état chinois etc.: c’était le PCMLF (Parti communiste marxiste-léniniste de France4). Mais ce PCMLF n’a jamais eu aucune existence ni d’importance intellectuelle; il a essayé d’infiltrer les syndicats, il a en somme poursuivi les tactiques traditionnelles. Son idéal était le PCF des années trente.
Par contre, on peut dire qu’avec l’UJC-ML on a réellement la fusion de quelque chose de l’expérience chinoise, de la scission sino-soviétique après la Révolution Culturelle et d’une fraction significative, en tout cas active, de l’intelligentsia française. Le PCMLF c’était un certain nombre de vieux briscards du PC, qui étaient partis pour bâtir leur propre appareil exactement sur le modèle du PC lui-même. Tandis que là, avec l’UJC-LM, c’est un phénomène tout à fait particulier, qui était ce qu’il y avait de plus moderniste, si je puis dire, de plus concentré dans l’intelligentsia française. C’est articulé sur le maoïsme.
C’est eux qui ont crée les Cahiers Marxistes-Léninistes.
PH: D’accord, donc en 1964.
AB: Je pense que les Cahiers Marxistes-Léninistes, et l’UJC-ML, ça doit être de 64, 65. Le premier numéro des Cahiers Marxistes-Léninistes qui est ici [dans mon bureau], c’est le numéro 12-13, d’octobre 1966, sur la révolution russe. On y trouve quand même une épigraphe de Staline. Avec ce numéro 12 s’ouvre la nouvelle série des Cahiers Marxistes-Léninistes qui était déjà alors une belle revue.
PH: Dirigé par Roger Linhart?
AB: C’est Linhart naturellement, et dedans on trouve Macherey, Establet, Balibar, Alain Badiou, Mao Tsé-toung et Joseph Staline [rires].
PH: J’aimerais y revenir. Alors, l’UJC-ML se forme aussi dans ces années là, mais toi tu n’en faisais pas parti.
AB: Ah non, je n’ai jamais fait parti de l’UJC-ML, jamais. Moi, je suis de filiation social-démocrate. Mon itinéraire organisé est le suivant. Je suis inorganisé jusqu’en Janvier 1956. En Janvier 56 il y a des élections législatives – la guerre d’Algérie a commencée depuis un an et demi – et je suis déjà militant contre la guerre d’Algérie, sur des modalités encore limitées du type ’paix en Algérie!’ etc. Bon, la guerre bat son plein, et la question à l’ordre du jour c’est de l’étendre, c’est dire d’appeler les contingents. Jusque fin 55 n’est là-bas que l’armée professionnelle. Au début de 1956, on appelle le contingent. Alors en 56 – je suis toujours au lycée Louis le Grand, dans la classe préparatoire à l’Ecole Normale Supérieure – avec un petit groupe informel, mais contenant aussi quelques communistes plus radicaux que les autres, on milite pour qu’il y ait des candidatures unifiées de la gauche, socialistes et communistes, pour mettre fin à la guerre. Et donc nous réclamons une majorité du type ‘front populaire’.
Ce n’est pas du tout cela qui va se faire. Le parti socialiste va choisir une majorité qu’il va appeler ’le front républicain’, et cette majorité de front républicain, qui se fait avec les radicaux etc., va en effet emporter les élections et va donner le gouvernement Guy Mollet. Contre cette tendance, on a organisé dans le lycée Louis le Grand lui-même une vaste réunion pour exiger l’alliance des socialistes et des communistes, pour mettre fin à la guerre d’Algérie. Cette réunion a été d’ailleurs dispersée par la force, le proviseur arrivant avec une armée de surveillants pour déclarer que c’était intolérable et qu’on ne faisait pas de politique dans le lycée. C’est mon premier épisode illégal...
PH: Ce ne sera pas le dernier.
AB: Non. Je ne savais pas dans quoi j’avais mis le nez là... [rire]. A partir de ce moment, je participe à des manifestations contre la guerre d’Algérie, qui ont lieu au quartier latin, et qui sont organisées en réalité par l’UNEF (L’Union Nationale des Etudiants de France)5, le syndicat étudiant, dans lequel a pris le pouvoir la tendance chrétienne de gauche. Ce n’est pas du tout les communistes, c’est la tendance chrétienne de gauche qui a animé, pendant au moins quatre ou cinq ans, en milieux étudiant, la lutte contre la guerre d’Algérie. Alors, ces chrétiens gauches (c’est-à-dire la JEC, La Jeunesse Etudiante Chrétienne) ont réussi à noyauter le syndicat d’étudiants, à y prendre le pouvoir en vidant les vieux dirigeants issus des facultés de droit qui étaient réacs, nationalistes, partisans de l’Algérie française. Ils ont complètement changé le syndicat d’étudiants, qui jusque là, après tout, est un syndicat corporatiste de droite et avait été même d’extrême droite très souvent avant la guerre, puisque c’était connu que, dans les années trente, sur le trottoir du quartier latin, les organisation d’étudiants d’extrême droite bastonnaient les communistes et les socialistes, qui étaient minoritaires. Donc là il y a eu un coup d’état de la jeunesse chrétienne qui doit se situer vers 56 ou 57, dans ces années là. Ils ont pris le pouvoir à l’UNEF et ont organisé, assez tôt, malgré tout, des manifestations contre la guerre d’Algérie. En même temps que je faisais mes premières réunions dispersées par les forces de l’ordre, je faisais aussi mes premières manifestations dans la rue, assommées par les forces de l’ordre. Parce que la répression des manifestations, c’était quelque chose à l’époque! Depuis on est devenu douillets. A l’époque on se faisait assommer. On était pas du tout organisés, il n’y avait pas de service d’ordre, il n’y avait rien, on partait du haut du Boulevard Saint Michel en criant ‘paix en Algérie!’, on était 400-500 à peu près, et on se faisait matraquer en arrivant en bas. Les policiers donnaient des grands coups de pèlerine. Ils avaient de grands manteaux qu’ils pliaient sur le bras, comme ça – certains avaient des matraques, mais d’autres avaient ça – et ils tapaient comme ça avec ces pèlerines. Ça a été abandonné parce que c’était très dangereux, quand on ramassait ça dans la gueule on était vraiment sonné.
PH: Et alors, pour confronter cette violence policière, vous ne vous protégiez pas, vous ne vous armiez pas?
AB: Non, à l’époque justement pas; l’armement des manifestations est très tardif. C’est un truc d’ailleurs que Chris Marker explique dans son film Le Fond de l’air est rouge.6 En fait c’est 68 qui a changé ce point, et peut-être les comités Vietnam de base (les CVB) un peu avant...; c’est très tardif l’idée que, si on veut que la manifestation se protège, il faut qu’elle se protège. A l’époque il y avait l’idée on manifeste, voilà, et puis il y avait un côté sacrificiel. On allait se faire casser la gueule, mais bon... [rire].
PH: Un peu dans l’esprit de Gandhi, alors?
AB: Mais sans l’arrière-plan non violent. Nous étions tous plus ou moins favorables à la violence révolutionnaire. Mais quant à la pratiquer, il faudra attendre quelques années. Pour le moment, on se faisait casser la gueule, mais bon, on témoignait comme ça. Tout cela, c’était pour moi un apprentissage de base.
La deuxième étape de cet apprentissage de base est un phénomène tout à fait excentrique, mais qui se situe à la fin de 1960: c’est la grande grève générale en Belgique.7 C’est ça qui va être mon éducation quant au sens du mot ‘ouvrier’. Le reste est guerre anticoloniale, mouvements etc.
En 61 je suis envoyé par mon parti, qui était le PSU (Parti socialiste unifié)8 à l’époque – je vais revenir sur la question organisationnelle – faire un reportage sur la grève. Une formidable grève, une grève générale extrêmement dure, avec des grandes bagarres avec la police: le pays entièrement paralysé, des endroits entiers ou les grévistes ont eux même pris le pouvoir, puisqu’ils ont organisés le commerce, ils ont même crée une monnaie spéciale, etc. J’ai assisté au comité de grève d’un village de mineurs, Forchy. Ce comité était vraiment une instance de pouvoir, un soviet. J’étais avec mes amis belges Roger Lallemand et Pierre Verstraeten.
C’était tout à fait fondamental pour moi, cette affaire. Je crois que je me suis dit, ce jour-là, que j’étais du côté de ces gens là. Voilà. C’était une question très vague et peu articulée mais elle est encore là aujourd’hui, ça je le sens bien. Elle est plus importante dans un certain sens que ces articulations.
PH: Une question de solidarité, d’engagement.
AB: L’idée, subjectivement solide, de la contradiction, l’idée qu’on est d’un côté ou de l’autre, même si ce n’est pas exactement ce qui est formalisé en termes de luttes des classes. C’est quelque chose qui est encore plus originaire que l’analyse de classe, une sorte de choix irréversible. En plus, il y a l’idée du trajet: si on veut être avec ces gens là il faut y aller, aussi. Tu ne peux pas simplement dire abstraitement que tu es là; il faut y aller. Là c’était vraiment un voyage dans un climat, un peu ’insurrectionnel’ – parce que nous on aimait les grands mots – ou plutôt semi-insurrectionnel, mais qui en tout cas était vécu comme insurrectionnel, et qui était très ouvrier, parce que c’était la Belgique des mines, de la sidérurgie. C’était vraiment ouvrier de type ancien, d’ailleurs. Tout le monde a dit après, oui, c’est la dernière grève de cette figure ouvrière qui a disparu.
PH: Et jusque-là Sartre, ton premier maître, aurait pu toujours servir comme point de référence? Une pensée de l’engagement justement?
AB: Sa leçon dominait encore, pour moi, en 61. En 56 il y a engagement pratique en forme de réunions, de contacts, de manifestations, concernant la guerre d’Algérie, et je suis au Parti Socialiste, à la section du 5e arrondissement du Parti Socialiste, avec notamment Emmanuel Terray et Michel Rocard, et Jean Poperen, qui deviendra ministre lui aussi. Je deviens – partout où je vais, je finis pas présider ! – je deviens secrétaire de la section en question, après un coup d’état intérieur qui en chasse un vieux partisan de Guy Mollet. Ensuite la question de la guerre d’Algérie est devenue de plus en plus violente à l’intérieur du parti socialiste, puisque le parti socialiste a pris le parti finalement de basculer complètement du côté de la guerre. Le gouvernement Guy Mollet va relancer la guerre, mobiliser le contingent, pratiquer la torture, désigner un gouverneur général, Lacoste, entièrement complice, et enfin passer le pouvoir aux militaires, en réalité. Donc une politique répugnante dans la tradition social-démocrate.
PH: C’est une première expérience de la trahison? Tu l’as vécu comme une sorte de trahison profonde, ou tout simplement comme une déception?
AB: Nous (Terray et moi, par exemple), nous n’avions pas d’illusions. Nous étions entrés au Parti socialiste pour y rejoindre le courant minoritaire hostile à la guerre d’Algérie, c’était aussi une tactique. Parce que le député socialiste du 5e arrondissement justement, qui s’appelait Robert Verdier, était un type absolument hostile à la guerre d’Algérie, c’était un opposant, comme mon père.9 Mon père était aussi du parti socialiste et était aussi un opposant farouche à la guerre d’Algérie. On rejoignait en réalité, non pas tant le parti socialiste, que le groupe interne au parti socialiste qui cherchait à combattre la guerre. Ce groupe à fini par faire scission, en 1958, évidemment. Dans cette scission il a crée d’abord le Parti Socialiste Autonome, puis le Parti Socialiste Unifié (PSU). Et j’ai été dans toutes les magouilles de ces créations institutionnelles successives, au point que quand je suis arrivé à Reims, je suis presque tout de suite devenu, comme d’habitude, le secrétaire de la fédération de la Marne du PSU.
Il faut donc bien voir que quand se crée le maoïsme français (j’appelle maoïsme français non pas toutes les organisations prochinoises, mais fondamentalement cette nouveauté qu’a été la cristallisation autour du maoïsme d’une partie de l’intelligentsia française concentrée, intense et créatrice), moi je suis un provincial, secrétaire général du PSU de la Marne, écrivain de romans...
PH: ... et flûtiste!
AB: ... voilà. Et donc, assez à côté, vraiment. Ce qui va me ramener dans le centre de gravité de l’activité issue de l’Ecole Normale, c’est deux choses. La première c’est l’arrivée à Reims en 1966 de mon ami François Regnault, qui lui est membre de l’état-major des Cahiers pour l’Analyse, et qui est un copain de Milner, un copain de Miller, un Lacanien. Par ailleurs j’ai continué à lire Lacan; je n’allais jamais aux séminaires mais j’ai continué à lire les livres, les revues etc.
PH: Tu es allé juste une fois au séminaire de Lacan à Sainte-Anne, avec Althusser, et c’est tout?
AB: Moi je suis allé deux fois dans ma vie. Une fois à Sainte-Anne avec Althusser et plus tard une fois avec Jacques-Alain Miller, je pense pendant l’année 67, dans la salle Dussane à L’Ecole Normale. Mais sinon, non. Ma confiance en sa pensée dérive strictement de ses écrits. J’ai déjeuné avec Lacan deux fois aussi, quand même. Parce que à un moment donné (mais c’était plus tard) il me courrait après.
PH: Mais, par ailleurs, étant donné l’importance de l’oral justement dans ta propre façon de faire, est ce que tu as eu des inspirations, des modèles? Comment est-ce que tu as appris à parler comme ça, et à donner des cours et des conférences?
AB: Ecoute, j’ai quand même eu quelques bons profs. Je pense que les profs qui ont été les plus influents sur moi ont été dans l’enseignement secondaire, plutôt. J’ai suivi un cursus particulier, parce que j’étais dans un lycée nouveau, c’est-à-dire dans un lycée qui avait des méthodes pédagogiques nouvelles.
PH: C’est-à-dire avant Louis le Grand?
AB: Ah oui, bien avant Louis le Grand! Louis le Grand était d’un classicisme effrayant. Les profs étaient pour la plupart très mauvais. D’ailleurs la plupart du temps je n’écoutais pas, je faisais une barricade de dictionnaires et je travaillais pour moi, derrière. Non, c’était avant, à Toulouse. A Toulouse j’ai été presque continûment dans un lycée où on accordait énormément d’importance à l’initiative, à l’exposé oral. Dès la classe de 6e on nous faisait faire des grands exposés sur des sujets extrêmement variés. Et en plus j’ai fait du théâtre très tôt et j’ai longtemps pensé que je serais acteur. Quand j’étais en seconde tout le monde considérait que j’allais faire une carrière d’acteur. A cette époque, j’hésitais entre être acteur et être inspecteur des eaux et des forêts [rire], jusqu’à très tard. J’ai passé le bac purement scientifique, pour devenir Inspecteur des Eaux et Forêts. Puis, à la fin de l’été, parce que j’avais lu Sartre, j’ai quand même passé le bac littéraire. J’ai eu en philosophie une note formidable, et cela m’a converti à l’idée de préparer l’Ecole Normale littéraire. Mais pendant tout cet été 1954, j’étais encore en train d’hésiter entre faire le conservatoire et faire l’école des eaux et forêts.
Mais revenons en arrière. Regnault arrive à Reims à la rentrée de 1965. Chose curieuse, presque tous ceux qui étaient reçus premiers à l’agrégation étaient nommés à Reims; moi j’étais premier à l’agrégation en 1960 et j’étais nommé à Reims, et Regnault était premier à l’agrégation en 1964 et il était nommé à Reims aussi. On est devenu très profondément et très grandement amis. Il venait nous voir à la maison etc. – j’étais avec ma femme Françoise à cette époque là – et c’est lui qui m’a raconté les Cahiers pour l’Analyse, le séminaire d’Althusser, les tensions entre les deux. Parce qu’attention! les lacaniens et les althussériens n’étaient pas tout à fait les mêmes. Il y avait des échanges, mais c’était quand même deux groupes.
PH: Alors comment sont lancés les Cahiers pour l’Analyse? Il y a eu des divisions parmi les éditeurs des Cahiers Marxistes-Léninistes? Il y a eu la dispute entre Miller et Rancière?
AB: Oui, il y a eu le fameux procès de plagiat intellectuel intenté par Miller contre Rancière, à propos du concept de ‘causalité métonymique’. Miller a pensé que Rancière lui avait carrément volé ce concept. C’était une histoire pénible, parce que tout les participants était dans le cercle althussérien... Mais malgré tout, avant même l’épisode en question, les lacaniens étaient un petit peu dans leur monde à part. Ils accordaient bien plus d’importance à Lacan qu’au Marxisme, à Althusser etc. Ça s’est envenimé avec l’affaire du plagiat. Finalement, tout ce groupe (Miller, Milner, Regnault...) s’est trouvé absent de Lire le Capital. Ils ont décidé de créer leur propre organisation, le Cercle d’Epistémologie, et leur propre revue, les Cahiers pour l’Analyse. Ils ont maintenu quand même des liens avec Althusser: Althusser y a quand même publié son texte sur Rousseau (CpA 8.1). Et enfin, il y avait déjà le germe d’une tension, qui va devenir plus tard la tension entre les maoïstes (dont Miller et Milner) et Althusser lui-même et les althussériens. Althusser et les althussériens ne vont pas rejoindre les organisations maoïstes. Ils vont rester au parti communiste, qu’il s’agisse de Macherey, Balibar, etc. Il n’y a que Rancière qui va faire, comme toujours, un jeu intermédiaire.
PH: D’accord. Alors quand ils ont créé le Cercle d’Epistémologie, est-ce que l’enjeu était effectivement épistémologique dans le sens large, c’est-à-dire un mélange entre un certain héritage scientifique-philosophique et un certain héritage psychanalytique? Ou plutôt politique?
AB: Je pense que sous le nom de structuralisme ils comprenaient, eux, ce que j’appellerai une certaine interprétation lacanienne du scientisme. Ils cherchaient à trouver dans le scientisme lui-même, dans les formes extrêmes de la pensée formelle, de quoi supporter la théorie lacanienne du sujet. C’est pour cela à mon avis, que le texte ‘La Suture’ de Miller (CpA 1.3) est programmatique. C’est un texte fondamental à cet égard – parce que c’est ce texte qui manifeste le génie synthétique, qu’il faut reconnaître indéniablement à Miller: il montre que chez Frege la reconstruction logiciste de la théorie des nombres dissimule une opération qui ne peut s’interpréter que comme l’opération d’un sujet. Je dirais que l’orientation générale était celle là.
Leurs alliances étaient par ailleurs très larges. Dans la revue, on trouve par exemple Bouveresse, qui va devenir le pilier de la philosophie analytique en France. Donc comme toujours dans la jeunesse, il y a beaucoup de confusion.
Mais enfin, l’opération primitive – et d’ailleurs celle qui m’a séduit moi aussi, comme je l’ai souvent proclamé – c’est cette idée que ce n’est pas parce qu’on s’engage dans la rigueur formelle la plus extrême et qu’on assume la puissance intellectuelle des mathématiques, de la logique etc., qu’on doit pour autant raturer ou supprimer la catégorie de sujet. Je pense que ça, ça a été l’influence philosophique majeure de Lacan. C’est-à-dire la capacité de faire se côtoyer de façon tout à fait étrange une théorie des structures formelles, qu’il a développée comme théorie logique du signifiant, et une théorie de l’aventure subjective.
Je pense que de ce point de vue là, Lacan a réussi là, où dans son effort extrême Sartre n’a pas vraiment réussi. Parce que, à bien y réfléchir, La Critique de la raison dialectique c’est également une tentative de ce genre. Note bien que le sous-titre de la Critique c’est Théorie des ensembles pratiques. C’est un titre emblématique: ‘théorie des ensembles’, c’est le côté des structure formelles, ‘pratiques’ c’est le côté de la praxis constituante, le côté du sujet. La grande différence c’est que pour Lacan et pour nous, y compris pour moi aujourd’hui, les structures, les dispositions formelles, sont en position de condition pour l’éventuel développement de la figure subjective. Alors que Sartre malheureusement est resté dans une théorie génétique. Il veut engendrer les structures à partir de la praxis. Il prend la praxis comme figure élémentaire. Ce qui l’intéresse c’est la genèse de l’histoire monumentale, avec comme seul opérateur en fin de compte, l’interaction des différentes libertés. Le but de Sartre était un peu le même que le nôtre : maintenir à tout prix une théorie du sujet, tout en faisant droit aux sciences humaines, en faisant droit à Braudel, à l’histoire etc. Simplement il a conservé un élément hégélien, qui était un élément génétique. On va engendrer tout ça, on va montrer comment toutes ces figures s’engendrent les unes les autres à partir d’une détermination absolument simple et initiale, qui est la pratique. On va combiner la pratique, la praxis (c’est-à-dire quand même l’intentionnalité de la conscience) on va la combiner avec un seul élément contingent, qui est la rareté. Alors avec un seul élément contingent, la rareté, et l’opérateur de néantisation qu’est la praxis, on doit pouvoir engendrer formellement tous les ensembles pratiques, la sérialité, le groupe en fusion, le groupe assermenté, organisé, le Parti, l’Etat...
Je pense que ce qui fait que ce projet de Sartre n’a pas marché aux yeux de la jeunesse en question – et même de la fraction de cette jeunesse qui dans un certain sens avait le même objectif – c’est le maintien de cette opération de caractère génétique, à laquelle nous n’étions plus en état de croire. C’est-à-dire l’engendrement à partir des simples intentionnalités de la conscience, du système général des structures formelles – on n’était pas en état de croire ça.
Et donc, nous, on a fonctionné à l’envers. C’est-à-dire on assumait d’abord la construction formelle comme telle, le système général des structures, mais on cherchait à voir dans quelle brèche, dans quelle faille, dans quelle disruption de ça, pouvait éventuellement surgir le sujet et la liberté. Jusqu’à aujourd’hui c’est ce que je fais, il faut bien le dire. Il n’y a là rien de compliqué, et c’est ce qui fait, que pour ce public là, Lacan a réussi là où Sartre n’a pas réussi.
PH: D’accord. Et pour ces mêmes raisons, Sartre n’avait pas vraiment un concept de l’inconscient, justement.
AB: Il n’avait pas de concept de l’inconscient, il ne pouvait penser le sujet que comme transparence fondatrice.
PH: Un sujet qui était déjà libre, a priori; qui n’avait pas à se libérer.
AB: Eh oui, qui était déjà libre, absolument. En fin de compte il a fait comme Hegel, il amorce tout avec une dialectique de deux termes. Il y a la transparence fondatrice du sujet libre et puis il y a la contingence de la rareté. Sartre tire les conséquences de cette dualité primitive avec une virtuosité confondante, c’est un livre admirable; je tire mon chapeau devant cette construction. Mais je pense qu’elle ne pouvait pas à cette époque, dans le moment même, trouver auprès de l’avant-garde intellectuelle des jeunes philosophes un écho véritable, parce qu’elle restait hégéliano-génétique.
PH: Il me semble que pour Sartre l’enjeu était toujours la résistance face au fascisme, et ensuite une résistance contre le colonialisme: c’est-à-dire un combat de ‘noir-et-blanc’, si tu veux, un combat entre la liberté et l’oppression. Tandis que pour vous autres, dans les années soixante, il s’agissait de situations où l’ennemi, et le projet, n’étaient pas si faciles à définir.
AB: Je crois que plus profondément Sartre restait attaché à un processus de légitimation de l’Union Soviétique. En 1960 il est encore dans l’idée d’une légitimation du parti communiste et de l’Union Soviétique, c’est-à-dire d’une légitimation de la forme aliénée du processus d’émancipation. Pourquoi la terreur stalinienne? Quand on lit le deuxième tome de la Critique de la raison dialectique, celui qui est inachevé, on s’aperçoit qu’il n’est question que de Staline. Je pense que le problème de Sartre c’était Staline. Je pense d’ailleurs que c’était le problème d’Althusser aussi. Pour eux deux, il y avait un seul problème majeur qui soit à la fois historique et philosophique, c’était Staline. Comment et pourquoi la pratique révolutionnaire marxiste avait-elle pris la forme de l’Etat stalinien ? L’idée fondamentale de Sartre est de montrer comment, aux prises avec la rareté, les procédures de construction constituantes du collectif – dont le moment moteur est le groupe en fusion, la révolte – se sédimentent et s’aliènent inévitablement, sans que cela veuille nécessairement dire qu’il faille les condamner à ce titre. Le point délicat est de reconnaître qu’ il y a une légitimité de cette aliénation. Après il faut savoir comment cette inévitable aliénation peut céder à de nouvelles révoltes, comment le processus de fusion peut être relancé, etc. Mais finalement ça consiste à dire, bon, l’élément stalinien, eh bien, c’est la fraternité-terreur. La terreur est un élément intrinsèque du déploiement organisé de la praxis, à partir du moment où elle est dans l’élément contingent mais irrémédiable de la rareté. Et donc il n’y aura communisme que quand on sera au delà de la rareté. Mais ça c’est entériner l’économisme stalinien, tu vois.
Or la position des jeunes gens à l’époque, c’est bien plutôt ‘Staline c’est fini’. Avec Mao, avec la Révolution Culturelle, autre chose commence à l’intérieur même des pays socialistes. Donc Staline n’est plus notre problème. Nous on est à l’école des Chinois qui disent ’Staline, oui bon, il a eu des mérites, il y a du positif et du négatif, de toute façon on verra ça dans mille ans.’ Il est tout à fait caractéristique que les Chinois disent qu’il ne faut pas constituer Staline comme problème. Si on constitue Staline comme problème, on est fichu. Car le vrai problème, c’est de constituer notre scène politique, qui revendique l’héritage socialiste, qui assume cet héritage absolument (y compris Staline d’ailleurs), mais qui est au-delà.
Et très bizarrement c’est là que je vois la source de ce qui a toujours stupéfié les observateurs hostiles et étrangers, à savoir cette étrange fusion du lacanisme et du maoïsme qui a caractérisé la fraction la plus intense et la plus créatrice de la jeune intelligentsia française entre 1965 et 1980, voire bien au delà (puisque j’appartiens à cette généalogie). Or la fusion du lacanisme et du maoïsme est tout à fait pertinente. Parce qu’il est vrai que c’est Lacan qui a produit le dispositif alternatif à celui de Sartre, concernant le rapport des structures et de la liberté. Pour cette raison, c’était les lacaniens qui, du point de vue de la politique, étaient prêts à recevoir le maoïsme, comme précisément une hypothèse qui ne prétendait pas légitimer l’aliénation et la terreur par les pesanteurs de l’économie et de l’état socialiste. Une hypothèse qui disait qu’il faut utiliser les contradictions internes, les nouveautés subjectives, les révoltes, pour développer une critique radicale de l’état socialiste lui-même. Evidemment ça marchait dans ce sens là. Eh bien moi j’ai toujours trouvé absolument rationnel et pas du tout contingent et absurde que ce soit les lacaniens qui soient devenus maoïstes.
PH: Tout à fait. Et après 68 Sartre lui-même s’est rallié à une sorte de maoïsme...
AB: Sartre a été rallié au maoïsme version ‘gauche prolétarienne’ tardivement, par un lien personnel avec Benny Lévy. A mon avis il s’était rallié non en remaniant sa philosophie, mais dans des conditions de décrochage entre le protocole de sa philosophie et ses positions engagées. Entre son maoïsme ‘gauche prolétarienne’ et son Flaubert il n’y a pratiquement aucun rapport. On voit bien qu’il a écrit L’Idiot de la famille pour maintenir en vie son dispositif conceptuel, et que, d’autre part, il s’est tourné vers le maoïsme parce qu’il était sensible (c’est une de ses grandes qualités) à ce qui se passe, à ce qui est nouveau. Il a vu que cette fois, le parti communiste, c’était fini.
PH: Tu disais, il y a un moment, que l’opération essentielle des Cahiers, c’était de penser ensemble le primat du formalisme mathématique, scientifique, avec la catégorie du sujet. Je reconnais là les priorités de Miller, de Milner, de Regnault, de Duroux aussi, et d’autres... Mais pas tellement le Badiou de 1967! Ton article ‘Marque et manque’ (CpA 10.8) se présente comme critique de ‘La Suture’ de Miller, sa logique du signifiant. Tu refuses l’idée d’une ‘logique’ qui pourrait penser le sujet (le non-identique). Tu insistes sur l’aspect ‘psychotique’ de la science, l’expulsion de son domaine de toute trace d’un sujet. Pour l’instant, le sujet est forclos. A travers et après 68, bien sûr, le sujet devient la catégorie centrale de ta pensée. (Tu reprends, peut-être, un aspect de l’inspiration sartrienne?). Mais comment concevais-tu la question à l’époque de ta participation dans les Cahiers?
AB: En 1967, je suis en effet à l’extrême pointe d’un formalisme strict. J’ai poussé beaucoup plus loin que mes amis l’étude détaillée des derniers développements de la logique mathématique, notamment des secteurs en pleine effervescence que constituent la théorie des ensembles (le théorème de Cohen) ou la théorie non-standard des nombres (j’ai écrit là-dessus un papier dans les Cahiers, justement). L’enracinement platonicien de ma pensée, jamais démenti, même quand j’étais un sartrien convaincu, me fait parfois osciller entre une priorité radicale de la question du Sujet, et une prééminence de l’Idée, ou de la vérité, dont la substructure intelligible, le modèle le plus pur, se trouve dans le vie historique des mathématiques. Subjectivement, cela veut dire que la politique et la mathématique constituent les deux « appels » majeurs du côté de ce que je nomme les conditions de la philosophie, et que ces deux appels sont toujours en tension. Je ne trouverai la forme conceptuelle de cette tension que quand j’aurai compris que les plus considérables événements mathématiques peuvent aussi bien donner la clef du processus subjectif des vérités. Ce sera tout le but de l’Etre et l’Evénement, avec le croisement, dans le concept de généricité, de la mathématique du multiple pur, et du trajet subjectif post-événementiel qui construit une vérité. En 1967, juste avant la tempête, je médite du côté des structures formelles. Pendant les dix ans qui suivront, je serai plutôt du côté de la subjectivité politique. La philosophie commence réellement pour moi après ces oscillations, au début des années quatre vingt.
PH: J’aimerais revenir un peu au statut de la science, du structuralisme etc. Dès le premier numéro des Cahiers, on insiste sur la science. Et la science en gros c’est Galilée, Descartes et la formalisation mathématique, cette ‘littéralisation’ de la mathématique qui va devenir, comme tu sais beaucoup mieux que moi, de plus en plus intense chez Lacan. Je me demande s’il n’y avait pas dans cette ambition formalisante, cette recherche singulière du clair et du distinct, l’équivalent d’une certaine manière de cette clarté primordiale de la conscience qu’on trouve chez Sartre, justement. Chez Sartre il y a la conscience qui s’illumine dès le départ; ici, il y a le travail scientifique, la ‘Science’ avec un ‘S’ majuscule, qui se clarifie dans sa formalisation littérale et primordiale. Il n’y a justement pas de pluralité des sciences, une pluralité historique et technique, comme il y avait chez Bachelard ou chez Canguilhem lui-même (qui sont quand même parmi des maîtres qui inspirent les Cahiers). Entre Canguilhem et les Cahiers ce n’est pas tout à fait évident, le lien entre les deux.
AB: Non, il n’est pas du tout évident, je suis absolument de ton avis. Je pense que ce qui a été retenu de Canguilhem et de Bachelard se limite à deux choses. Pour moi ça se limite d’abord à l’idée d’une relation constitutive fondamentale entre la philosophie et la science. Ça c’est par soi-même anti-sartrien, quand même. On raconte que Sartre disait souvent: ‘la science, c’est peau de balle, la morale, c’est trou de balle’. Pour nous, héritiers de la tradition épistémologique française, il n’est pas possible que la philosophie échappe à sa confrontation avec la discipline scientifique. Il y a ce premier point, qui est à la fois prospectif et réactif. Il est prospectif parce qu’il crée une situation nouvelle, grossièrement nommée ‘structuralisme’. Mais il est aussi réactif parce que les gens comme Sartre et dans un certain sens déjà Bergson avaient tenté d’échapper à cette tyrannie de la science. On a là un élément cyclique, qu’on observerait très bien dans l’histoire de la philosophie française, entre les tendances vitalistes et existentielles et les tendances formalistes et conceptuelles. On voit très bien cela, au début du vingtième siècle, dans le couple Bergson-Brunschvicg. C’est évident que des gens comme Bachelard, Canguilhem, mais aussi Cavaillès et Lautmann, et finalement Desanti, et finalement moi aussi, sont des gens qui d’une certaine manière sont dans la descendance du courant brunschvicgien de la philosophie française. Alors qu’en vérité Sartre, qui détestait Bergson, était quand même bien plus dans la filiation bergsonienne Donc il y a ce premier point, de mettre en selle un lien indémêlable entre la philosophie et la science.
Le deuxième point qui a été retenu, c’est que la science, loin de consolider l’empirisme, est anti-empiriste. Ça c’est la rupture absolue de l’épistémologie française avec l’épistémologie anglo-saxonne. On voit très bien chez Bachelard, mais chez Canguilhem aussi, que non seulement la science n’est pas empiriste, mais qu’elle est la principale école du non-empirisme, qu’elle est la principale critique de l’empirisme lui-même. Qu’il s’agisse de Galilée, Descartes, etc., et même de la conception canguilhemienne des sciences de la vie, ce sont des décisions axiomatique, c’est la construction conceptuelle, qui prescrivent l’expérimentation empirique et pas le contraire. C’est toute la théorie de Bachelard: les appareils scientifiques sont de la théorie incarnée, l’expérimentation est toujours un artifice, les hypothèses théoriques et formelles viennent d’abord. Les historiens et philosophes des sciences, comme Koyré, viennent à la rescousse de cette vision. Il prouvent qu’en réalité Galilée n’a jamais fait une seule expérience, que d’ailleurs s’il les avait faites elles auraient contredit ses décisions conceptuelles etc. Ça c’est le deuxième point: la philosophie est d’autant plus proche de la science que la science elle-même est théorique et non empirique. L’épistémologie française, dans laquelle il faut aussi inclure Meyerson, est conceptualiste et anti-empiriste. C’est pour ça d’ailleurs qu’elle est entièrement ignorée et contestée dans le milieu anglo-saxon, qui l’a toujours considérée comme dogmatique, typiquement française, c’est-à-dire a prioriste, voire idéaliste. Un peu d’ailleurs comme tu me considéres moi-même encore, cher Peter, dans ton formidable livre sur moi: tout ça est très beau, mais c’est comme la monarchie absolue, entièrement fait d’a-priorisme volontariste et absolutiste, et fondé sur une sorte de mépris de la réalité sensible.
Sans doute nous, structuralistes, nous partagions cette vision conceptualiste. Mais les différences que tu signalais sont évidentes. Pour Bachelard et pour Canguilhem le centre de gravité de ce qui est appelé science reste la physique. Même Canguilhem qui s’occupe surtout des sciences de la vie, on sent bien que son paradigme scientifique c’est la physique, parce qu’il est directement un compagnon de Bachelard. Ce qui importe c’est donc les discussions sur la relativité générale, sur les origines de la physique, sur les rapports entre conceptualisation et expérimentation etc. Tandis que pour Lacan, et pour les lacaniens que nous sommes, en réalité le centre de gravité de la science, c’est la mathématique. Comme dit Lacan, ‘notre but, notre idéal, c’est la formalisation’.
PH: Entendu. Jusque là, ce que tu décris marche très bien avec Lacan justement, et son refus de tout ce qui est de l’imaginaire, de l’adaptation du sujet à son environnement ‘naturel’ et social, etc.
AB: Il ne faut pas oublier qu’à l’époque, il y a le motif important des ‘sciences humaines’. Nous pensons que la formalisation peut s’étendre aux sciences humaines. Lévi-Strauss n’a-t-il pas appelé la théorie des groupes au secours de la théorie des relations de parenté ? Or la science humaine paradigmatique est devenue la linguistique. Et la science humaine paradigmatique étant la linguistique, il y a une proximité beaucoup plus grande et beaucoup plus immédiate avec le logico-mathématique. C’est exactement là que va s’installer la figure lacanienne de la logique du signifiant. Elle va être en quelque sorte entre la langue naturelle et la formalisation.
PH: Tout à fait, parce que Miller explique, ‘l’épistémologie à notre sens se définit comme histoire et théorie du discours de la science’. Alors justement, de la science d’une part et du discours de l’autre.
AB: Oui, absolument. C’est la discursivité qui va être la catégorie fondamentale.
PH: Et même dans ton ontologie par exemple, dans L’Etre et l’événement.
AB: Tout à fait. J’y affirme que les mathématiques sont le seul discours recevable sur l’être en tant qu’être.
PH: Ce me frappe peut-être le plus dans le projet des Cahiers, c’est l’idée qu’on puisse avoir comme ça une certaine compréhension de la science où c’est les mathématiques qui dominent, d’une part (et donc aussi finalement l’idée qu’il n’y a qu’une science, la Science), mais aussi, d’autre part, qu’on puisse comprendre l’inconscient et ‘le subjectif’ avec cette science là – c’est-à-dire, classiquement, tout ce qui échappe donc à la mesure et la quantification. Ce n’est pas facile à expliquer à certains de mes collègues anglo-saxons!
AB: C’est le cœur de la question. Mais c’est normal qu’ils résistent à ça. Maintenant que je connais un peu votre monde [rire] à force d’y aller, je vois bien que chez vous l’empirisme est une seconde nature, et je ne le dis pas d’une façon critique. C’est une leçon pour moi toujours renouvelé, toujours intéressante, parce que ça donne toujours un système d’objections qui après tout est très solide et qui est au cœur de la question.
Si on assume qu’il y a une science et que cette science en fin de compte est ce qui touche au réel; si comme le dit Lacan, le réel est ‘l’impasse de la formalisation’, ce qui veut dire qu’il n’est atteint que dans l’élément de la formalisation, alors comment pouvons-vous avoir un accès quelconque à ce que se soustrait à l’évidence de cette scientificité ? A ce qui fait exception à la formalisation ? Au point qui est ‘hors structure’, celui que j’appelle, dans Théorie du sujet, le ‘horlieu’? Cette exception, c’est l’inconscient, le sujet pur, la rupture, la révolution...
PH: ...le manque...
AB: Oui, le manque, la grâce, l’évènement...La philosophie française est quasiment structurée, dans ce qu’elle a de créateur depuis quarante ans ou plus, par le système des noms qu’elle accorde à la figure de ce qui se met en exception, de ce qui se produit en exception d’un dispositif, dispositif qui par ailleurs est conçu comme relevant de la science. Même si c’est une métaphore, le réel est quand même conçu, en fin de compte, au régime de la science et non plus conçu au régime de la perception spontanée, comme les phénoménologues proposaient de le penser, comme corrélat de la conscience. Le monde, pour nous, relève de l’objectivité scientifique, il est indifférent à l’humanité etc. Et cependant c’est au régime de l’exception à cela, justement, que quelque chose est saisissable, qui maintient quand même la figure du sujet, la figure de l’universalité. Il y a là un mouvement général, dans lequel nous sommes tous d’accord sur le fait que le monde (ou ce qui est) est disposé dans une objectivité formelle, étrangère à la conscience, valant pour soi même. On pourrait donc croire à un pur scientisme. C’est peut-être comme ça que Ray Brassier, par exemple, interprète le mouvement de la philosophie française. Mais pour moi et bien d’autres, c’est justement parce qu’il y a cette objectivité formelle qu’on peut chercher et définir le point qui l’excède. Et en ce point, se tient le Sujet, ou sa possibilité.
PH: D’accord. Mais tu connais bien l’objection ‘anglo-saxonne’ (et par ailleurs hégélienne). Tant mieux pour les mathématiques, on dirait, et on comprend ce que veulent dire Duroux et Miller quand ils parlent (après Frege) strictement de 0 et de 1. Mais comment passer de cela au liberté conditionnée d’un sujet, c’est-à-dire d’un être doué d’une volonté, un être vivant, sexué, un être qui a un corps, qui existe dans le monde naturel et historique, qui se socialise dans certaines conditions, etc.? Ne faut il pas avoir, alors, des opérateurs de médiation qui permettent le passage entre les mathématiques et les situations naturelles, ’humaines’ ou historiques? Que sont ces opérateurs? La psychanalyse, conçue comme elle est par les lacaniens des Cahiers, est-elle capable, avec finalement une seule théorie formalisante du signifiant, à rendre raison de tout cet aspect empirique?
AB: Je ne crois pas du tout que la psychanalyse en soit capable, et du reste elle ne s’intéresse pas à ce problème, parce que ce n’est pas son objectif. Elle est une discipline clinique, et non un protocole de connaissance du sujet empirique. Je pense qu’elle a simplement besoin, elle, des conditions qui lui permettent de construire la scène particulière et limitée dans laquelle se déploie la cure. Elle n’est pas une théorie du monde. Elle est tout le contraire d’une théorie du monde. Même les opérateurs compliqués de Lacan qui ont un air de généralité, à la fin des fins, leur filtre c’est la construction d’un dispositif expérimental particulier, pour une procédure particulière.
PH: Le sujet face à son discours, etc.
AB: Oui. Si par contre on parle de philosophie, je dirais, oui, il faut une médiation, il faut qu’entre la multiplicité pure que pense le formalisme mathématique et tout ce qui a un corps (y compris le Sujet, qui a aussi un corps), opère une localisation singulière, qui autorise à parler, non plus seulement de l’être, mais d’un monde. Tu sais que je nomme cette médiation un transcendantal. De ce point de vue là, et c’est ce que j’ai dit dans la discussion très intéressante sur Logiques des mondes avec Andrew Gibson [à Londres, en 2007], il est vrai que Logiques des mondes, où apparaît le concept de transcendantal, puis celui de corps, est partiellement une réponse à des objections anglo-saxonnes de longue date, dont les premières ont été faites par Peter Hallward il y a presque quinze ans.
PH: Alors je n’étais pas du tout le premier je crois, et tu y travaillais déjà...
AB: Il y avait eu un peu avant des objections françaises, c’est vrai.
PH: Jean-Toussaint Desanti...
AB: Lyotard et Desanti.10 Mais les objections françaises étaient d’un autre ordre. Les objections françaises, en réalité, portaient sur deux points. D’abord, sur le fondement mathématique: Desanti remarquait que je ne tenais aucun compte d’une mathématique en quelque sorte sans objet, ramenée à la pure relation: la théorie des Catégories. J’ai travaillé longtemps ce domaine, et cela m’a été très utile pour forger le concept de transcendantal. Lyotard remarquait que dans ma théorie de la ‘nomination événementielle’, je me donnais un quasi-sujet (celui qui donne le nom à l’événement) avant le ‘vrai’ sujet (celui qui tire les conséquences de l’événement). Ce qui m’a amené à des transformations très importantes de ma théorie de l’événement. Ceci dit, restait la question première, de provenance anglo-saxonne: il faut bien qu’il y ait un système de médiations permettant de penser la différence entre l’être pur et la mondanité comme telle. Objection qui peut se présenter sous la forme ’oui, mais comment vous passez de la mathématique à la physique?’ Le dispositif général de Logique des mondes, répond plus fondamentalement à ces objections qu’aux autres.
PH: Il y a toujours des aspects de Logique des mondes que je n’arrive pas à maîtriser. Je t’ai déjà posé la question: tout ce qui est de l’ontique, tout ce qui est de l’empirique, si tu veux, est toujours d’une certaine manière aussi absent que jamais. Malgré tout cet appareil assez baroque...
AB: Parce que tu veux autre chose dans l’empirique que la configuration particulière des intensités. Pour moi, un monde, c’est deux choses : la localisation des objets, et l’intensité de leur présence. Tu veux vraiment autre chose ?
PH: Oui.
AB: Je crois alors que tu demandes beaucoup. Admettre le complexe localisation-intensité pour définir des objets, c’est déjà plus que ce que la physique admet, la physique actuelle. Car la physique actuelle considère que la composition de toute empiricité ontique, ce n’est même pas des différences., pas même des intensités.
PH: Des différences évanouissantes.
AB: Des différences évanouissantes, oui. Et comme tu sais, la physique quantique est proprement incompréhensible si on tente de la séparer du formalisme mathématique. En fait, ce que nous dit cette physique est bien plus radicalement ‘anti-empiriste’ que moi. J’accorde plus au monde et à son réel que la physique d’aujourd’hui. Après on va me dire, ‘mais où est l’empirique?’, Eh bien, il est dans le transcendantal, dans le complexe localisation-intensité, et ce n’est déjà pas mal, franchement! [rires] Je ne peux quand même pas aller en philosophie jusqu’à une déduction du chat ou de la tortue! En plus j’ai le sentiment que ta question porte moins sur l’objectivité que sur quelque chose qui concerne la vie, l’expérience vitale.
PH: Une question qui passe par le vécu.
AB: Alors en fin de compte ça rejoint quelque part la discussion avec Deleuze. Les anglo-saxons comprennent mieux Deleuze à cause de ça. Il y a chez une espèce d’évidence, quasi empirique, de la vie comme telle. Mais moi, la vie, je n’y crois pas des masses, quand même. Je crois fermement que chaque fois qu’on parle de la vie, on est comme disait Spinoza dans ‘ignorantiae asylum’.
PH: Ça c’est une discussion pour une autre fois! Revenons un petit peu à la question du scientisme, du structuralisme, ce mélange entre la formalisation mathématique et l’inspiration lacanienne. Regnault, Miller, Milner, ils s’orientaient tout d’abord par rapport à la psychanalyse?
AB: Ils n’étaient pas psychanalystes, à l’époque, et un seul l’est devenu : Miller. Mais ils étaient tous profondément marqués par l’enseignement de Lacan. La tentative des Cahiers pour l’Analyse a été au fond de constituer un lacanisme indépendant, qui ne serait pas immédiatement lié à la psychanalyse en tant que telle.
PH: Miller, il insiste là-dessus dès le départ, il commence son discours sur ’La Suture’ (CpA1.3) en se présentant comme non-psychanalyste.
AB: Exactement, et d’ailleurs il s’est autocritiqué plus tard. Il m’a souvent dit ‘on a essayé de déclarer qu’on était plus forts que Lacan, puisque on pouvait faire un lacanisme sans passer par ces histoires de psychanalyse. Mais en réalité c’était outrecuidant et le destin était quand même que tout ça retourne à la psychanalyse’. Il a fortement organisé ce retour après la parenthèse maoïste, à partir de 1972. Il est vrai que sur le moment, vers 1966, Lacan nous a vus comme une sorte de dissidence. Jacques-Alain m’a dit plusieurs fois que Lacan avait été un peu fâché des Cahiers pour l’Analyse. Il les voyait comme une tentative présomptueuse d’échapper aux nécessités de l’école de psychanalyse.
PH: D’accord et c’est plutôt Leclaire qui y figure comme une sorte de maître, direct en tous cas.
AB: Je n’ai pas suivi dans le détail le rôle de Leclaire. Ce qui est sûr c’est que Leclaire a incarné une autre orientation, qui assumait le primat de la clinique. En plus après 68 c’est lui qui a pris la direction du département de Psychanalyse à Paris 8 - Vincennes. Il y a finalement eu une scission entre Leclaire et Lacan. Mais c’est un pan de l’histoire que je connais mal. Je n’ai jamais vraiment suivi l’histoire interne du lacanisme, parce que je n’ai jamais été dans aucune des organisations psychanalytiques et je n’ai pas eu de lien organisé avec Lacan lui-même.
PH: D’accord. Remontons maintenant un peu dans l’histoire personnelle. Au milieu des années soixante, vous êtes ensemble à Reims un moment, Regnault, qui est déjà actif dans les Cahiers, et toi. Quand est-ce que tu as décidé de faire parti du Cercle?
AB: Je me suis trouvé à ce moment là sollicité un peu par tout le monde, à partir de 66. Donc après ce sont les années 66-67 qui sont décisives. On peut d’ailleurs les considérer comme les années d’apogée de ce qui a été appelé le structuralisme, de tous les côtés.
PH: Il y a Les Mots et les choses [de Foucault]...
: ... et les trois livres fondamentaux de Derrida; il y a le séminaire de Althusser, il y a Lire le Capital [d’Althusser et ses étudiants], il y a l’enseignement de Lacan à l’École Normale Supérieure, il y a la création des groupes maoïstes dissidents dans la politique, il y a la création des Comités Vietnam de Base, tout à fait importants, puisque ça a été la première cellule pratiquant un militantisme de type nouveau. Les Comités Vietnam de Base, dépendaient de l’ UJC-ML, création de la scission maoïste dont nous avons parlé. C’était les premiers qui ont, en dehors de l’autorité d’un parti, constitué un militantisme direct, en milieu populaire, puisqu’ils sont allés dans les marchés des banlieues faire de la propagande contre la guerre de Vietnam etc. Tout ça c’est 66-67. Des années de formation capitales! Des années extraordinaires! Il y a une intensité fabuleuse de ces deux années. Comme le dit Patrice Maniglier, l’année miraculeuse de ce qu’on appelle le structuralisme, c’est 1967.
PH: 68 ça ne surgit pas comme ça, du vide.
AB: Pas du tout. Le comble de l’action s’est articulé sur le comble de la pensée. Je suis alors requis, dans ma retraite rémoise. Althusser m’a d’abord demandé de faire un cours à l’École Normale, ce que j’ai fait sur la question de la littérature et qui a donné l’article des Cahiers Marxistes-Léninistes sur les rapports entre littérature et idéologie. Plus tard. Althusser m’a demandé de participer à son cours de philosophie pour scientifiques, mis en place en 67.
PH: Ça c’était Le concept de modèle?
AB: L’histoire de cette conférence sur le concept de modèle est une véritable allégorie du moment. Il devait y avoir deux séances: la première a eu lieu et la deuxième n’a pas eu lieu, parce qu’elle devait avoir lieu juste au début de Mai 68 ! Ca, c’est le côté Althusser. Et puis symétriquement, si je puis dire, Regnault m’a présenté à Jacques-Alain Miller, et finalement je suis entré dans le groupe dirigeant des Cahiers pour l’Analyse. Le groupe était composé à l’époque de Grosrichard, Milner, Miller, Regnault et moi. On était cinq. C’est donc l’époque où j’ai commencé à écrire, moi, les articles pour Les Cahiers pour l’Analyse, à savoir ‘Marque et manque’ (CpA 10.8) et puis celui sur l’analyse non-standard (CpA 9.8).
PH: Il me semble que ces deux numéros des Cahiers là sont différents des autres, quand même C’est comme si toi-même tu les avais dirigés, ces deux là.
AB: Je pense que mon influence à l’époque a été assez grande, pour la raison que pendant ces deux années là, j’étais très lié, de façon amicale, non seulement avec François Regnault, mais aussi avec Jacques-Alain Miller. Vu d’aujourd’hui, je pense – mais c’est une longue histoire – que cette amitié, que Jean-Claude Milner a vécu comme une séparation et une menace, est à l’origine de sa longue haine contre moi. L’origine subjective! Cette haine a connu des éclipses, et même des renversements en amitié, notamment dans les années quatre vingt, mais dans le fond elle perdure.
PH: Ah.
AB: En 69-70, cependant, Milner et Miller se sont retrouvés dans la Gauche Prolétarienne, et ont écrit ensemble, contre moi et les amis (Natacha Michel, Sylvain Lazarus...) avec lesquels nous fondions l’UCFML, un article très venimeux.
PH: Je ne connais pas ces articles de la Gauche Prolétarienne.
AB: C’est un article qui a paru, je crois, dans l’ultime forme des Cahiers Marxistes-Léninistes, celui où il y avait le grand titre ‘De la révolte anti-autoritaire à la révolution prolétarienne’. En tout cas, là dedans il y a eu un grand article contre la brochure fondatrice de l’UCF-ML. Dans ce temps là, l’amitié entre Miller et Milner a été restaurée, et j’en ai été banni, pour cause de grave divergence politique.
Mais revenons aux deux derniers numéros des Cahiers. Ils ont sans doute été assez marqués par ma proximité avec Miller, donc influencés par moi certainement, par la connaissance technique que j’avais des formalismes les plus récents. Mais influencés aussi par l’évolution de Jacques-Alain Miller lui-même, et influencés par le contexte général. En plus ces deux numéros apparaissent d’une manière plus officielle, parce qu’ils ont été édités par le Seuil, alors qu’avant on était dans la fabrication artisanale; et enfin ils ont étés diffusés trop tard, en tout cas un d’entre eux a été diffusé après 68.
En 69. Mais tout le travail a été fait avant mai 68?
AB: Tout le travail a été fait avant. Les ultimes péripéties des Cahiers pour l’Analyse ont consisté après 68, je pense fin 68 ou début 69, en une ultime réunion du comité de rédaction. Grosrichard était absent, mais il y avait Miller, Milner, Regnault et moi. On s’est réuni alors que Miller et Milner étaient très fortement engagés dans la Gauche Prolétarienne. Moi je n’étais pas dans la Gauche Prolétarienne, mais nous n’avions pas encore créé l’UCF-ML. Donc j’apparaissais comme maoïste indépendant. J’étais encore au PSU, où j’animais une tendance maoïste qui a ensuite fait scission et qui a rallié l’UCF-ML. Dans cette réunion il s’agissait de savoir si on continuait quand même, dans ce nouveau contexte politique, les Cahiers pour l’Analyse, ou si on renonçait. Jacques-Alain avait une position hésitante, comme très souvent; Regnault et moi on était plutôt pour continuer. J’ai fait des propositions de continuation, en disant que, sommes toutes, il y avait une partie des questions théoriques qui pouvaient être mise à l’abri des questions politiques immédiates. Et Milner était violement contre. Il pensait que tout ça n’avait plus aucun sens etc. Il a été particulièrement odieux avec moi. La réunion était très difficile. La situation était tendue, et cette réunion n’a pas abouti. C’est de cette réunion que date la fin du projet des Cahiers pour l’Analyse.
PH: Et à l’époque vous aviez déjà des idées pour des prochains numéros en tête?
AB: Il y avait eu le projet d’un numéro, je pense, qui était sur l’idée de hiérarchie, à laquelle Jacques-Alain tenait beaucoup, parce qu’il était très instruit en ce qui concerne la théorie de types, la hiérarchie des langages chez Russell – peut-être que Jacques-Alain se souviendra mieux que moi. Il y avait un ou deux projets comme ça, qui avaient été discutés avant. Mais on ne se voyait plus guère depuis mai 68. Parce que Jacques Alain, quand 68 a éclaté, lui, était à Besançon, moi j’étais à Reims, et la réquisition politique était d’une telle intensité qu’on ne se voyait plus. Donc on a fait une réunion qui a été une réunion ad hoc, pour traiter ce problème là. Elle avait eu lieu chez Regnault, elle a été à la fois violente et confuse, et on allait forcément vers une conclusion négative.
PH: Parce qu’avant ça, en 66, 67 il y avait des réunions régulières?
AB: Oui, oui, il y avait des réunions régulières en gros tous les mois, un peu moins un peu plus, ça dépendait les moments – des réunions d’ailleurs terriblement fatigantes, parce que Jacques-Alain était extraordinairement tatillon, avec des discussions infinies que Regnault raconte avec virtuosité, qui portaient uniquement sur la forme et la couleur de la couverture, et qui duraient des heures et des heures; il était maniaque sur ce type de question!
PH: [rire] D’accord. Et comment avez-vous décidé les sujets des numéros, qui sont assez éclectiques?
AB: Les numéros étaient décidés à partir d’une espèce de thématique centrale, et puis après c’était un peu par opportunité, des choses qui avaient été demandées avant ou qui arrivaient à ce moment là, des choses dont on disait ‘ce serait intéressant d’en parler’...
PH: ... par exemple le texte de Derrida était plus long que prévu...
AB: Voilà, c’est ça.
PH: Un problème qui va durer toute sa vie... Y avait-il une grande différence entre le comité de rédaction, et le Cercle d’Épistémologie en tant que tel?
AB: A mon avis, dans le période où j’ai participé, le Cercle d’Épistémologie était mort, une coquille vide. Dans la période où j’y étais, en réalité, je n’ai eu aucun contact avec Bouveresse, avec Duroux une ou deux fois, Grosrichard n’était plus là, et tous les autres je ne les ai jamais vus. Le groupe Jacques-Alain Miller, François Regnault, Milner et moi, on décidait tout. A mon avis, le Cercle d’Épistémologie existait seulement quand tous ces gens étaient ensemble à l’École Normale Supérieure. Parce que là, à l’époque dont je te parle, c’est-à-dire 67-68, ils n’étaient plus à l’École, aucun d’entre eux.
PH: Grosrichard à l’époque avait déjà trouvé son sujet, Rousseau; ensuite son bouquin sur le 18e siècle a été traduit en anglais, par Verso justement, il y a quinze ans déjà.
AB: Grosrichard, je n’ai jamais eu de rapport véritablement suivi avec lui. Je l’ai re-rencontré après, au Maroc en particulier. C’est quelqu’un qui est un esprit fin et original. mais qui ne jouait pas un rôle important dans tout cela.
PH: Regnault est toujours un camarade de travail, n’est-ce pas? Vous travaillez toujours ensemble dans le théâtre?
AB: Il y a eu des hauts et des bas, tu sais, parce qu’on s’est quand même beaucoup fâchés sur l’ensemble des questions concernant musulmans, israéliens, palestiniens etc.
PH: Lui aussi?
AB: Ah oui. On a eu des accrochages sur la question du foulard islamique très tôt, il y a dix ans.
PH: Il n’est pas d’accord avec ton article là-dessus par exemple?
AB: Pas le moins du monde, il est absolument contre le foulard, il maintient des positions réactionnaires là-dessus. Et il est très pro-sioniste. Il l’est devenu, il ne l’a pas toujours été. Il accepte l’idée que l’adversaire d’aujourd’hui c’est l’islamisme. Alors, il y a des hauts et des bas, par exemple quand il est venu au rassemblement qu’on a fait le 22 avril sur l’amitié avec les étrangers, il est venu dans une volonté de rapprochement... Il est tiraillé par des amitiés contradictoires. Au fond, nous n’avons jamais été vraiment frères en politique, alors que sur mille autres questions, c’est un ami précieux. Il est d’un subtilité et d’une vivacité stylistique extraordinaires ! Mais dès qu’il s’agit de politique, il suit plutôt l’air du temps. En vérité, il ne croit pas à la politique, il trouve que la démocratie parlementaire, c’est déjà pas mal...Mais je l’aime, même quand je ne le vois pas.
PH: En Angleterre cette question du foulard se comprend mal; notre situation n’est pas moins raciste, mais ça se manifeste d’une autre manière, plutôt économique que ‘culturelle’.
AB: Mais il y a la question de la burka en Angleterre; j’ai été frappé qu’il y ait des gens qui soulèvent cette question maintenant même en Angleterre. Ça m’intéresse beaucoup parce que cette affaire a joué ici un rôle précurseur. Je me souviens très bien quand il y a eu, mais il y a vraiment très longtemps, c’était vers 95, il y a quinze ans, les premiers ‘incidents’. Des filles ont été convoquées au lycée parce qu’elle portait un foulard. C’était bien avant la loi votée interdisant ces prétendus ‘signes confessionnels’. J’avais tout de suite trouvé que c’était une affaire absolument symptomatique, et j’étais stupéfait à l’époque, de voir que des gens comme Regnault, comme Milner, montaient sur de grands chevaux là-dessus. Dès cette époque, Milner a été d’une violence invraisemblable là-dessus. Moi et l’Organisation politique, nous avons pris position sur ce point tout de suite, contre toute ségrégation, toute stigmatisation des jeunes filles, contre leur exclusion, et nous avons été très vite dans un isolement considérable.
A mon avis cette affaire a des racines très profondes dans le milieu petit-bourgeois intellectuel. Elle montre, dès les années quatre vingt et quatre vingt dix, un affaiblissement subjectif et politique considérable, qui a finalement conduit à l’élection de Sarkozy. Ça commence là, parce que c’est des gens qui normalement avaient toujours été, jusqu’à présent, solidaires, pas forcément de façon très militante, mais solidaires, des ouvriers étrangers; c’était quand même un vaste accord, chez les intellectuels. Et là, c’est fini.
PH: Revenons pour terminer sur les Cahiers. Je voulais te demander si tu regrettes le fait que ce se soit terminé comme ça, de manière assez brutale? A plein d’égards on dirait que par la suite tu t’y es revenu, tu as repris les questions de formalisation, de la logique, la structure, etc., déjà dans Théorie du sujet (1982) et bien davantage après. Comment conçois-tu le projet aujourd’hui? Maintiens-tu toujours une certaine fidélité à l’ambition des Cahiers?
AB: Je crois que philosophiquement cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Ce qui a liquidé les Cahiers pour l’Analyse, c’est la politique. Or ce n’était d’aucune façon une revue de politique. Les Cahiers étaient hors d’état de supporter la tension politique ouverte à partir de 68, c’est évident. Souvenons-nous qu’il y a eu alors une dizaine d’années dans lesquels tout le monde n’a fait que de la politique.
PH: Et toi aussi tu t’es engagé plus ou moins entièrement dans la pratique politique? Tu as laissé tomber pour un moment les questions de formalisation, etc.?
AB: Dans une certaine mesure oui, je ne les ai reprises que vers 1974-75, avec les séminaires qui vont donner Théorie du sujet. Dans la période qui va de 1968 à 1972, dans ces quatre années là, que ce soit Jacques-Alain Miller ou moi, on est enfoncés dans la détermination politique au sens le plus activiste du terme. Je pense qu’il était très difficile de continuer un projet commun. Mais d’un autre côté, le problème dont on est parti et qui a donné finalement sa légitimité générale aux Cahiers pour l’Analyse, à savoir une version plus lacanienne que sartrienne de la corrélation entre théorie du sujet et théorie formelle des structures (donnons lui un nom très simple), ce projet là a absolument continué à animer ma recherche philosophique.
Ce que je pense, c’est que je suis petit à petit resté le seul de l’ancienne équipe à être fidèle au projet initial. Parce que ceux qui sont restés dans l’orbe lacanienne à proprement parler ont rabattu la chose du côté de la psychanalyse. Ils sont devenus ou redevenus des disciples de Lacan, ils ont abandonné la philosophie. Ils sont même devenus antiphilosophes. Jacques-Alain Miller va être le premier, naturellement, mais dans un certain sens Regnault aussi. Quant à Milner, il était linguiste de formation. Il n’a pas réussi à imposer à grande échelle sa vision théorique dans ce domaine. Il me semble pourtant que cette vision était originale et profonde. Par ailleurs, par rapport à Regnault ou Miller, il était sans doute le plus ‘politique’. Il avait un potentiel d’ambition de ce côté là. Il a organisé petit à petit, fidèle en cela à Benny Lévy, un courant idéologique tout à fait particulier, dont les avatars derniers, liés à une interprétation singulière du nom ‘Juif’ et de sa pertinence historique, sont, quand même, parfaitement réactionnaires. En fin de compte, cette normativité réactionnaire emporte tout.
Évidement les althussériens, Balibar, Macherey, mon ami Terray, à certains égards Rancière, qui est un althussérien anti-althussérien, c’est-à-dire les non-lacaniens, ont suivi une trajectoire tout à fait différente. Ils sont dans une problématique beaucoup plus historiciste, plus en débat avec Foucault qu’avec Lacan. Ils sont plus proche du débat avec le marxisme classique, moins liés aux hypothèses de la formalisation. Enfin, c’est une autre trajectoire, même si sur des questions de politique ponctuelles j’ai été souvent très proche d’eux. Il faut leur rendre justice: à la différence de Benny Lévy, Miller, Milner, voire Regnault, ce ne sont pas des renégats.
Dans le monde intellectuel, Mai 68 a finalement produit trois orientations distinctes. Une première orientation est dominée par la fidélité au noyau initial, qui premièrement affirme la possibilité de développer une théorie de la compatibilité entre l’exception subjective et la théorie formelle des structures, et deuxièmement, que cette compatibilité non seulement n’interdit pas, mais exige, le radicalisme politique.
PH: ... et qui reste dans la voie antihumaniste.
AB: Absolument. Appelons cette orientation le lacano-maoïsme. Évidement on n’est plus lacaniens ni maoïstes. Mais demeure le lacano-maoïsme, comme figure possible de pensée, déployée dans l’espace conceptuel philosophique, mais aussi pratique et politique. J’incarne aujourd’hui cette tendance.
Ensuite il y a ceux qui ont ramené le projet dans l’espace institutionnel psychanalytique, qui l’ont coupé de la philosophie ou des ambitions générales, et qui l’ont coupé aussi de la politique radicale. C’est-à-dire qu’ils sont devenus soit membres du parti socialiste, soit rien du tout, soit même sarkozystes, peu importe. Je dirais que c’est la ré-institutionnalisation de ce projet dans l’espace disciplinaire restreint qui lui avait donné naissance. On trouve là Miller et sa suite.
Et puis il y a ceux qui se sont installés dans une dérive réactionnaire explicite, et qui pensent qu’il faut retourner en deçà des années 60, qui disent qu’il faut en finir avec les années 60. Ce sont les renégats, généralement sectateurs de la ‘démocratie’ contre le ‘totalitarisme’, et finalement enveloppés dans le drapeau américain.
La séquence post-68 a donné cette galaxie-là, depuis une extrême droite reconstituée jusqu’à une extrême gauche maintenue, en passant par un centre institutionnel. C’est ça la trajectoire du petit monde de cette époque, et au fond elle a sa logique propre. Il faut bien voir que c’est à l’épreuve de mai 68 et de ses conséquences que ces choses là se sont structurées et déployées. En ce sens il est légitime de dire aussi que mai 68 a marqué la fin des Cahiers pour l’Analyse, au double sens de sa cessation et de sa réalisation.
PH: C’est parfait, je te remercie beaucoup.
Notes
1. Alain Badiou, Almagestes (Paris: Seuil, 1964); Portulans (Paris: Seuil, 1967). ↵
2. As a useful Wikipedia overview explains, ‘L’Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, UJC (ml), raccourcie UJ, est une organisation marxiste-léniniste prochinoise fondée le 10 décembre 1966 par une centaine de militants exclus de l’Union des étudiants communistes (UEC). Dirigée par Robert Linhart, Benny Lévy et Jacques Broyelle, elle est principalement implantée à Paris à l’École Normale Supérieure. Dissoute le 12 juin 1968 par un décret du Président de la République, elle donne naissance à la Gauche prolétarienne’ (‘L’Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes’, Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_jeunesses_communistes_marxistes-l%C3%A9ninistes, accessed 9 September 2009). Cf. Hervé Hamon and Patrick Rotman, Génération 1. Les années de rêve (Paris: Éditions du Seuil, ‘Points’, 2008), 128-135. ↵
3. Wikipedia again offers a useful summary: ‘Union des communistes de France marxiste-léniniste (sigle: UCFml ou UCF-ML, avec ou sans trait d’union) est un groupe maoïste français qui exista de 1969 à 1985. Il s’opposait tant à la Gauche prolétarienne qu’au PCMLF. Loin des tentations terroristes des premiers, et du traditionalisme des seconds, l’UCF a mené une politique antiraciste d’organisation et de mobilisation des travailleurs par delà la xénophobie montante dans la question du prolétariat telle qu’elle s’est cristallisée à l’époque giscardienne. Parmi ses anciens membres les plus connus, on peut citer Alain Badiou, Sylvain Lazarus, Natacha Michel, Catherine Quiminal’ (‘L’Union des communistes de France marxiste-léniniste’, Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_communistes_de_France_marxiste-l%C3%A9niniste, accessed 9 September 2009). A large collection of documents published by and relating to the UCF-ML are available online at http://archivescommunistes.chez-alice.fr/ucfml/ucfml.html. ↵
4. Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/PCMLF. ↵
5. Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_nationale_des_%C3%A9tudiants_de_France. ↵
6. Chris Marker, Le Fond de l’air est rouge, 1977; the English title is A Grin without a Cat. ↵
7. Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27hiver_1960-1961 ↵
8. Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_unifi%C3%A9. ↵
9. Raymond Badiou (1905-1996), a leading figure in the Resistance during the second world war, was mayor of Toulouse from 1944 to 1958, when he resigned to protest the Socialist Party’s commitment to the war in Algeria (cf. ‘Raymond Badiou’, Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Badiou, accessed 9 September 2009). ↵
10. See Jean-Toussaint Desanti, ‘Quelques Remarques à propos de l’ontologie intrinsèque d’Alain Badiou’, Les Temps modernes 526 (May 1990), 61-71; Jean-François Lyotard, untitled discussion of L’Etre et l’événement, in Cahiers du Collège Internationale de philosophie 8 (1989), 227-246. ↵