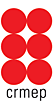Que sous forme de la rupture: un entretien avec Jacques Rancière
PH: Je sais bien que tu ne faisais pas partie des Cahiers pour l’Analyse, loin de là, et que tu ne peux pas en parler directement. Mais je te remercie de tes réponses à quelques questions sur le contexte général du projet, sur les discussions politiques et théoriques qui l’entouraient, sur ce qui se passait à l’Ecole Normale dans ces années-là, etc. Toi-même tu es arrivé à la rue d’Ulm en quelle année?
JR: En 1960. Jean-Claude Milner en 61, et Jacques-Alain Miller en 62.
PH: Et les Cahiers Marxistes-Léninistes1 sont lancés à la fin de l’année 1964, c’est ça?
JR: Oui c’est ça. Robert Linhart est arrivé à l’Ecole en 63, et son copain Jacques Broyelle en 1964. Ils représentaient le noyau ‘politique politique’, si tu veux, contre la tendance théoricienne qui dominait le milieu des althussériens.
PH: Quel était ton propre rôle dans les Cahiers Marxistes-Léninistes?
JR: En fait, c’est moi qui en ai lancé l’idée. Au départ, il s’agissait simplement pour moi de relancer l’activité propagandiste du Cercle des Etudiants Communistes de l’Ecole Normale Supérieure (le cercle d’Ulm). Mais les ‘normaliens communistes’ qui ont participé avec moi à cette relance étaient eux-mêmes devenus tels par l’influence d’Althusser, et ce qui devait être simplement un bulletin d’information du cercle communiste d’Ulm est devenu l’instrument de propagation de l’althussérisme parmi les étudiants communistes.
PH: La tendance représentée par Linhart et Broyelle, est-ce que c’était reconnue à l’époque comme explicitement ‘maoïste’?
JR: A l’Ecole on résistait toujours à toute réduction des orientations politiques à une simple adhérence avec Beijing ou Moscou, on s’intéressait quand même d’abord au renouveau de la théorie, l’utilité du travail théorique en tant que tel. C’était l’inspiration althussérienne.2
A l’époque il y avait deux tendances dans l’Union des Etudiants Communistes (UEC): ceux qu’on nommait ‘les Italiens’, des gens influencés par des marxistes Italiens (ou par des marxistes français dissidents comme Henri Lefebvre), qui insistaient sur les changements récents dans le capitalisme, sur l’idée qu’il fallait s’adapter au néo-capitalisme. Ils se groupaient autour du journal Clarté, qui était en gros pour une politique d’ouverture, une politique large, culturelle, ouverte, qui se tournait vers les jeunes, et qui approuvait la coexistence pacifique proclamée par Khrouchtchev – des idées auxquelles le Parti Communiste Français (PCF) n’adhérait pas vraiment. Les Italiens venaient de prendre la tête de l’UEC aux fidèles du PCF. Et il y avait, à gauche, les Trotskistes, et ceux qu’on nommait les ‘pro-Chinois’.
En gros, à l’époque la position de Linhart, qui était déjà l’animateur principal des Cahiers Marxistes-Léninistes, c’était: on n’entre pas dans ces querelles idéologiques, ce qu’on affirme d’abord c’est la nécessité de la théorie et d’une refondation de la pratique sur cette base. Mais de là il en résultait une ambiguïté: quand les Cahiers sont présentés au congrès de l’UEC, en 1965, ils sont mis en avant par la direction du Parti, par tous les orthodoxes, les fidèles du PCF, comme l’exemple de ce que devaient faire les jeunes: étudier, travailler la théorie plutôt que de discuter l’orientation politique du Parti. A ce même congrès Linhart a fait une déclaration: ‘nous ne sommes pas des pro-Chinois déguisés’. Mais dans un sens nous l’étions bien, si tu veux! Tout ceux qui ont participé aux Cahiers Marxistes-Léninistes étaient plus en sympathie avec les thèses de Mao qu’avec les thèses officielles du Parti, mais il y avait une sorte de double jeu. On disait: les étudiants communistes doivent s’occuper d’étudier le marxisme et pas de discuter la politique du Parti.3 Cela sous-entendait en fait pour nous que la théorie devait nous armer contre la politique du Parti, alors que cela semblait être une déclaration de loyauté au Parti. C’était en fait aussi la position d’Althusser. Sauf que Althusser était en quelque sorte une attentiste à vie, tandis que Linhart était un stratège qui attendait le moment pour faire sa scission.
PH: Et Broyelle?
JR: Broyelle il était le second de Linhart, je crois qu’il était secrétaire de l’UEC à l’époque. Il est devenu un pro-Chinois dur, et il est parti ensuite avec Linhart en Chine (en 1967). Plus tard il est allé vivre en Chine, il en est revenu dégoûté, et il a écrit avec sa femme un livre Deuxième retour de Chine (1977) qui s’est inscrit dans la mouvance de Glucksmann et compagnie, parmi tous les livres de militants expliquant comment ils étaient revenus de leurs illusions.4 Broyelle est finalement devenu membre, je crois, d’une espèce de groupe ultra-réac, CIEL, le Centre des Intellectuels pour l’Europe des Libertés (fondé en 1978 par Raymond Aron et Alain Ravennes), dans le genre anti-communiste officiel. Beaucoup de ces gens qui sont allés en chine vers 67-68, et en 72, et qui ont écrit des textes flamboyants sur la Chine de Mao, se sont retrouvés plus tard dans l’orientation des groupes comme le CIEL.
PH: Alors les normaliens des Cahiers s’occupaient de la formation théorique. Est-ce qu’ils renforçaient de cette manière une distinction entre l’Ecole Normale et l’université, parallèle à une distinction théorie-pratique, c’est-à-dire la théorie pour nous autres, la pratique militante pour ceux-là?
JR: Pas exactement. Dans le cercle de l’UEC à l’Ecole il y avait des gens très actifs, et à la Sorbonne il y avait des étudiants communistes très impliqués dans la théorie, notamment le groupe Philo.5 Je parle un peu dans La Leçon d’Althusser de ce groupe Philo qui était très actif, qui a critiqué Bourdieu quand il est venu à l’Ecole, etc., et qui voulait promouvoir des formes de travail collectif.6 Ils étaient très critiques de l’organisation du savoir, ils anticipaient beaucoup de thèmes qui sont ressortis en 68. Et Althusser est intervenu pour dénoncer cette dérive ‘idéologique’ parmi les jeunes, avec la plus grande violence; il insistait sur le fait que les étudiants sont là pour apprendre, pour acquérir la science qui les délivre de leur idéologie petite-bourgeoise. C’est la science qui doit diriger la politique, etc.; il en reste cet article qu’Althusser a écrit contre les étudiants, de la fin de 1963.7 Et cela coïncidait avec un changement dans le cercle de l’UEC à l’Ecole ( le cercle d’Ulm); les ‘vieux’, qui avaient été très actifs pendant la guerre d’Algérie partaient de l’Ecole, et nous autres on venait d’arriver: Miller, Milner, Linhart, etc. Donc on était en position de prendre le cercle, si tu veux.
On est parti sur cette espèce de vague là: d’abord la théorie, pas de critique du PCF, ne pas se battre pour ou contre les Italiens, ou les pro-Chinois. Ce n’était pas simplement ‘nous faisons la théorie et les autres font l’action’, mais on fait une politique qui passe d’abord par la formation théorique. Le grand projet de Linhart, au cercle de l’UEC, c’était ça: il faut d’abord organiser la formation théorique. Même mon texte publié dans Lire le Capital8, il avait été tapé au départ pas du tout pour le livre, mais pour servir à une espèce d’école de formation théorique que Linhart voulait monter. La formation théorique devait permettre de regrouper des gens sur des bases marxistes, scientifiques, c’était ça l’idée.
Il y avait alors un double aspect du projet, théorique et politique. Même le nom des Cahiers Marxistes-Léninistes, c’est finalement moi qui l’ai choisi, et pas du tout dans le sens d’une adhésion à Beijing, mais parce qu’il y avait Miller qui voulait les appeler ‘marxistes’ (c’était l’aspect théorique), et Linhart ‘léninistes’ (pour accentuer le côté directement politique). ‘Marxiste-léniniste’ par la suite est devenu le nom indiquant une prise de parti pour le communisme chinois, mais là ce n’était pas du tout une affirmation de maoïsme, c’était un simple compromis. C’était un compromis entre ceux qui voulaient tout d’abord écrire, penser, travailler dans la théorie, et ceux qui comme Linhart voulaient d’abord agir. C’était un trait d’union entre des activistes et des théoriciens.
PH: Et la formation théorique en question, c’était tout d’abord la science qu’il fallait pour comprendre le capitalisme? Ou bien est-ce qu’il s’agissait d’interroger le statut de la théorie et de la science en tant que telles, de poursuivre un projet épistémologique au sens large?
JR: Ah non, il s’agissait essentiellement d’enseigner aux militants le marxisme considéré comme une science existante. Ce n’était pas lié à un projet épistémologique global. Mais en même temps la science qu’il s’agissait d’apprendre était celle du marxisme authentique que nous prétendions exhumer avec Althusser et non celle qu’on apprenait dans les écoles du Parti Communiste.
PH: Alors des points de référence qui auront une importance pour les Cahiers pour l’Analyse – par exemple Canguilhem, et Cavaillès (pour ne pas parler de Frege, Russell, etc.) – n’étaient pas tellement présent dans le projet des Cahiers Marxistes-Léninistes?
JR: Non, ils n’étaient pas du tout présents. Le travail des Cahiers Marxistes-Léninistes c’était vraiment l’extension du travail du cercle de l’UEC, pour lequel ‘formation scientifique’ voulait dire ‘formation marxiste’, tout simplement. On insistait sur la différence entre science et idéologie, la théorie contre le vécu, mais il n’y avait aucune référence à la tradition épistémologique française, etc.
PH: Et Sartre, il n’était plus un point de référence?
JR: Sartre s’est vite trouvé dépassé par la montée du structuralisme et du marxisme althussérien. Moi je suis arrivé à l’Ecole en 1960; on était toujours dans le moment de la phénoménologie triomphante, autour de Husserl et Heidegger. Et l’influence de Sartre était encore forte. Mais cela a basculé très vite. L’année 60-61 était l’année du dernier séminaire de Jean Beaufret à l’Ecole, c’était symboliquement la fin de la période de l’importance de Heidegger. Quand je suis arrivé à l’Ecole j’étais toujours très imprégné de Sartre, et son grand livre sur la raison dialectique venait de sortir, et je l’avais lu avec passion.9 Ensuite il y a eu cette célèbre conférence de Sartre en avril 1961, dans la Salle des Actes [à l’Ecole Normale]; Sartre a fait un truc vraiment nul.
PH: Un moment important, plusieurs de tes contemporains le mentionnent aussi; est-ce que tu te rappelles du thème, par ailleurs?
JR: Je crois que c’était une conférence sur le possible, en gros le thème c’était comment le possible est gagné sur l’impossibilité d’être homme. C’était extraordinairement faible. A suite de quoi je me souviens qu’il a été attaqué par plusieurs, Althusser de manière plutôt polie, et plus sèchement par Roger Establet, qui était au sein du cercle de l’UEC et qui l’a attaqué sur des thèmes althussériens, pour dire en gros ‘ce que vous faites c’est la philosophie de la conscience, et votre praxis ce n’est que de la conscience, ça suppose un cogito transparent’, et ainsi de suite. Pour moi ça marquait une désillusion par rapport à Sartre; ça marquait un peu la sortie de Sartre de notre horizon, cette soirée. Je crois que ceux de ma génération qui étaient là ont eu le même sentiment, même si l’influence de Sartre se fait encore sentir par exemple sur Badiou qui reste un grand sartrien.
PH: Voilà donc une ligne de transition assez nette. Quand c’est sorti, est-ce que il y a eu beaucoup de discussion de la Critique de la raison dialectique (1960)?
JR: Non absolument pas. Justement, il est venu à l’Ecole à la suite de ce livre, pour le célébrer, mais c’était plutôt comme un enterrement; je n’ai jamais vu plus personne (à l’Ecole) discuter Sartre. La Critique c’est un livre qui est venu trop tard; il cherchait à parler de l’histoire, de faire référence à l’anthropologie, d’engager un peu avec Lévi-Strauss, etc., mais c’était inopérant. C’était vraiment le chant du cygne de l’existentialisme. Et quand je suis entré à l’UEC en 1963, Sartre n’était plus du tout un point de référence.
PH: La guerre d’Algérie (dans laquelle Sartre avait joué un rôle important) venait d’arriver à sa fin, et je suppose que pour les jeunes de l’époque la question du colonialisme n’avait plus la même urgence?
JR: Oui la guerre est terminée, et les jeunes de l’UEC se sont tournés vers d’autres choses, la vie étudiante et l’organisation du savoir. Plus personne ne parlait de la question coloniale en France – c’était le moment où dominait en France l’esprit du cartiérisme, la doctrine du journaliste Raymond Cartier disant qu’il fallait se recentrer sur l’hexagone, que le temps des colonies était fini, etc. La question des colonies est complètement disparue de la discussion théorique et politique, et la réflexion sur la situation internationale commençait de s’orienter autrement, vers l’idée d’une nouvelle révolution tiers-mondiste.
C’était le moment de la révolution cubaine, des mobilisations dans le monde arabe, et ce serait bientôt celui de la Révolution culturelle chinoise, etc. La réflexion politique à cette époque s’est jouée sur le fond d’une participation locale à un mouvement d’émancipation qui était mondial. Mais il était essentiellement une question de sympathie plus ou moins distante, comme serait le cas à propos de la guerre américaine en Vietnam un peu plus tard; en France les gens ne se sentaient pas en charge, on agissait sans les problèmes immédiats de solidarité, de la guerre de connexion, etc., qui se posait lors de la guerre d’Algérie. Après 1962 le gouvernement français n’était plus engagé dans une guerre coloniale, donc il n’y avait pas de raison pour que cet aspect là soit prééminent. C’était plutôt un moment d’espoir dans une nouvelle ère de révolution mondiale, le moment tiers-mondiste.
PH: Ceux donc qui voulaient insister sur l’action politique, sur le militantisme, ils refusaient par ailleurs toute référence à la conscience, à la volonté, à l’engagement; mais comment parler alors d’action politique, sans tomber plus ou moins dans une sorte de déterminisme économique? Pour sa part le Sartre des années cinquante disait, en gros, ‘le marxisme nous donne prise sur la situation historique’, et donc nous aide à agir pour transformer cette situation. Chez Sartre on voit toujours plus ou moins bien qui c’est, ce ‘nous’. Tandis que plus tard ce sera moins évident! Peut-on penser l’action militante sans faire référence à la conscience, au projet, aux délibérations du sujet, etc.? Comment résoudre ces questions, dans l’orientation des Cahiers Marxistes-Léninistes?
JR: Tout est médiatisé par la théorie. L’idée est alors qu’il faut passer par la théorie, par la science, pour avoir prise sur la situation. Et la science nous dit, précisément, que le sujet n’est qu’un ‘support’ des relations de production, etc. Ce que disait la science marxiste, c’est qu’il fallait liquider toutes les théories de la volonté, toutes les théories de l’engagement, pour penser la place de ce qu’on fait dans la configuration historique et effective telle que la science seule peut la penser. La politique se pense comme médiatisée par la théorie, aussi bien en théorie je dirais qu’en pratique, tu vois.
Mais il faut également comprendre qu’à l’époque, choisir le camp de la théorie et de la science c’était aussi choisir le camp de la rupture, de la révolution, le camp de l’autonomie du marxisme, de l’extériorité du marxisme par rapport à l’appareil politique communiste, mai aussi par rapport à l’ensemble de l’ordre existant. N’oublie pas que ce qui est en jeu au centre de l’althussérisme (même si sa conception de l’histoire est si sophistiquée que l’objectif s’en perd), c’est quand même une réfutation des théories évolutionnistes, d’une certaine conception de l’évolution historique qui mène au socialisme, et du même coup de l’idée du passage pacifique, etc. La théorie dit que la révolution ne peut procéder que sous forme de la rupture, et non pas sous la forme d’une évolution pacifique. Ce qui a permis, effectivement, qu’en 68 la plupart des structuralistes deviennent des militants radicaux.
PH: Ceux qui deviennent alors des militants sans réserve, ceux qui (comme Linhart) ‘s’établissent’ dans les usines, etc., est-ce qu’ils concevaient ce militantisme comme prolongement de cette même projet autorisé par la théorie? Ou comme rupture et passage à une autre conception de la politique, et donc à une autre conception du sujet? N’y avait-t-il pas, dans la nouvelle référence a la Révolution culturelle chinoise après 67, une sort de hyper-volontarisme, justement?
JR: Ça c’était la politique de l’UJC(ml), puis celle de la Gauche Prolétarienne après 68, et justement c’était clairement une politique en rupture avec la logique althussérienne. Quand l’UJC s’est constituée comme organisation politique autonome, elle l’a fait forcément dans une logique de rupture avec Althusser et le Parti Communiste.
Là il y a eu une séquence en deux temps. Le premier moment de rupture parmi les althussériens, c’est en 1965-1966, quand je n’étais plus à l’Ecole: il y a alors ceux qui s’inscrivent dans un projet de refondation théorique, dans le style des Cahiers pour l’Analyse (à commencer par Miller et Milner), et puis il y a ceux qui choisissent la voie de l’action pratique, comme Linhart et Broyelle. Et puis, dans un deuxième temps, les ‘théoricistes’ et les activistes se rejoignent en 68 contre les althussériens qui restent au PCF. Ce qui intéressant c’est comment les gens se rejoignent: ce qui se constitue en 68 sera justement un bouleversement dans le rapport à la théorie comme dans le rapport à l’organisation. L’UJC puis la GP ont donné un grand rôle à l’établissement des militants à l’usine. Or l’établissement, c’est deux choses en même temps: c’est l’organisation d’une implantation ouvrière, une manière d’entrée dans les usines, de constitution des noyaux militants, mais c’est aussi une forme de transformation de l’intellectuel, une idée de la rééducation des intellectuels; donc un abandon de la vision des intellectuels apportant la théorie aux masses. Il y a les deux choses. Il y a l’aspect qu’on pourrait dire quasiment éthique, finalement, du militant intellectuel de type nouveau, et deuxièmement l’aspect instrumental, à savoir que pour faire des choses dans l’usine il faut y être.
PH: Mais avant ce relancement qui sera 68, au moment même est-ce que la rupture de 1965-66 était vécue comme irréversible, fondamentale?
JR: Oui, Linhart et l’UJC se coupent entièrement de ceux qui partent fonder les Cahiers pour l’Analyse. C’était une rupture véritable, qui commence, à ce que je me souvienne, avec ce numéro des Cahiers Marxistes-Léninistes que Linhart et le cercle UEC d’Ulm ont refusé de diffuser, un numéro sur la littérature, avec des textes de Milner et Regnault (CpA 7.Intro). C’était un moment de cassure. Apres ça les Cahiers Marxistes-Léninistes, publiés en rouge, se centreront sur les enjeux politiques, même si on y trouve toujours un peu le même double jeu, avec par exemple le gros texte (non signé) d’Althusser sur la Révolution culturelle10, qui indiquait alors une sorte de ralliement au maoïsme mais toujours très théorique, très enveloppé.
Et puis en 68 l’UJC se retrouve, un peu à contre courant, parce que Linhart, au début de mai, lance la théorie selon lequel ce mouvement de mai 68 n’est qu’une manipulation de la social-démocratie contre le mouvement ouvrier, en le dénonçant très violemment.11 Apres quoi les militants de l’UJC vont se redistribuer: certains vont basculer vers L’Humanité Rouge, le Parti communiste marxiste-léniniste de France et toutes choses marxistes-léninistes ‘hard’, d’autres vont rejoindre la Gauche Prolétarienne, d’autres vont disparaître, etc. Et les structuralistes durs, des gens comme Miller et Milner, qui depuis 66 se tenaient à l’écart du projet de Linhart, vont également rejoindre le mouvement de la Gauche Prolétarienne. Disons que 68 a redistribué les rapports entre théorie et pratique.
PH: Revenons un peu vers les Cahiers eux-mêmes. A ta connaissance, les nouveaux Cahiers pour l’Analyse lancés par Miller et Milner en janvier 1966, est-ce qu’ils étaient conçus d’abord comme une sorte de supplément théorique-épistémologique aux Cahiers Marxistes-Léninistes, ou bien est-ce qu’il s’agissait là, en gros, d’un projet indépendant, un projet simplement nouveau, voire même en concurrence l’un avec l’autre?
JR: Je n’ai pas du tout participé aux Cahiers pour l’Analyse donc je ne peux pas te dire grand-chose. Mais on ne peut pas dire que les Cahiers pour l’analyse étaient un supplément théorique aux Cahiers Marxistes-Léninistes, même s’il n’y avait pas contradiction au niveau théorique entre les deux: les Cahiers pour l’analyse entendaient développer ce paradigme structuraliste au sein duquel le marxisme renouvelé prenait sa place. Il s’agissait de l’explorer sur tous les plans et cela impliquait de travailler avec des gens qui n’étaient pas directement impliqués dans l’action militante. Ils voulaient intervenir dans ce qui apparaissait comme le grand débat de l’époque, à savoir – en reprenant les termes de Cavaillès – le combat de la philosophie du concept contre la philosophie de la conscience.12 Ils prenaient parti, évidemment, pour le concept. Ils voulaient renouveler une tradition épistémologique française anti-phénoménologique, avec comme points de référence des noms comme Cavaillès, Canguilhem, Foucault qui a été marqué par Canguilhem (son directeur de thèse), etc.
Et par ailleurs ça correspondait évidemment à l’époque où Lacan est arrivé à l’Ecole (en 1964); je crois que Lacan s’est rendu compte très tôt qu’il pourrait s’appuyer sur des normaliens pour torpiller un peu les structures de la profession (psychanalytique), pour constituer sa propre école. En 64-65 il y a eu une première réunion pour constituer ce qui deviendra après l’Ecole Freudienne de Paris; il y avait un petit groupe de normaliens – Miller, Milner, Grosrichard et moi. Lacan nous avait mis pour faire contrepoids face à des psychanalystes comme Serge Leclaire. Lacan a vu qu’il pouvait utiliser Miller etc. pour l’aider à créer justement une sorte de paradigme théorique qui pouvait fonctionner un petit peu comme un moyen de prendre le pouvoir dans son milieu. Il y avait une espèce de stratégie aussi qui se mêlait dans tout ça.
Donc les Cahiers pour l’Analyse étaient là pour dégager l’accent théorique, conceptuel, du paradigme structuralo-marxiste, pour le dire vite, alors que l’UEC était là pour traiter le côté pratique. Pendant ce temps le côté pratique a fait sa propre révolution, tandis que l’aspect théorique restait un peu ambigu: en 1967, il y a eu le ‘Cours de philosophie pour les scientifiques’ (organisé par Althusser) qui participait aussi du grand projet de refondation épistémologique. Il y avait toujours le projet de donner à la politique son fondement théorique, mais cela passait d’abord par une théorie générale des diverses pratiques et la pratique politique n’était pas la priorité du Cercle d’Epistémologie et des Cahiers pour l’analyse.
PH: A l’époque, est-ce qu’il paraissait cohérent, pour ceux qui cherchaient à penser le fondement théorique de l’action politique et du marxisme, de passer par Canguilhem et par Lacan, par l’épistémologie, par la ‘logique du signifiant’, etc.? Ou bien est-ce qu’il s’agissait là non seulement d’un ‘détour par la théorie’, un détour à la Althusser, mais d’une sorte de distraction, même une déviation?
JR: Rappelons que c’est Althusser qui avait défini une sorte d’équivalence entre le matérialisme marxiste et le structuralisme. Donc il y avait une évidence du lien entre le marxisme comme théorie générale et le structuralisme comme paradigme matérialiste, en rupture avec la philosophie ‘idéaliste’ de la conscience. Les ‘défilés du signifiant’ lacanien fonctionnaient alors à la manière des rapports de production marxistes comme la contrainte ignorée par les idéologues de la conscience, de la praxis et du vécu. Et Canguilhem, qui avait dirigé la thèse de Foucault et exercé une forte influence sur plusieurs d’entre nous, notamment Balibar, apparaissait comme le représentant d’une tradition de pensée de la science opposée à l’idéalisme phénoménologique. Donc on pouvait considérer qu’il y avait un fondement théorique commun à tout cela. Mais dans la pratique ce n’était pas pareil. C’est ainsi qu’il y a eu la fameuse bagarre autour du numéro des Cahiers Marxistes-Léninistes sur la littérature conçu par les gens des Cahiers pour l’analyse et refusé par Linhart.
A ce moment, j’étais professeur au lycée avec des classes énormes, de 40-50 élèves. J’étais donc complètement coupé de tout cela et je n’en avais que des échos. Linhart m’a convoqué alors parce qu’il cherchait à s’appuyer sur ‘les bons’ althussériens contre ‘les mauvais’, pour le dire vite. C’était le moment du lancement de l’UJC. Mais moi je n’avais absolument pas le temps de m’occuper de ça. Ensuite je suis passé à la Fondation Thiers et de 65 à 68, à part des rapports personnels, je n’ai eu pratiquement pas de rapports avec les projets à l’Ecole. Et avec Miller il y déjà eu, en 65, cette sombre affaire avec Lire le Capital.
PH: A propos de la paternité du concept de la causalité métonymique?
JR: Oui c’est ça. Quand il a lu mon texte du séminaire sur le Capital – tapé d’abord seulement pour des cours de formation théorique – il est entré dans une rage, etc., il disait que j’avais volé ses concepts. C’était très violent. A ce moment j’ai su que le projet d’Althusser était de publier le séminaire en un volume – le futur Lire le Capital. J’ai alors dit que je retirais mon texte de la publication, mais il y a eu la pression d’Althusser et d’autres pour que ça paraisse quand même, avec des notes pour rendre hommage à Miller, etc. Après 65 je n’ai plus vu Miller, et par conséquent toutes ces histoires concernant les Cahiers pour l’Analyse et le Cercle d’Epistémologie, je n’ai jamais été associé, je n’ai jamais été invité. Bon j’avais toujours un rapport personnel avec Milner, mais sinon j’étais complètement à l’écart de tout cela.
PH: Vu de loin il parait un peu exagéré, disons, cette réaction de Miller à propos de la causalité métonymique. N’y avait-il pas des variantes de cette idée chez plusieurs de ceux qui cherchaient à penser la ‘causalité structurale’ à l’époque, chez Althusser et autour d’Althusser – Miller sans doute mais aussi Duroux, Macherey, toi...?
JR: Bon, il faut comprendre qu’au départ Miller était très investi dans le projet du séminaire sur le Capital, mais par la suite il s’en est retiré parce qu’il voulait un séminaire fermé, un séminaire de chercheurs, tandis qu’Althusser penchait pour un séminaire public (ce qu’il sera). Du coup Miller n’a assisté à aucune des séances. Le séminaire déroulait de la fin de 64 jusqu’au printemps de 65 (et le premier numéro des Cahiers Marxistes-Léninistes parait dans l’automne de 64). A la fin du séminaire, il s’est présenté comme ayant été tenu à l’écart de ce qui se passait; il a dit qu’on lui avait volé ses concepts, il a accusé Milner (qui lui avait participé) de ne pas l’avoir averti, etc. Tout cela était compliqué par la structure complexe du noyau althussérien: je n’avais pas été associé à l’organisation du séminaire et en même temps, comme on m’avait demandé de parler sur le rapport entre le Capital et la pensée du jeune Marx, j’avais le rôle stratégique d’être l’énonciateur de la rupture scientifique marxiste. Althusser créait ainsi des cercles concentriques.13 J’ai appris plus tard ainsi l’existence autour de lui d’un ‘cercle Spinoza’, un noyau théorique quasi-clandestin; moi je n’y étais jamais mais il y avait des gens comme Duroux, comme Badiou, comme Balibar. Il y avait cette espèce d’engrenage de cercles plus ou moins informels qui faisaient des médiations entre Althusser et les autres, entre la politique et le théorique.
PH: Et donc à partir de ce dénouement, Miller s’est coupé de toi et de Althusser?
JR: Althusser j’en sais rien, mais avec les Cahiers pour l’Analyse Miller a constitué, effectivement, son propre espace théorique où la référence organisatrice pour penser le paradigme structuraliste était Lacan plutôt que Marx.
PH: Je suppose que pour Linhart et ses amis, les nouveaux Cahiers n’étaient qu’une dérive ésotérique, ultra-théoriciste?
JR: Oui, forcément. Les uns dénonçaient l’activisme pur, les autres le théoricisme pur. Structure classique!
PH: Et cette idée de causalité (structurale), qui est au cœur de l’analyse de ‘l’action de la structure’, justement, pour reprendre la phrase des Cahiers (CpA 9.6), et qui était impliquée dans la rupture des deux tendances: en principe, est-ce qu’elle pouvait servir de médiation entre théorie et pratique, une fois écartée toute référence à la conscience, au sujet, à la volonté militante, etc.? Et par là, par l’analyse de la causalité, on pourrait non seulement étudier l’histoire mais comprendre comment faire de l’histoire?
JR: Oui certainement, ça permettait une espèce de double attitude. D’abord on pouvait dire bon, on présente la théorie, au plus loin de toute pensée de l’engagement, du vécu; cette théorie réfute les fausses idées, les idées idéalistes sur le rapport de la théorie à la pratique. Mais la pratique théorique ouvrira elle-même d’autres champs pour une nouvelle pensée de la pratique politique... En fait elle n’en a ouvert aucun. Mais ce diffèrement correspondait aussi à la stratégie d’Althusser, à l’idée un peu naïve qu’on allait petit à petit gagner de l’influence dans le milieu intellectuel, qu’on va s’élargir, qu’en ayant l’air de rester fidèle au PCF on gagnerait un tel et un tel et un tel, voilà.
PH: Entendu. Et pendant ce temps, donc pendant les années 66-68, est-ce que tu avais déjà une idée de ce que serait ton propre parcours ultérieur, tes projets dans les archives, les travaux qui donneront La Nuit des prolétaires (1981), etc. – je veux dire, bien avant La Leçon d’Althusser (1974), est-ce que tu prévoyais déjà une rupture avec l’orientation théorique/scientifique?
JR: Pas du tout! Je n’avais même pas de projet, pas du tout. Ce n’est pas comme ça que les choses se passent. Tu te trouves dans une conjoncture, tu es happé par ce qui se passe – et ce qui se passe ça peut être la guerre d’Algérie, ça peut être Althusser, le structuralisme. Qu’il s’agit de l’action militante ou d’un point de vue théorique, tu te trouves dans une conjoncture et ton orientation dépend de ce qui se passe autour. Il y avait à l’époque tout un environnement, tout un tas de possibilités, qui permettaient de participer à quelque chose de nouveau, d’aller avec la nouvelle vague. Tu es pris dans le nouveau, tu cherches à penser le nouveau, tu te mets en quelque sorte à la mesure du nouveau, et tu ne le penses pas en termes stratégiques. A l’époque je n’avais aucun projet théorique à long terme, ni aucun projet stratégique, de carrière, etc. En plus j’étais prof au lycée, j’avais peu de temps pour réfléchir à l’avenir. Il fallait chaque jour courir comme un fou pour préparer les classes du lendemain, etc. – tout ça n’avait rien à voir avec les grands projets de renouvellement théorique. Mais aussi je me rendais compte de l’écart entre le type de position magistrale à laquelle nous prétendions comme porteurs du savoir scientifique et la réalité de l’enseignement qu’il fallait donner aux jeunes.
Par ailleurs c’est vrai que l’althussérisme représentait une restriction énorme, une restriction des choses qui était reconnues comme théoriquement valables, même par rapport à nos élèves, qui s’intéressaient à des choses diverses – parfois au surréalisme, à Simone Weil, que sais-je. Même par rapport au marxisme et la tradition révolutionnaire, l’althussérisme représentait une restriction énorme du champ de ce que c’étaient la pensée et l’histoire marxistes. Bon tout ça pour dire qu’à l’époque j’étais dans ma bulle, je donnais mes cours. Après une année comme ça j’ai réussi à m’en sortir, je suis allé à la Fondation Thiers, ce qui était complètement différent: un univers complètement aseptisé, avec quinze personnes dans un vieil hôtel préparant leur thèse. Je préparais moi-même une thèse, je vivais beaucoup à la campagne. Donc pendant toute cette période j’étais très loin du monde, dont j’entendais des échos: j’étais convaincu que la Révolution culturelle était formidable mais je ne la connaissais qu’à travers ce que je lisais dans le Cahiers Marxistes-Léninistes, tu vois. Bon dans ce contexte mai 68 c’était un peu le retour du réel dans un certain sens, sur tous les plans. Mais à l’époque je ne savais pas du tout ce que j’allais faire, je n’avais pas de plan à long terme.
PH: Tu est entré au nouveau département de Philosophie à Paris VIII-Vincennes dès le début, en 1969, avec justement tous tes collègues de l’Ecole?
JR: Oui tout de suite, j’étais sollicité par Foucault, c’est lui qui a créé le département. Foucault a prétendu, après, avoir fait un savant dosage entre tendances politiques, mais ça c’est une plaisanterie totale: il a demandé à Althusser et à Derrida de l’aider à trouver des jeunes supposés être bons, quoi, c’est tout. Je n’ai pas hésité: après 68 on voulait être quelque part où il pourrait se passer des choses, tout en ayant la possibilité de faire sa thèse.
PH: C’était sur quoi, ta thèse, par ailleurs?
JR: Cela devait être sur Feuerbach, sur le concept de l’homme chez Feuerbach – mais je ne l’ai pas terminée, et je n’en ai rien publié. Pourtant c’est là que j’ai vu que les interprétations d’Althusser et de Foucault ne fonctionnaient pas, que les formes théoriques par lesquelles s’établissait sa théorie de l’homme, de l’humanité et de l’humanisme n’avaient rien à voir avec leurs constructions.
PH: D’accord. Pour terminer: quand tu y penses maintenant, qu’est-ce qui reste comme héritage philosophique du structuralisme? Est-ce qu’il en reste des travaux importants, des lignes de pensée et de recherches fécondes, etc.? Les Cahiers pour l’Analyse ont été abandonnés presque immédiatement après 68, et pendant un certain temps oubliés, ou presque; de manière anecdotique j’ai l’impression qu’aujourd’hui on s’y intéresse de nouveau, on reprend un peu ces questions du rapport entre structure et sujet, entre l’action et la logique, entre le réel et les mathématiques, par exemple à travers l’œuvre de Badiou, de Zizek, la lecture de Lacan par Zizek, etc.
JR: Peut-être. Des théoriciens comme Badiou et Zizek poursuivent l’alliance althusséro-lacanienne même si ça passe par des médiations nouvelles. Même leur Lacan est différent de celui de l’époque. A l’époque, Lacan c’était le symbolique; leur Lacan à eux c’est le réel. A l’époque personne n’aurait eu l’idée de fonder une théorie du renouveau du communisme, voire du léninisme sur la Chose, l’horreur et l’acte, pas du tout! La liaison se faisait par l’ordre symbolique. Le 0 et le 1, les éléments d’une logique du signifiant, etc., ce n’est justement pas l’horreur, ce n’est pas la Chose, l’abjection, etc. Il y a effectivement toute une thématique lacanienne du réel (avec laquelle Badiou s’est confrontée tout d’abord, avec la mise en scène de la lutte du courage avec l’angoisse dans sa Théorie du sujet [1982]), mais ce n’était vraiment pas la perspective des années soixante. Par la suite Badiou a recadré Lacan comme dialecticien. Tout système est un bricolage, bien sûr, et on trouve chez Badiou un arrangement compliqué entre la vision althussérienne de la philosophie dégageant la rationalité de la science, la pensée lacanienne du réel et un fort héritage sartrien, tout cela assemblé dans une logique platonicienne. Mais oui, finalement il faut dire qu’il y a effectivement une tradition althusséro-lacanienne qui dans un sens s’est maintenue, et qui à travers des transformations bizarres a pu donner aussi bien Milner, Zizek ou Badiou.
PH: Et toi tu te sens tout à fait distant de tout cela?
JR: Oui tout à fait – tout d’abord je n’ai strictement rien fait de Lacan, et aussitôt après mon arrivée à Vincennes, j’ai pris mes distances avec l’althussérisme, c’est-à-dire pas seulement avec une personne et une pensée déterminées mais avec toute la tradition scientiste qui avait nourri le marxisme, le structuralisme et toutes les tentatives pour les assembler. C’était une rupture avec l’avant-gardisme de ceux qui s’imaginent avoir la science dont les masses ont besoin pour se libérer mais aussi avec toute idée de faire dépendre l’intelligence des pratiques émancipatrices d’une explication globale du monde ou de l’être.
PH: Entendu. Et ces jours-ci, tu continues avec ce long cycle de recherche sur la politique de l’écriture au 19e siècle, avec des projets sur l’esthétique, la démocratie, etc.?
JR: Oui, quand je peux, je travaille à un livre sur le régime esthétique de l’art, un livre qui essaie d’en saisir la logique à travers un certain nombre d’événements ponctuels: un texte théorique, une mise en scène au théâtre, un compte-rendu de spectacle, une exposition d’art décoratif, etc. Ce qui m’intéresse, c’est toujours la façon dont un régime de perception et de pensée se transforme dans ce qu’il a de plus concret et de plus ténu.
Notes
1. Cf. Frédéric Chateigner, ‘D’Althusser à Mao: Les Cahiers Marxistes-Léninistes’, Dissidences 8 (2010), 66-80. ↵
2. As Rancière remembers, ‘Althusser was seductive [...], he was like the priest of a religion of Marxist rigour, or of the return to the text. It wasn’t really the rigour of his teaching that appealed so much as an enthusiasm for his declaration that there was virgin ground to be opened up. His project to read Capital was a little like that: the completely naïve idea that we were pioneers, that no one had really read Marx before and that we were going to start to read him. So there were two sides to our relation with Althusser. There was, first of all, a sense of going off on an adventure: for the seminar on Capital, I was supposed to talk, to explain to people the rationality of Capital, when I still hadn’t read the book. So I rushed about, rushed to start reading the various volumes of Capital, in order to be able to talk to others about them. There was this adventurous side, but there was something else as well: our roles as pioneers put us in a position of authority, it gave us the authority of those who know, and it instituted a sort of authority of theory, of those who have knowledge, in the midst of a political eclecticism. Thus, there was an adventurous side and a dogmatic side to it all, and they came together: the adventure in theory was at the same time dogmatism in theory’ (Jacques Rancière, ‘Politics and Aesthetics: An Interview’, Angelaki 8:2 [2003], 195).
Despite Althusser’s later self-critical rejection of ‘theoreticism’, Rancière observes, it was ‘precisely the “theoreticist” discourse of For Marx [1965] and Reading Capital [1965] that produced political effects, both on the practices of communist organisations and on the student uprisings [of 1968 and after]. And its effects were quite contradictory. The Marxist science and “rigour” of Althusser’s “theoreticism” strengthened the PCF apparatus by recruiting communist students to the Party. But it also created a fissure, as this very science and rigour provided support to the Maoist students who founded the first Maoist [i.e. anti-PCF] student organisation in France, the UJC-ml’ (Rancière, Althusser’s Lesson [1974], trans. Emiliano Battista [London: Continuum, 2011], 23). ↵
3. Cf. Rancière, Althusser’s Lesson, 18-19. ↵
4. Claudie et Jacques Broyelle, Deuxième retour de Chine (Paris: Éditions du Seuil, 1977); cf. Claudie et Jacques Broyelle, Apocalypse Mao (Paris: Grasset, 1980). ↵
5. Julian Bourg offers a useful overview of the situation in the UEC in the pivotal year 1965: ‘Though short-lived, the Cercle d’Ulm [led by Linhart] experienced a considerable influence in the UEC during 1965. “Concepts circulate freely as they are being developed without any controls being placed on them,” Althusser observed of this period. Accordingly, what cannot be controlled often takes on a life of its own. The project of “theoretical education” caught on, the ideas of Althusser and his students showing up in the “schools of theory [that] were set up in almost all the universities of Paris.” Althusserianism became a veritable phenomenon among left-leaning students who, though the baby boom’s numbers were beginning to be felt, were stuck with a Party whose mythical role in the Resistance paled before its pitiful response to the Algerian War and its seeming abandonment of the world revolutionary cause. PCF rapprochement with the Fifth Republic meant a rapprochement with bourgeois and even religious culture. The return to Marx, the priority of theory to practice, and the appeals of anti-humanism – these added up to a common language with which to re-found the revolutionary project that had been steered astray at a moment when, Poster writes, “everyone was welcome aboard the Marxist ship [...] repainted in the bright colours of humanism.” Maoism represented the cutting edge of Marxist-Leninism in France, of the desire to get back (and forward) to the class struggle. Culture was the site of contestation, not only because political manoeuvring seemed blocked (even Althusser admitted this much), but also because France was and remains a strongly hierarchical society, with sharp divisions of labour and social positioning, where political orientations generally stem from and imply identifiable intellectual positions. Students knew this reality well. For example, throughout the 1960s, the dominant mode of French university learning – classicism – reinforced the political status quo, a systematicity extending from stodgy classroom pedagogy to the relatively closed and hierarchical university to the national state, which governed the university. Classicism and humanism were connected. For Althusser’s students at the rue d’Ulm, anti-humanism was an intellectual alternative that was meant to culminate in political action’ (Julian Bourg, ‘The Red Guards of Paris: French Student Maoism of the 1960s’, History of European Ideas 31:4 [2005], 482-483). ↵
6. Althusser’s intervention against the syndicalist left in late 1963 was partly triggered, Rancière notes, by ‘the student strike led by the FGEL [la Fédération des Groupes d’Études de Lettres, at the Sorbonne] in November 1963, whose main – and notable – slogan was “Sorbonne to the students”, and the intervention by the FGEL’s secretary, Bruno Queysanne, during the inaugural lecture of Bourdieu and Passeron’s seminar at the Ecole Normale Supérieure. In Queysanne’s intervention, in his questioning Bourdieu and Passeron about the political status of a sociological research project about academic learning that protracted the authoritarian division of academic labour, Althusser recognised his enemy: here was leftism [le gauchisme], the subordination of science to politics, the aggression of illiterate politicians against researchers’ (Althusser’s Lesson, 39-40). ↵
7. Louis Althusser, ‘Problèmes étudiants’, La Nouvelle Critique 152 (January 1964), 80-111; ‘Student Problems’, partial trans. Dick Bateman, Sublation (University of Leicester, 1967), 14-22. Althusser takes for granted the idea that ‘the pedagogic function has as its object the transmission of a determinate knowledge to subjects who do not possess it’, and is therefore ‘based on the absolute condition of an inequality between a knowledge and a lack of knowledge.’ Given this inequality, the question concerning class difference or class struggle in the university and in education more broadly, Althusser argues, is not a matter of the teacher-student relation but of the nature of the knowledge transmitted by those who know to those who do not. ‘If the knowledge distributed [is] a pure ideology, as in certain subjects and courses’, then what is at issue is indeed a matter of ‘class policy’ and should be contested as such. But if this knowledge is a ‘true science’ then the ‘pedagogical relation’ can be assumed to remain ‘essentially healthy, even if its forms are relatively “old” and need reforming.’ In such a case, students should accept the degree of submission and inequality presupposed by the ‘long training’ needed to become the equals of their masters. According to Althusser, issues that provoke disagreement among communists can only be, as a matter of principle, scientific issues, and should be resolved accordingly. The authority of science remains beyond appeal. ‘No pedagogic questions which presuppose unequal knowledge between teachers and pupils can be settled on the basis of pedagogic equality’, and ‘students are mistaken in demanding that in pedagogic organisations their representatives should have powers of decision equal to those of the representatives of the teachers. For this does not correspond with the reality of the teaching situation’ (Althusser, ‘Student Problems’, 18-21).Cf. Rancière, ‘On the Theory of Ideology: The Politics of Althusser’ [1969], trans. Martin Jordin, Radical Philosophy 7 (1974), retranslated by Emiliano Battista as an appendix of Althusser’s Lesson, 125-154. ↵
8. Rancière, ‘Le Concept de critique et la critique de l’économie politique des Manuscrits de 1844 au Capital’, in Althusser et al., Lire le capital, 2 vols (Paris: Maspero, 1965), vol. 1, 93-210. ‘The Concept of “Critique” and the “Critique of Political Economy” (From the Manuscripts of 1844 to Capital)’, in Ideology, Method and Marx: Essays from Economy and Society, ed. Ali Rattansi (London: Routledge, 1989), 74-180. ↵
9. Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique (Paris: Gallimard, 1960). ↵
10. [Louis Althusser], ‘Sur la révolution culturelle’, Cahiers Marxistes-Léninistes 14 (November 1966); ‘On the Cultural Revolution’, trans. Jason Smith, Decalages 1:1 (16 February 2010), http://scholar.oxy.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=decalages. ↵
11. Cf. ‘Et maintenant aux usines!’, tract de l’UJC(ml), 7 May 1968. ↵
12. ‘Le terme de conscience ne comparte pas d’univocité d’application – pas plus que la chose, d’unité isolable. [...] Ce n’est pas une philosophie de la conscience mais une philosophie du concept qui peut donner une doctrine de la science’ (Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science [1946] [Paris: Vrin, 1997], 90). ↵
13. Althusser later recalled the origins of this famous seminar: ‘If I remember correctly three individuals, Pierre Macherey, Etienne Balibar, and François Regnault, came to see me in my office in January 1963 to ask if I would help them read Marx’s early works. So it was not my initiative which led me to talk about Marx at the École but rather a request on the part of a few students. This initial collaboration gave rise to the Seminar of 1964-1965, which we set up in June 1964. Balibar, Macherey, Regnault, Duroux, Miller, and Rancière, etc., were there [...]. We worked on the text of Capital during the entire summer of 1965. At the start of the new academic year, it was Rancière, to our great relief, who agreed to sort out the difficulties [...;] I will say that without him nothing would have been possible’ (Althusser, The Future Lasts Forever, trans. Richard Veasey [New York: New Press, 1993], 208). ↵