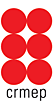Les Chaînes de la raison: un entretien avec Alain Grosrichard
KP: En guise d’introduction à notre entretien, pourriez-vous dire quelques mots sur l’origine de votre participation aux Cahiers pour l’Analyse?
AG: Distinguons l’origine et le commencement. J’ai commencé à participer aux Cahiers pour l’Analyse dès le premier numéro, paru en janvier 1966. Son titre: ‘La Vérité’, en disait long sur les ambitions du ‘Cercle d’Épistémologie de l’Ecole Normale Supérieure’ dont il était l’organe. Quant à l’origine, elle remonte pour moi à mon entrée à l’ENS, en octobre 1962, la même année que Miller, qui sera le véritable fondateur, avec Milner, de ces Cahiers pour l’Analyse. J’avais choisi, comme lui, de m’engager dans les études de philosophie, dont Louis Althusser, notre ‘caïman’, assurait alors la direction. Ce qui m’a amené à côtoyer d’autres jeunes philosophes entrés précédemment: Regnault, Macherey, Balibar, Duroux, Rancière... Milner, qui s’était orienté vers les études de linguistique, n’en participait pas moins de manière très active aux discussions de ce petit groupe réuni autour d’Althusser. C’était l’époque où, dans le cadre de son séminaire, Althusser se livrait à une relecture de Marx fort peu orthodoxe aux yeux des intellectuels officiels du Parti communiste. Contre leur interprétation globalisante et téléologique des écrits de Marx, il repérait en effet une ’coupure épistémologique’, façon Bachelard, entre un jeune Marx encore hégélien, et le Marx de l’Idéologie allemande et du Capital, plus spinoziste qu’hégélien. Ce second Marx lui fournissait les éléments d’une théorie de l’idéologie, conçue comme un système de représentations qui ne devait sa cohérence qu’à la méconnaissance, par le sujet, de la causalité structurale, d’ordre économico-social, qui le détermine. Cette référence à Spinoza dans la lecture althussérienne de Marx orientera les premières lectures que nous allions faire de Lacan, chez qui le ‘moi’ , relevant de l’imaginaire, se voyait lui aussi défini comme instance de méconnaissance pour le sujet de l’inconscient en tant que déterminé par l’ordre symbolique. Bref, via Spinoza, nous pouvions penser Marx et Lacan ensemble. Cela dit, le fait que le numéro 1 s’ouvre sur ‘La Science et la vérité’, dont Lacan nous avait offert la primeur, indique qu’en 1966, c’est sous les auspices de ce dernier, plutôt, qu’étaient nés ces Cahiers.
KP: Et pourquoi Spinoza à ce moment-là?
AG: Macherey ou Balibar seraient mieux placé que moi pour vous répondre. Mais Althusser s’y référait déjà dans son article de 1960 consacré au ‘Jeune Marx’. Et quand j’ai commencé à suivre son séminaire d’Althusser sur ‘Lire le Capital’, il était clair que tout le monde portait des lunettes aux verres taillés par Spinoza. Certes, le premier volume du Spinoza de Gueroult, sur le Livre I de l’Ethique, ne paraîtra qu’en 1968...
KP: Mais il en avait déjà fait le sujet de son cours au Collège de France, dans les années 50 et 60.
AG: Oui, et je suppose qu’Althusser l’avait suivi. Le nom de Spinoza allait d’ailleurs se retrouver dans la bouche de Lacan. Il citait déjà une proposition de l’Ethique en exergue de sa Thèse de 1933, et vous savez qu’au début de son premier séminaire à l’ENS, en janvier 1964, il comparait le sort que lui avait réservé l’Internationale psychanalytique à l’excommunication majeure prononcée autrefois contre Spinoza. En tout cas, à défaut du Spinoza de Gueroult, nous pratiquions assidûment son Descartes selon l’ordre des raisons.
KP: Guéroult n’était pourtant pas marxiste...
AG: Non, pas plus que Lacan, qui faisait lui-même grand cas de son Descartes. Ce qui comptait à nos yeux comme à ceux d’Althusser, c’est qu’il nous apprenait à lire un texte philosophique ‘selon l’ordre des raisons’. On peut même dire que cette formule, nous l’avions érigée en mot d’ordre... Mais revenons à cette première année à l’ENS. C’est en 1963, à l’occasion d’un séminaire consacré à la Critique des fondements de la psychologie de Politzer, qu’Althusser nous a fait découvrir Lacan, dont le public, jusque là, se limitait presque exclusivement aux praticiens de la psychanalyse. Parmi les exposés à choisir, il y en avait un sur le nommé Lacan. Miller s’en est chargé, et s’est plongé dans La Psychanalyse, la revue où Lacan avait publié ses articles. Dans mon souvenir, ce fut pour lui comme le Tolle, lege! de saint Augustin. Une sorte d’illumination. Son exposé fut impressionnant, d’autant qu’il nous présentait un Lacan parfaitement rationnel, qui n’avait rien à voir avec l’obscur Gongora que laissait supposer une première lecture de ses écrits. C’est à partir de ce moment, au tournant des années 63-64, que notre intérêt pour la théorie Marxiste telle que la développait Althusser s’est trouvé converger avec celui que nous nous sommes mis à porter aux écrits de Freud, relus, comme y invitait Lacan, à la lumière de la linguistique saussurienne.
KP: Un autre concept entre en jeu: la Science. Vous dites qu’Althusser distingue le Marx spinoziste du Capital du ‘jeune Marx’ hégélien. Mais ce Marx spinoziste est aussi, à ses yeux, celui chez qui la science est mise en œuvre. Que pouvez-vous me dire à propos de cette valorisation de la science dans sa lecture de Marx?
AG: Althusser essayait de théoriser la distinction entre science et idéologie. A la différence de l’idéologie, définie comme un système de représentations imaginaires plus ou moins inconsciemment mis au service d’intérêts divers, le matérialisme dialectique, tel qu’il le trouvait formulé chez Marx et Engels, et surtout chez Lénine, méritait seul, selon lui, d’être qualifié de scientifique. Mais il ne considérait pas non plus que la science se réduisait à ce qu’en disent les savants, même les plus dignes de ce nom. Un savant peut aussi construire une représentation idéologique de sa propre pratique scientifique, et c’est au philosophe, à l’instar de Spinoza dans l’Appendice du livre I de l’Ethique, de repérer en quoi consiste cette méconnaissance, afin d’en faire la théorie. C’est d’ailleurs à un examen critique de ‘l’idéologie spontanée des savants’ qu’Althusser a consacré un séminaire, en 1965-1966. Je me souviens y avoir entendu Bourdieu et Passeron, notamment...
KP: Mais quel rapport établissiez-vous, d’une part, entre ce concept de science et celui d’analyse, pour laquelle, comme leur titre l’annonce, les Cahiers pour l’Analyse entendaient militer? Et d’autre part, entre analyse et psychanalyse? La psychanalyse n’était-elle pour vous qu’un exemple particulier de l’analyse entendue au sens large, ou teniez-vous la psychanalyse comme le modèle de l’analyse?
AG: Il faudrait reprendre les textes programmatiques. L’Avertissement du premier numéro, par exemple, signé de Miller. Après avoir défini l’épistémologie comme ‘histoire et théorie du discours de la science’, et ce discours comme ‘un procès de langage que contraint la vérité’, le texte se poursuit ainsi: ‘nous nommons analytique tout discours en tant qu’il se réduit à mettre en place des unités qui se produisent et se répètent, quel que soit le principe qu’il assigne aux transformations qui jouent dans son système’. Et nous nommons ‘analyse proprement dite, la théorie qui traite comme tels des concepts d’élément et de combinatoire’. Vous avez là un concept d’analyse d’une grande extension, qui permet de regrouper la plupart des travaux qui seront publiés dans les Cahiers pour l’Analyse. Concernant la psychanalyse, l’intérêt que nous y portions était évidemment tributaire de la relecture saussurienne que Lacan faisait de l’œuvre de Freud. Ce que nous y trouvions ‘d’analytique’, c’était cette promotion de la chaîne signifiante comme déterminant un sujet sans substance, réduit à ce pur point d’énonciation qu’est le cogito cartésien, paradoxalement érigé par Lacan en point d’émergence du sujet de l’inconscient.
Mais à côté d’Althusser et de Lacan, nous nous reconnaissions un autre maître: Georges Canguilhem. Plusieurs d’entre nous suivaient son séminaire à l’Institut d’Histoire des Sciences. C’est d’ailleurs sous sa direction, comme Miller, que j’ai rédigé mon mémoire de licence. Le sujet que j’y traitais entrait dans le programme de nos Cahiers, puisqu’il y était question d’un problème touchant à l’analyse de la perception. J’en ai donné un petit aperçu dans le numéro 2 desCahiers pour l’Analyse...
KP: Nous y reviendrons...Mais une question sur Canguilhem, d’abord. Il avait été l’ami de Cavaillès et son compagnon pendant la Résistance, et il témoignait d’une grande admiration pour ses travaux d’histoire et de philosophie des mathématiques. Or Cavaillès privilégiait l’analyse, qu’il jugeait plus importante que l’intuition ou d’autres modèles de la connaissance. Il se situait dans une ligne qui vient de Bolzano, voire même de bien avant, et qui plaide pour l’arithmétisation de l’analyse... Cet accent mis sur l’analyse me frappe beaucoup. Est-ce pour cette raison que Canguilhem apportait son soutien aux Cahiers pour l’Analyse?
AG: Ce qui est sûr, c’est que Canguilhem s’intéressait à ce que nous faisions, et qu’il nous a soutenu. Vous aurez remarqué qu’une citation de lui (‘travailler un concept...’ etc) figurait en exergue aux Cahiers. Il est venu à l’Ecole Normale, invité par Althusser à une séance de son séminaire qui lui était spécialement consacrée. C’est à cette occasion que Macherey a fait, devant lui, un remarquable exposé sur ‘Canguilhem et la science’. Lacan lui-même appréciait ses travaux. Dans ‘La Science et la vérité’, il cite ce passage de ‘Qu’est-ce que la psychologie?’, qui sera publié dans le numéro suivant (CpA 2.1), où Canguilhem écrit, non sans férocité, qu’il y a deux manières de sortir de la Sorbonne: une par le haut, qui mène au Panthéon, et l’autre, celle qu’emprunte la psychologie universitaire, qui vous entraîne dans une glissade vers le bas, le long de la rue Saint Jacques, pour vous faire atterrir devant la Préfecture de police. Façon de montrer que la psychologie n’est qu’une pseudo-science au service du pouvoir politique.
KP: Quelle était son attitude à l’égard du marxisme et du lien que vous établissiez entre ce marxisme et ses propres travaux?
AG: Il émettait quelques réserves, sur ce ton un peu bougonnant que notre ami François Regnault pourrait vous imiter merveilleusement. Il se montrera par la suite d’autant plus réservé que, pour certains d’entre nous, ceux notamment qui appartenaient à la cellule étudiante du Parti communiste, ce marxisme althussérien était en passe d’être relayé par la ‘pensée Mao Tse-Toung’ et la référence à la Révolution culturelle chinoise. Ce n’était évidemment pas encore le cas en 1963. Mais il faut rappeler qu’avant la création des Cahiers pour l’Analyse, nous participions à une autre publication, les Cahiers Marxistes-Léninistes, qui s’étaient choisi pour exergue cette affirmation de Lénine: ‘la théorie de Marx est toute puissante parce qu’elle est vraie’. Jusqu’au jour où deux articles, l’un de Regnault et l’autre de Milner, qui devaient figurer dans un numéro sur le roman, furent écartés, après de vifs débats, par une majorité des camarades, conduite Robert Linhart et Benny Levy. A leurs yeux, sans doute ces deux articles représentaient-il une position petite-bourgeoise révisionniste. Toujours est-il que c’est ce refus qui est à l’origine de la création en 1966, des Cahiers pour l’Analyse.
KP: Une scission s’est donc opérée au sein du groupe des Cahiers Marxistes-Léninistes, et les Cahiers pour l’Analyse sont sortis de cette scission?
AG: Oui. Les autres camarades s’engagèrent dans une voie très différente. Certains, par exemple, décidèrent de s’établir comme ouvriers en usine. Le numéro des Cahiers Marxistes-Léninistes en question n’est d’ailleurs jamais paru. Il a été mis au pilon. Quant aux articles de Milner et de Regnault, ils ont été publiés plus tard, dans le numéro 7 des Cahiers pour l’Analyse, intitulé ‘Du mythe au roman’, auquel Georges Dumézil a bien voulu contribuer. Il n’était pourtant pas marxiste, lui non plus. C’est le moins qu’on puisse dire....
KP: En somme, vous vous êtes servis de tous les outils structuralistes...
AG: Oui, mais nous n’en faisions pas tous le même usage.
KP: Milner utilise le mot ‘hyperstructuraliste’ pour décrire le projet des Cahiers pour l’Analyse. Vous êtes d’accord?
AG: Je pense qu’en effet, ce que Miller et lui cherchaient à construire, c’était un modèle formel général, une sorte de pure logique du signifiant capable d’opérer dans des champs et sur des discours très divers, allant de la logique mathématique à la psychanalyse, en passant par la l’anthropologie et la mythologie. On était loin évidemment, de la phénoménologie...
KP: On en parlait beaucoup en France, à l’époque...
AG: En effet. De Hegel à Merleau-Ponty, c’était le discours dominant. On en parlait aussi bien sûr à l’ENS. D’autant que le jeune Derrida était venu épauler Althusser pour la direction des études de philosophie. A la Sorbonne, où nous allions pour suivre quelques cours, dont celui de Canguilhem, j’avais suivi celui de Derrida sur Husserl. Il était venu à l’Ecole nous parler des Recherches logiques, au moment où il préparait La Voix et le phénomène. Mais ce qui m’a le plus marqué, c’est le séminaire qu’il a donné sur Rousseau, dont il a tiré le livre qui l’a fait connaître du grand public: De la grammatologie... Nous en avons publié un extrait en avant première dans le numéro 4 de nos Cahiers. Derrida s’y livrait à une lecture passablement irrespectueuse de Lévi-Strauss, qui n’a pas apprécié...
KP: Et lui, a-t-il soutenu les Cahiers pour l’Analyse?
AG: Disons que Derrida ne fut pas notre soutien le plus solide. S’il aimait en parler avec nous, il ne se reconnaissait pas vraiment dans le projet. Et puis, il gardait une distance prudente par rapport à notre engagement politique qu’il jugeait, je crois, assez naïf et utopiste. Reste qu’il s’intéressait de très près à la lecture que Lacan faisait de Freud, tout en suivant un chemin qui était le sien...
KP: Par parenthèse, je vous signale qu’un de mes collègues, qui a fait sa thèse sur le Derrida de cette époque, a trouvé des documents qui montrent que son article sur ‘Freud et la scène de l’écriture’, paru dans Tel Quel en été 1966, s’inscrit dans le cadre du conflit entre André Green et Serge Leclaire sur le statut de l’affect...
AG: C’est très possible. Mais puisque nous évoquez le nom de Leclaire, j’en profite pour rappeler que nous l’avions invité, en novembre 1965 à venir nous parler de sa pratique d’analyste. Lacan venait de fonder, en juin 1964, l’Ecole Freudienne de Paris. Or une des originalités de son Ecole – ce qui n’a pas manqué de provoquer quelques protestations chez certains de ses collègues attachés à leur pré carré - est qu’il la voulait ouverte à des non-analystes. Comme Freud, il refusait de faire de la psychanalyse une branche de la médecine et de la réduire à une psychothérapie. En tant que praticiens du concept ayant pour vocation de théoriser, nous avions parfaitement notre place, à ses yeux, dans le champ freudien. Nous étions nous-même convaincus qu’en y cultivant notre jardin, nous en ferions le meilleur des champs freudiens possibles. Nous souhaitions cependant en savoir un peu plus sur la praxis analytique dans ses rapports avec la théorie. Leclaire a donc tenu régulièrement un séminaire pendant quelques années, dont les compte-rendus étaient publiés dans les Cahiers. Lacan lui-même, du reste, venait parfois nous rendre visite, le soir, pour bavarder. Il nous arrivait de le raccompagner, tard le soir, depuis la rue d’Ulm jusqu’à son domicile de la rue de Lille. En chemin, il poussait même la gentillesse jusqu’à nous inviter à boire le champagne dans un café. Et quand je dis le champagne, tenez-vous bien!... C’était du Dom Pérignon grand cru. Rien pourtant de ‘famillionnaire’, je vous le jure, dans cette façon de nous traiter. Il fumait son cigare et nous racontait des histoires drôles... A propos d’histoires drôles, je me souviens de cette affaire de canular, que je ne vais pas vous raconter parce que vous êtes quelqu’un de sérieux et que ce serait vraiment tomber dans l’anecdote...
KP: Si, si, continuez.
AG: Puisque vous insistez...Hé bien voilà. Parmi les élèves scientifiques de l’Ecole, il y avait quelques esprits forts qui ne manquaient pas de ricaner du cirque provoqué, chaque mercredi à midi et demie, par la foule de fidèles qui s’écrasaient dans la salle de théâtre, pour écouter religieusement les prônes hebdomadaires de saint Lacan. L’un d’eux, mon voisin de chambre, était un électrophysicien assez génial. Il avait inventé - mais je ne le découvris qu’après enquête - le moyen d’interférer depuis sa chambre avec le micro qu’utilisait Lacan. Si bien qu’un mercredi, tandis que Lacan était en train de parler, on entendit une musique - piano piano d’abord et puis riforzando - parasiter sa voix jusqu’à la recouvrir totalement. Je crois me rappeler qu’il s’agissait de la Messe en si, à moins que ce ne fût le Magnificat. En tout cas, il s’agissait de musique sacrée, avec déchaînements d’orgues et chœurs à l’avenant. Le plus drôle, c’est que Lacan continuait à parler comme si de rien n’était, et que personne, dans l’assistance, n’osait lever le doigt pour lui faire observer que, quand même, la communication posait quelques problèmes...Et pour apporter un surcroît piquant à cette situation déjà cocasse, le farceur et ses complices avaient eu soin de dissimuler quelques bombes fumigènes sous l’estrade, de sorte que Lacan, sans cesser de parler, finit par disparaître, aux yeux de ses fidèles sidérés, dans un épais nuage d’encens.
KP: C’est vrai?
AG: Totalement, pour autant que la vérité puisse se dire toute. Mais la suite est autrement plus édifiante. Le soir, Lacan me téléphone: ‘Ecoutez, Grosrichard. Trouvez-moi le type qui m’a fait ce canular, j’ai deux mots à lui dire’. Flatté de me voir confier le rôle d’un Dupin dans cette extraordinaire histoire, je mène l’enquête. Mon sens de l’analyse me conduit logiquement à frapper à la porte de mon voisin. Il reconnaît être l’auteur du crime. Je lui dis: ‘Lacan voudrait te causer’. Un autre aurait tremblé. Pas lui: ‘O.K, allons-y’. Et nous voilà rue de Lille, dans la salle d’attente du cabinet de Lacan. La porte s’ouvre, Lacan nous aperçoit, je lui présente l’individu, et je file en me disant: ‘Bigre! ça va chauffer!’ Grossière erreur: ils sont restés une heure ensemble, à discuter de la science moderne et de ses applications. Lacan était ravi. Mon camarade aussi. Moi je n’en revenais pas. Car c’était ça, Lacan: la surprise, dans tous les domaines... Et puis, il y avait ce sentiment qu’il me donnait, quand il m’interrogeait, que j’en savais beaucoup plus que je ne croyais. Pas toujours. Souvent il me faisait saisir aimablement que je n’étais qu’un imbécile. Mais il avait ce côté Socrate devant lequel il m’arrivait de me surprendre à ne pas l’être. Je me souviens qu’un jour, il m’avait invité à déjeuner pour que je lui parle des aveugles, sur lesquels j’étais alors en train de travailler pour mon mémoire. Grâce à lui, au dessert, je me suis aperçu que j’y voyais beaucoup plus clair que je ne l’avais craint quand je lui balbutiais quelques idées au moment des hors-d’œuvres, à propos de ce casse-tête qu’était le problème de Molyneux...
KP: Venons-y. Votre mémoire, disiez-vous, n’était pas sans rapports avec le programme des Cahiers pour l’Analyse.
AG: En effet. Canguilhem m’avait proposé d’étudier l’histoire de ce problème que Molyneux avait posé à Locke, lequel le reproduit et tente de le résoudre dans la deuxième partie de l’Essai sur l’entendement humain. Tel qu’il est énoncé au départ, le problème reste purement formel: supposons un aveugle-né qui a appris, par le seul usage du toucher, à distinguer un globe et un cube, et imaginons que, tout à coup, ses yeux s’ouvrent à la lumière. Question: en se servant uniquement de ses yeux, saura-t-il distinguer quel est le cube et quel est le globe? Locke, en se fondant uniquement sur les acquis de sa théorie empiriste de la perception comme combinaison d’idées élémentaires, répond par la négative. Or, dans la suite, le problème va se retrouver chez nombre de philosophes, de Leibniz à Condillac, en passant par Berkeley, Voltaire, Diderot et beaucoup d’autres moins connus. Les uns répondront oui, d’autres non, d’autres oui si et seulement si l’aveugle est géomètre etc. Ce que je voulais montrer, c’était comment cette petite structure formelle, plongée dans le discours de tel ou tel, fonctionnait comme révélateur de positions philosophiques différentes, l’idéalisme de Berkeley, par exemple, ou le matérialisme de Diderot. Cette approche était donc dans la ligne des Cahiers pour l’Analyse.
Mais ce n’était qu’un premier aspect de mon travail. Il y en avait un deuxième. Car ce problème, auquel les philosophes proposaient des solutions purement spéculatives, relevait aussi de l’histoire de la médecine, et plus précisément de la chirurgie de l’œil. Et là, j’étais dans le champ de Canguilhem. En 1728, si je me souviens bien, le chirurgien Cheselden parvint à opérer très convenablement un jeune aveugle-né de la cataracte. En sorte que le sujet psychologique abstrait qu’était au départ l’aveugle-né devenait un sujet supposé savoir incarné. On pouvait attendre de lui, aussitôt les bandages levés, une réponse claire et fiable, parce que fondée sur l’expérience, au problème posé par Molyneux. En fait, on s’est vite rendu compte que la réponse n’allait pas de soi, pour toutes sortes de raisons liées aux réactions post-opératoires.
Enfin, l’histoire de ce problème me conduisait dans un troisième champ:celui des rapports entre savoir et pouvoir, dont les travaux de Foucault allaient bientôt renouveler radicalement l’approche. Au terme de mon parcours, en effet, j’avais fini par tomber sur la série de mémoires sur l’histoire du problème, publiés dans les années 1770 par le Chevalier de Mérian. Il occupait les fonctions de secrétaire perpétuel de l’Académie de Berlin, fondée et dirigée par Frédéric II, l’exemple même du ’despote éclairé’. Constatant que le problème n’avait jamais été résolu, ni spéculativement, ni expérimentalement, il soumettait au souverain un projet fait pour plaire, selon lui, à ce roi-philosophe. Etant donné que nos cinq sens nous fournissent la matière première de toutes nos connaissances, disait-il en substance, pourquoi ne pas accroître la rentabilité de ces outils en rationalisant la production de ces connaissances? Créons une sorte de séminaire d’épistémologie pratique qui serait aussi une fabrique de savoir où la division du travail perceptif prendrait le relais de l’analyse philosophique. Ce qui permettrait, du coup, de résoudre un douloureux problème social. Chaque année, en effet, quantité de mères abandonnent leurs bébés. Au lieu de laisser crever inutilement ces nourrissons, arrachons-les à leurs indignes mères dès l’accouchement, et bandons-leur solidement les yeux de façon à en faire autant d’aveugles-nés artificiels. Rassemblons-les dans notre séminaire. Durant sept ans, on les y entraînera méthodiquement à exercer leur sens du tact, notoirement sous-utilisé par nous autres voyants parce qu’il fait double emploi avec la vue. Certains pourront se spécialiser tout aussi utilement dans le développement de l’odorat, ou de l’ouïe, ou du goût, comme autant de petites statues de Condillac parfaitement disciplinées. Et puis, le jour où ces précieux enfants de Minerve auront atteint l’âge de raison,- hop! on leur ôtera le bandeau des yeux, et le problème de Molyneux cessera aussitôt d’en être un. Ce ne sera d’ailleurs pas le seul. Que de lumières nouvelles ces jeunes séminaristes ne nous apporteront-ils pas sur toutes sortes de questions! De combien de préjugés, grâce à ces futurs prêtres de la science, ne serons-nous pas enfin débarrassés! Sans compter, conclut Mérian, qu’outre son caractère humanitaire, ce projet hautement philosophique présente l’avantage d’être facile à mettre en oeuvre. Pour qu’il devienne réalité, il suffit que le roi l’ordonne... Frédéric II eut la sagesse de s’en abstenir. Fort heureusement. On n’aurait pas manqué d’en tirer argument pour accuser le siècle des Lumières d’avoir fait le lit du fascisme, du nazisme, et de Dieu sait encore quels crimes contre l’humanité.
KP: Mais est-ce qu’on peut dire quand même que les Cahiers pour l’Analyse se voulaient une défense des Lumières rationalistes contre un certain romantisme phénoménologique mettant plutôt l’accent sur l’intériorité, le sentiment...?
AG: Oui, c’est de ces Lumières-là que nous nous réclamions, celles de d’Alembert, celles du Newton des Principia, auquel se référait Lacan, via les travaux de son maître Koyré...
KP: Lacan était aussi grand lecteur de Heidegger. Pas vous?
AG: Non. J’avoue que l’oubli de l’être m’était assez indifférent.
KP: J’ai posé la même question à Milner, parce qu’il a écrit sur le Sophiste de Platon, qui est un texte clé pour Heidegger. Il m’a répondu qu’à l’époque, lui non plus ne fréquentait pas Heidegger.
AG: En revanche, nous pratiquions déjà, à notre façon, ce que Lacan appellera plus tard ‘l’antiphilosophie’. En 1974, il l’inscrira même, à côté de la linguistique, de la logique et de la topologie, dans le programme des enseignements du Département de psychanalyse, à l’université de Vincennes. Il ne s’agissait pas, bien entendu, de considérer la philosophie, en bloc, comme l’ennemi à abattre. Etre ‘anti-philosophie’, c’était encore être philosophe, mais autrement. Freud aimait à citer Heine, pour qui les conceptions du monde que construisent les philosophes ne nous paraissent cohérentes que parce qu’ils ont bouché les trous de leur système avec leur bonnet de nuit. Repérer, par l’analyse, le ou les signifiants qui faisaient fonction de ‘bouche-trou’ dans tel ou tel de ces discours, voilà si vous voulez ce que c’était, l’anti-philosophie, en tout cas pour moi. Il y avait plusieurs façons de la pratiquer. Chez Althusser, cela donnait la lecture ‘symptomale’. Chez Derrida, ce sera la déconstruction. Chez Foucault, l’archéologie et la généalogie contre les vieilles lunes de l’histoire des idées. Moi-même je pratiquais sans le savoir une sorte d’antiphilosophie. Evidemment, quand je lis Badiou qui la pratique aussi bien qu’il en parle, je risque de passer pour fanfaron en disant cela.
KP: Pas sûr: à la fin de votre introduction au texte de Mérian, vous écriviez ces lignes : ‘Les techniques de connaissance de la Nature dans l’homme, qui exigent et permettent de la décomposer, permettent en retour de la recomposer selon un ordre construit qui n’est plus celui du hasard, de l’habitude, mais d’une nature ordonnée par la raison. Parce que la raison est, dans l’homme, le produit d’un progrès naturel, l’ordre imposé par la raison sera le seul véritable ordre naturel. L’homme se sert de ce que lui donne la nature pour perfectionner sa nature’. Or je crois me souvenir que Foucault, dans Les mots et les choses, dit quelque chose d’un peu semblable...
AG: Ah oui?
KP: Il a beaucoup compté pour vous?
AG: Certainement. Ne serait-ce que parce qu’il était au jury du concours, l’année où Miller et moi-même sommes entrés à l’Ecole Normale. Dans les années suivantes, il enseignait en Tunisie, ce qui l’éloignait de nous. Physiquement, j’entends. Car nous suivions de très près tout ce qu’il publiait.
KP: Le passage que je viens de vous citer me fait penser aussi au concept de la ‘suture’ tel que le développait Miller, en se référant à Frege et à sa théorie du nombre. Quel usage faisiez vous de ce concept? J’ai en effet l’impression que vous décrivez là un processus similaire, où l’homme opère une sorte de fermeture sur lui-même.
AG: Il y a sans doute de cela. Mais votre remarque vaudrait plutôt, à mon sens, pour l’article que j’ai écrit sur Rousseau. Dans ‘Gravité de Rousseau’, j’essayais d’intégrer la lecture que faisait Althusser du Contrat social, en reprenant à ma façon ce qu’il présentait comme série de ‘décalage’. Il y avait dans ce texte, selon lui, un ‘impensé’ ou un ‘non dit’, qui faisait que le discours de Rousseau ne tenait pas en équilibre, était théoriquement bancal, et renvoyait à une suite qui elle-même n’apportait qu’un équilibre provisoire etc. Dans ce non-dit, on pouvait reconnaître une ‘causalité absente’, produisant une chaîne d’effets symptomatiques au niveau du discours effectif. Je reprenais dans mon article cette idée de décalage pour l’appliquer à l’ensemble de l’œuvre de Rousseau. A l’époque, on opposait encore (à l’exception notable de Jean Starobinski, dans La Transparence et l’obstacle) le Rousseau travailleur du concept, auteur du Contrat social , et le Rousseau écrivain, -auteur de La Nouvelle Héloïse, des Confessions, des Dialogues, des Rêveries. Bref, il y avait deux Rousseau, que la critique se partageait: aux philosophes le Rousseau philosophe, aux littéraires le Rousseau écrivain. Ces deux Rousseau, j’ai essayé de les penser ensemble, en montrant que le Rousseau des Confessions n’était pas ce moi gonflé d’orgueil qui, une fois son œuvre théorique achevée, décidait de se mettre à nu, comme ça, devant le public, en déclarant ‘je suis le meilleur des hommes, quoi qu’on dise sur mon compte’, mais que ce ‘je’ des Confessions était nécessité théoriquement par quelque chose qui, dans la théorie, faisait fondamentalement défaut. Pour résumer très rapidement, le sujet de l’œuvre autobiographie, finalement, c’est le fondement qui manque à l’œuvre théorique. S’il n’est pas ce qu’il est, tout risque de s’écrouler.
KP: Ce qui me frappe, dans votre article, c’est l’accent que vous mettez sur le désir qui travaille et anime cette œuvre du début à la fin. Vous cherchez à en dégagez une structure d’ensemble, sans pour autant refuser de l’inscrire dans une histoire.
AG: Disons, si vous voulez, que je la lis comme s’il s’agissait d’une forme diachronique donnée à la structure, pour reprendre ce que dit Lacan du mythe tel que l’analyse son ami Levi-Strauss. J’étais impressionné par cet ‘hyperstructuralisme’ qu’élaboraient Miller et Milner, mais ce qui me gênait, c’est qu’il était difficilement opératoire pour moi, dans la lecture que je faisais des textes de ceux qu’on appelait les ‘philosophes’ au XVIIIè siècle. Qu’il s’agisse de Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, tous entretenaient un rapport essentiel à la langue, et savaient en jouer admirablement dans le combat qu’ils menaient contre les préjugés. Plutôt que d’exposer leurs idées en systèmes, ils recouraient aux formes d’expressions les plus diverses, contes, romans, pièces de théâtre, articles de dictionnaires, correspondances... Les Lettres persanes, Jacques le Fataliste, Candide, La Nouvelle Héloïse sont des romans ‘anti-philosophiques’, chacun à sa manière et dans son style. C’était difficilement formalisable en termes millériens!
KP: Evoquant la ‘théologie’ de Rousseau, vous écrivez que son caractère essentiel est ‘qu’elle permet de restaurer un ordre où le sujet retrouve son unité et cesse d’être infiniment aliéné dans la représentation’. Mais vous montrez en quoi cette unité du sujet est introuvable, sauf à la situer dans un moi qui n’est qu’un leurre imaginaire. Et vous en concluez que, chez Rousseau, ‘le sujet est innommable’. Cette impossibilité, pour le sujet parlant, de ne faire qu’un avec lui-même, d’avoir un nom qui lui soit vraiment propre, on la rencontre déjà dans Le Sophiste de Platon.
AG: Et ailleurs! C’est le propre du sujet du signifiant. A cet égard, Rousseau lui-même est lacanien quand il déclare, au début de ses Confessions: ‘Je suis autre’. Il suffit de le lire un peu attentivement pour s’apercevoir qu’il se vit et s’éprouve, dans et par son discours, comme sujet divisé, comme ‘manque-à-être’...
KP: Ce qui justifiait un numéro entier des Cahiers pour l’Analyse consacré à Rousseau...
AG: Oui. Nous avons même, parallèlement, republié son Essai sur l’origine des langues. Mais cet intérêt pour Rousseau tenait aussi au fait, je crois, que nous nous imaginions que notre pratique théorique avait à voir avec la Révolution. Or le Contrat social était la Bible dont s’étaient réclamés les révolutionnaires français,- Robespierre notamment. La Terreur, nous aurions pu l’interpréter comme un effet dans le réel de ‘l’impensé de Jean-Jacques Rousseau’... Sans doute aurions-nous dû étudier de plus près son Discours sur les sciences et les arts: la critique qu’il y fait de la société de consommation de son temps nous aurait préparés à affronter conceptuellement mai 68, qui allait éclater un an plus tard. Mais je plaisante...
KP: En tout cas, après et malgré mai 68, les Cahiers semblent être revenus à ce qui était leur programme initial. Le numéro 9,‘Généalogie des sciences’ est daté de l’été 1968. Et le 10, sur ‘la Formalisation’, de l’hiver 1969.
AG: Je pense qu’ils étaient prêts dès le début 1968, à un moment où personne ne prévoyait ce qui allait se passer quelques mois plus tard. Mais je suis mal placé pour en parler, vu que je n’étais plus à Paris depuis octobre 1967. Je venais d’être reçu à l’agrégation de philosophie, et je devais accomplir mon service militaire. Comme je n’avais aucune envie de porter l’uniforme, j’ai choisi le service civil, et j’ai été nommé au lycée français de Casablanca, au Maroc...
KP: Si bien que vous avez manqué les événements de mai 68?
AG: Disons plutôt que ce sont eux qui m’ont manqué. Je brûlais d’impatience que l’année scolaire se termine pour sauter dans un avion et rejoindre mes amis. Ce que j’ai fait. En août, j’étais à Besançon, en train de rédiger des tracts et de les distribuer à la sortie des usines, en compagnie de Miller et de Milner, et je ne me souviens pas qu’on ait beaucoup parlé de formalisation. Et puis, de retour au Maroc, j’ai fait partie d’un groupe maoïste clandestin, qui visait ni plus ni moins qu’à renverser la monarchie marocaine. Ça s’est d’ailleurs fini très mal: mes camarades marocains ont été arrêtés, et condamnés pour la plupart à une trentaine d’années de prison. Quant à moi, on m’a gentiment prié de quitter le pays, et je me suis retrouvé assistant de philosophie à l’université d’Aix-en-Provence, où j’enseignais Spinoza tout en militant dans la Gauche prolétarienne. Mais je n’étais qu’un sans-grade, aux ordres des grosses têtes parisiennes.
KP: Ainsi, les Cahiers pour l’Analyse ont cessé de paraître après le numéro 10. Pourquoi?
AG: Nous avions d’autres chats à fouetter. Lacan, qui poursuivait vaillamment son séminaire, non plus à l’Ecole Normale d’où il avait été chassé, mais à la Faculté de droit, en face du Panthéon, était évidemment désolé de voir ses normaliens se laisser prendre à l’illusion qu’était pour lui cette Révolution dont ils avaient plein la bouche. Il s’évertuait à leur démontrer, avec sa théorie des ‘quatre discours’, qu’elle ne ferait que les reconduire au point de départ, comme c’était pour la révolution des astres. ‘Vous voulez un maître, vous l’aurez!’ annonçait-il aux trublions de Vincennes. Il ne se trompait pas, et il allait bientôt retrouver ses ouailles, de retour au bercail, sous la houlette, non moins ferme qu’éclairée, de Jacques-Alain Miller. Le temps d’Ornicar? était venu, qui serait une autre aventure.
KP: Dernière question: que reste-t-il aujourd’hui, selon vous, du projet des Cahiers pour l’Analyse? Est-il encore une référence dans la vie intellectuelle de Paris?
AG: ...à supposer qu’il y ait encore une vie intellectuelle dans le Paris d’aujourd’hui, ce dont Milner, il y a peu, semblait douter sérieusement. Il est en tout cas de ceux qui oeuvrent aujourd’hui pour qu’on n’en arrive pas à la mort cérébrale. Quant à savoir ce qui reste de ce projet, vos questions sont déjà un début de réponse, non? Quant à moi, je dirai que le projet de ces Cahiers pour l’Analyse a fait son temps. Un temps logique,- celui qui justement structure l’analyse. Comme les trois prisonniers dans l’apologue de Lacan – à ceci près que nos chaînes n’étaient que des enchaînements de raisons - nous nous sommes d’abord regardés dans le miroir les uns des autres. Le temps de comprendre et d’expliquer ce qui nous unissait ou qui nous séparait a duré quelques brèves années. Mai 68 a sonné dans le réel le moment de conclure. Et la petite équipe s’est dispersée. Car nous en formions une, y compris sur le plan sportif. Même s’il n’existait pas de relation bi-univoque entre l’ensemble des membres du Cercle d’épistémologie et l’équipe de foot de l’ENS (maillot et bas orange, short noir), celle-ci était majoritairement composée de philosophes (Balibar, Bouveresse, Duroux, Mosconi, Rancière...), pour la plupart formés à l’école d’Althusser. Lui-même était d’ailleurs un mordu de foot. Il assistait aux entraînements, il nous encourageait sur le bord de la touche, et chaque fois qu’un match de l’équipe de France était retransmis à la télévision, il nous expliquait pourquoi les bleus avaient encore perdu, et quelle aurait été la bonne stratégie à employer pour gagner à coup sûr. Leçons toutes théoriques, dont nous prenions bonne note. Ce qui ne nous empêchait pas, régulièrement, de prendre des râclées devant Polytechnique ou l’Ecole des Impôts. Mais après tout, quelle importance? Nous les écraserions la prochaine fois, persuadés que nous étions, avec Lénine, que ‘la théorie de Marx est toute puissante parce qu’elle est vraie’.Peut-être est-ce ce genre de certitudes qui manque un peu aux jeunes philosophes d’aujourd’hui, même nourris de Badiou et de Zizek, pour retrouver l’esprit qui animait notre projet...
Il leur manque aussi autre chose, qu’on ne perçoit pas quand on lit les Cahiers. On a beau les réimprimer, les grandes voix qui nous donnaient à penser ne se font plus entendre. La voix de Lacan, celles de Canguilhem, de Foucault, de Barthes, de Derrida. Et la voix d’Althusser. Une petite anecdote, pour conclure sur une note musicale?
KP: Dites...
AG: Althusser aimait aussi l’Opéra. Au printemps 1964, la Callas était venue se produire au Palais Garnier, pour une série de représentations exceptionnelles. La Callas dans Norma, nous ne pouvions pas rater ça! Nous l’y avons accompagné. La Callas fut divine, forcément. Mémorable soirée. Et d’autant plus inoubliable que, quelques jours plus tard, nous apprenions que la veille, alors qu’elle s’élançait dans les aigus sublimes de Casta diva..., sa voix s’était brisée. C’était le début de la fin.